Critique démocratique de la République Pure.
Plan du plan: VIDEO:
 Plan kantien à géométrie assez peu variable:
Plan kantien à géométrie assez peu variable:
La pratique du plan a quelque chose de typiquement scolaire dans le
dispositif occidental républicain mais aussi dans dispositif occidental
démocratique. Le modèle le plus probant de l’exposé d’une pensée dans le
système de la valeur et de la pensée positive historique depuis Aristote
jusqu’à nos jours, repose à mon sens sur le plan commun des critiques de
Kant, c’est-à-dire sur le plan de la critique tout court.
Suis-je sérieux dans ce recours à Kant ou s’agit-il d’un pastiche ? L’un
et l’autre, forcément: Je ne fais pas office de philosophie, je ne fais
pas allégeance aux règles de la philosophie universitaire ou des
conseillers du Prince. Mais j’utilise la méthode la plus probante que je
trouve «sur le marché des idées».
Cet organigramme du développement d’une pensée propose un cadre commun
qui a rendu possible le développement des pensées critiques en occident
depuis les révolutions du XVIIIème siècle.
Ce plan présente le mérite de parcourir un ensemble de problématiques
multiples et assez complètes, sans négliger la réalité et les conditions
de l’expérience, contrairement à ce que cherche à prouver la tradition
pragmatiste qui n’en a pas moins produit les pourfendeurs de « l’axe du
mal ».
Introductions:
Introduction générale:
VIDEO: 
On doit nos vies à nos parents quelle que soit la définition qu'on donne à ce terme, ainsi qu’une partie importante de notre mode d’inscription (et de notre code d'inscription) dans le monde social. On doit presque tout le reste de ce qu’on est, au-delà d’une hypothétique « liberté » au nom de laquelle on ne doit rien à personne, à la machine républicaine sous laquelle on existe, lorsque c’est le cas, si on ne le doit pas au Roi, ou au Dieu dont il s’autorise. Encore y aurait-il à redire sur certaines extensions faciles de concept de "liberté", que sont "libéralisme" mais aussi bien "libertarisme" et même "libertinage".
Je voudrais donc m’adresser, dans toute cette présentation, à ces instances Républicaines qui résident en fait en la conscience de chacun, comme on peut s'adresser à des parents. Et je voudrais leur adresser tout le respect du et tous les reproches justifiés, que des enfants maltraités peuvent adresser à leurs parents, fût-ce au titre de cet aphorisme idiot du «qui aime bien châtie bien».
Tout cela renvoie au caractère pastoral de cette institution. C’est dire si tous ces débats sur le religieux, la fin du religieux, le retour du religieux, peuvent avoir quelque chose de débile, et servir visiblement à étouffer la question du politique.
Toute République emporte avec elle une religion républicaine, même la République mondiale de l’argent, avec ses axes du bien et du mal, sa morale de l'adaptation, sa tolérance maçonnique et incestueuse des sectes et des violences les plus barbares.
C’est au fond la violence de la République religieuse c'est-à-dire pour moi simplement "non démocratique", comme essence et comme existence, que je veux interroger dans ces développements. Sa violence ou sa bêtise, ce qui est la même chose. Et je le fais en continuant à attendre d'elle la protection qu'elle me doit et qu'elle m'a donné jusqu'à ce jour puisque j'en viens ici à cette critique.
Non que cette violence soit par nécessité coupable puisqu’elle est au principe de toute République, mais parce que la République née dans les conditions de cette violence, ne peut prétendre à penser et a fortiori à enseigner, fût-ce par ses professeurs, que là où elle a su faire l’analyse de ses propres conditions, et permis les synthèses évènementielles de ses propres réalisations. C’est-à-dire à ce jour à peu près nulle part.
J'interroge donc ici sa "raison", son "bon sens", son "honnêteté", ses "vertus", et enfin et surtout, ses sentiments, puisqu'elle ne cesse de les chanter.
Réponse aux premières
objections: uniquement parlée: 
Seulement parlé.
Introduction par
Kant: 

Ce développement constitue une critique de la République au sens
Kantien terme, (en adressant à la République à peu près la même
importance que Kant adressait à la « raison »), à tous les étages où
celle-ci se maintient, car plus que toute autre réalité elle se
maintient, elle persévère dans son être, elle est douée d’ un fort
conatus. Cette équation "République = raison" sera d’ailleurs le contenu
principal de mon propos dans cet ouvrage.
Quand je dis « à tous les étages » … je parle de la République nationale
par opposition à la République universelle, qui ne touche pas que les
arts et les lettres, mais le marché international, la République
mondiale libérale libertaire libertine, qui tout autant que la première,
est nécessaire à nos existences et doit être aussi l’objet de notre
protection en retour.
C’est donc pour les protéger l’une comme l’autre car je les estime
nécessaires l’une comme l’autre, que je leur adresse à l’une comme à
l’autre, cette critique selon la méthode critique de Kant, que je me
permets de critiquer sur certains point, mais que j'admire néanmoins.
J’entends donc comme lui la critique d’un objet comme sa mise en valeur,
et non sa dévalorisation systématique. Une critique au service de
l’association, et non de la concurrence, fût-elle « libre et non faussée
».
Cependant je veux ici adresser à l’une comme à l’autre de ces deux
instances, République de proximité et marché mondial, une critique qui
constitue pour le moins un ensemble de reproches, ce qui rappellera
forcément le sens commun qu’a fini par prendre dans l’usage depuis Kant,
en tout cas en France et en Europe continentale, ce terme de critique.
Il faudra donc le prendre aussi dans son sens très trivial et commun,
mais qui ne se distingue pas formellement du précédent. Qui aime bien
critique bien. Sade idéalisait la République au moment où elle
n'existait pas encore, on pourra dire ici que dans une certaine mesure,
je la tance au moment où elle prend de l'âge.
Le paradigme néokantien tel que l’utilise un Clouscard pose tout le
problème de l’autorité de Kant dans la postmodernité et dans la
postpostmodernité: Peut-on se fier à l’autorité de quelqu’un ?
N’y-a-t-il pas là précisément la question de pensée bourgeoise telle que
la dénonce Clouscard ?
Kant invente ou révèle les conditions de toute « critique » possible.
Mais Kant applique-t-il sa méthode critique au jugement de ses propres
conditions sociales et historiques de production intellectuelle ?
Bien-sûr que non.
Cela justifie-t-il la réaction qui consisterait à abandonner sa méthode
?
Bien-sûr que non.
Clouscard reprochait à Sartres de conserver à la fois la méthode et son
refoulement: Il pensait que la bourgeoisie, c’est le refoulement
appliquée à la méthode critique et la méthode critique appliquée au
refoulement dans un dispositif dialectique.
C’est possible.
Qu’aurait alors élaboré Kant comme explication à partir du concept de
refoulement s’il l’avait eu à disposition ?
On n’en sait rien.
La bourgeoisie c’est le refoulement comme fabrication du lieu de
l’intimité au XIXème siècle, et du lieu du charme discret de la famille
moderne au vingtième siècle, enfin d'une certaine gouaillerie au
vingt-et-unième. Mais elle est aussi le lieu de l’élaboration du concept
de travail, le lieu où l’on s’évertue à persuader qu’il faut travailler
sans cesse à produire, sans un seul instant prendre le risque de tomber
dans ce que serait la perte du gout qui caractérise le vrai travailleur.
Le travail préconisé par la position bourgeoise est toujours le «
travail émancipant », oxymore qui a fait la richesse réelle de Marx, et
sa limite intellectuelle, mais aussi bien celles d'Hannah Arendt. La
bourgeoisie ne conçoit pas que l’on puisse travailler pour vivre, comme
elle ne conçoit pas l’inverse. Le travail lui sert à tout. Comme
concept. Pour elle ce n’est d'ailleurs rien d’autre qu’un concept. La
réalité du travail, elle s'en passe.
Kant avait tout dans la forme du bourgeois, mais il a produit ce
qu’aucune pensée bourgeoise n’a osé permettre par la suite : les
conditions intellectuelles de la critique. On peut difficilement lui
reprocher d'en être resté là. De notre part, c'est plus grave.
Introduction par Rousseau:
« On me demandera si je suis prince ou
législateur pour écrire sur la politique.
Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique.
Si j’étais prince ou législateur,
je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais,
ou je me tairais.»
Jean-Jacques Rousseau.
On lui reproche d’être parano dans sa vie et dans sa théorisation : «Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être…», «indivisible», «inaliénable» : En un mot, entier. «Le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation.» Il y a donc un conatus narcissique du souverain.
Il y a une paranoïa naïve et bienheureuse de Rousseau. Image inversée dans le miroir du piétisme psychorigide de Kant qui était plutôt une obsession, pénible sinon douloureuse. Image inversée d’un obsessionnel, donc ne serait-il pas plutôt hystérique : l’abandon de famille pour la défense des sentiments.
Touchant, intelligent, aux antipodes d’un Kant obsessionnel et froid, mais complémentaire et profondément attachés l’un à l’autre par un intérêt et un respect mutuel, Rousseau est d’une certaine manière le premier « penseur politique du politique ». Je dis ça sans faire d’ « originarisme ». Rousseau est d’ailleurs aussi, et c’est paradoxal, le premier penseur des origines : origines anthropologiques, origines du langage, de la musique, origine du monde politique, origine de l’homme, bien avant Darwin.
On ne peut certes pas évoquer les origines de l’être sans une forte dose de paranoïa, mais aussi bien d’hystérie : c’est pourquoi mon schéma général d’orientation de l’être positif place la mythologie, récit des origines, entre ces deux formes fondamentales de la pensée que Rousseau illustre et honore avec toute l’intelligence qu’on peut imaginer.
Personnage à la fois difficile à situer mais déterminant dans la culture, il a posé d’emblée la question délicate qu’on ne pose presque jamais, qu’on ne se réfléchit presque jamais, qu’on évoque presque jamais parce qu’elle brule, plus encore aujourd’hui qu’à l’époque de Rousseau : La question à la fois linguistique et politique (et ce n’est pas incompatible) de la « REPRESENTATION ».
Je souhaite que cette ouvrage participe (et je choisi mon mot) de la faire avancer un peu plus, pour quelques-uns des acteurs à venir ou récemment venus à la République, je veux dire, dans leur intérêt, et donc dans celui de la dite République.
Précautions orataoires:
Fin:
Je commence par la fin parce que la fin, ici, c’est le début. Tout commence par un finalité, une intention, un projet. Je commence donc par ma fin : pour épargner à tout lecteur un peu usé avant l’effort, un épuisement préjudiciable : Qu’ai-je à dire pour développer tant d’arguments : Très peu de choses :
Je voudrais, sans forfanterie et sans fausse morale, que quiconque veut
aller au cœur de mon propos puisse ne pas s’énerver à attendre le
dévoilement théâtral de ma «finalité» : c’est la défense de la
démocratie comme concept. Mais pas au service de la République libérale
écolo-humaniste. De la démocratie «digne de ce nom». Pas des bricolages
sentimentaux intellectuels récupérateurs, pas de la générosité
capitalo-parlementariste. De la démocratie vraie, c’est-à-dire de la
démocratie idéale, «utopique» bien-sûr, celle qui n’a en fait jamais
existé et dont la facilité de réalisation a atteint un seuil
d’indécence, au regard du fait que nulle nation ne la réalise, bien trop
contente de profiter plus longtemps des privilèges de sa négligence, de
sa dissimulation, ou mieux, de l’usage euphémique de son concept, nec
plus ultra du libéralisme souple et distingué.
Je conseille donc au lecteur non empressé mais seulement pressé, de
commencer par mes deux conclusions : « Que penser ? », « Que faire ? ».
Mobile:
Le but de toute l'organisation du travail
est, nous dit-on, la satisfaction des besoins.
Si cela était vrai, une critique du travail aurait autant de
signification qu'une critique de la pesanteur.
Manifeste contre le travail. Groupe allemand Krisis.
Mon mobile est politique ! Il est politique et psychologique : Faut-il
distinguer les deux registres ??? Le peut-on?
Je refuse le système des partis, sans pour autant refuser de prendre
parti. Mais je ne veux pas prendre parti pour un parti.
Mon mobile dans cette expression est une raison, mais c’est aussi une fin. Le terme « mobile » conserve cette amphibologie : on y confond la causalité et la téléologie. Le « mobile » est-il ce qui bouge ou ce qui fait bouger? Ce qui attire, ce qui motive, ce qui persuade?? Universelle attraction.
C’est le même double sens du terme «raison» dont la confusion est sciemment maintenue dans l’expression « raison d’agir » telle qu’elle est évoquée par Bourdieu, ainsi que dans toute la «critique du choix rationnel», mais aussi dans l’attitude générale des enquêtes pragmatiques sur l’entendement humain.
La raison d’agir est-elle toujours raisonnable ?
La raison d’agir est à la fois une cause et une finalité de l’action.
Et l’action est constitutive de cet effet de la « mobilité ».
Constitutive c’est-à-dire constituée et constituante.
C’est ici par exemple l’intérêt du paradigme de l’individu «automobile»
qui est isolé par F. Lordon dans sa critique de la servitude consentie
du travailleur salarié.
Mon mobile est devant moi et derrière moi : Je veux dénoncer les vices générateurs de la République et des Républiques, et les vertus inhérentes à la consistance démocratique de celles-ci, parce que je ne peux pas faire autrement, et je ne peux pas faire autrement parce je pense que c’est «nécessaire», pour reprendre un terme des philosophes. C’est ma nécessité, faite de ce qui me tombe dessus comme contingence. C’est une somme, ou un produit : selon.
Mon mobile est donc essentiellement politique et va de pair avec mon
«opinion». Il n’y a rien de «vrai» là-dedans. Il n'y a que de l'intérêt!
Mais c’est tout de même moins faux que le discours républicain positif
et justificateur de l'adaptation.
Je suis certes ici moi-aussi un «automobile». Je roule pour moi, comme
tout le monde. Pour autant que j'y crois.
Mon mobile est un «automobile», mais il n’en prend pas moins acte des
déterminations historique qui m’en habillent, qui m'en habilite, qui
m'en habitent, qui m'en habituent.
Lordon cite Spinoza pensant que l’état souverain devait « conduire les hommes de façon telle qu’ils aient le sentiment, non pas d’être conduits, mais de vivre selon leur complexion et libre décret ». (Traité politique. X.8 Œuvre V, coll Epiméthée, PUF 2005) : Je n’en suis pas encore là. Je suis comme les autres, une petite machine automobile, une mobylette mue par une substance issue de l’exploitation plus ou moins commune de la planète, et qui se déplace dans des directions commandées par les règles de la division du travail, mais qui n'en reste pas moins fasciné par le caractère libre et universel de mon propre décret, qui est un impératif tout aussi catégorique que celui de Kant.
Méthode:
Je commence ici par une annonce sinon un exposé de la méthode, comme
Kant, qui pense qu’elle doit figurer à l’issue d’un développement de
l’état des choses, mais peut-être un peu comme Descartes, qui pose la
méthode comme condition de l’assurance individuelle. Je ne parle pas de
la sécurité sociale. Je parle de la « morale par provision » :
Ma méthode sera donc ici essentiellement le passage de l’écrit au parlé.
On peut appeler ça une lecture mais je ne voudrais surtout pas que mon
objet se résume à ça.
Elle comporte aussi une caractéristique qui n’est pas l’apanage
habituellement de l’expression parlée : elle s’astreint à la consistance
d’un plan. Ce plan aura donc une importance équivalente à celle de
l’expression : il constitue pour elle aussi bien un support qu’un
déterminant. J’ai un horizon devant moi, mais j’en ai aussi un derrière
moi. La seule différence est que celui de derrière, je ne le vois pas.
Je ne vais pas non plus dans sa direction. Mais il me suffit de quelque
penchant, quelque « clinamen », pour me retrouver face à lui. Topologie,
typologie !
La méthode va donc ici « s’adresser » à mon prochain essentiellement sur
le net, donc à un prochain pouvant être assez éloigné dans l’espace, et
même éventuellement dans la culture, mais qui ne suivra mon fil que s’il
est assez proche dans l’esprit et dans la langue, non pas de ce que je
raconte in situ, mais de l’ensemble de cet horizon de déterminations
pratiques et téléologiques qui sont annoncées dans le plan. La proximité
de l’horizon est certes un affect contradictoire et contestable. Elle
conditionne pourtant toute idée de « subjectivité » : ce qui me fait
sujet de quelque expression que ce soit (discours, action, mouvement),
c’est cette géographie de l’être que Kant a si bien illustrée dans la
critique de la raison pure au chapitre de la discipline (Qui fait
d’ailleurs partie de la méthode). L’être est ici beaucoup plus
consistant à l’étage de l’indistinction entre moi (ma grandeur) et le
rayon de ma perception des choses, qu’à celui du sentiment individuel
d’existence.
Cette méthode est donc kantienne dans la forme. Elle voudra cependant
aussi (ou inversement selon comme on ressent le personnage de Kant),
rester critique à l’endroit du fait psycho-social, ce qui n’a pas été le
fort de Kant, ni des « néokantiens » que Clouscard stigmatise de façon
si tonique, et qui eux, emballent plutôt des dogmatiques scolaires et
bourgeoises sous les apparences de pseudo-critiques politiques, et donc
il s’agira ici de faire la « critique des positions » que chacun peut
prendre dans les champs que lui attribut sa naissance.
« Si je représente la surface terrestre (selon l’apparence sensible)
comme une assiette, je ne peux pas savoir jusqu’où elle s’étend. Mais
l’expérience m’apprend que, où que j’aille, je vois toujours autour de
moi un espace où je pourrais encore m’avancer ; je reconnais, par
conséquent, les bornes de ma connaissance toujours réelle de la terre,
mais non pas les limites de toute description possible de la terre. Que
si je suis arrivé assez loin, cependant, pour savoir que la terre est un
globe et que sa surface est une surface sphérique, je puis alors
connaître, d’une manière déterminée et suivant des principes a priori,
même par une petite partie de cette surface, par la grandeur d’un degré,
par exemple, le diamètre de la terre et, par ce diamètre, sa complète
circonscription, c’est-à-dire sa surface entière ; et, bien que je sois
ignorant par rapport aux objets que peut renfermer cette surface, je ne
le suis cependant pas au point de vue de la circonscription qui les
contient, de sa grandeur et de ses bornes. » Critique de la Raison pure,
"De l'impossibilité où est la raison pure en désaccord avec elle-même de
trouver la paix dans le scepticisme" (trad. PUF, p. 518)
Il est curieux de noter ici que Kant ne cite pas la thèse du gnomon
d’Anaximandre de Millet alors qu’il dit qu’on peut calculer le diamètre
de la terre.
J’en passe par l’élaboration d’une description d’explication à principe
de validité « relativement » universel pour proposer non pas un système
du monde éternel comme on en a vu, mais une grille de lecture des
complexes psychiques du vaste monde occidental actuel, et de là, je tire
des conclusions purement politiques, qui malgré les apparences, ne sont
pas imposées par l’arbitraire de ma seule opinion affective, mais
réfléchies en récurrence dans une pratique du jugement politique, qui
certes a pour fonction de défouler mon propre grumeau subjectif
d’insatisfaction et de « paranoïa hyposthénique revendiquante », mais
qui a aussi l’expérience, sinon le mérite, d’avoir éprouvé au crible
d’une grille de lecture qui n’est pas simplement un « outil
d’amélioration des pratiques » comme le veut le modeste mais tyrannique
pragmatisme des institutions soumises aux dictats moraux du marché
mondial des valeurs morales, mais qui a prétention à fonctionner
davantage comme ersatz pratique et actuel, de cet objet bizarre et en
définitive assez esthétique que Kant a stigmatisé sous la dénomination
aujourd’hui surannée de « schématisme de l’entendement».
Trois lectures:
Tout comme les ouvrage philosophiques de l’antiquité (Physique,
logique, métaphysique) mon propos dans la totalité du plan kantien ici
déroulé, pourra en outre de ce classement se lire à la hauteur de trois
consistances que je conçois comme « Psychique, Logique, Métapsychique ».
Cela veut dire que chaque assertion développée ici comportera une unité
de lieu, de temps et d’action au travers des trois catégories suivantes
:
*Une lecture PSY qui part de mon expérience professionnelle vécue, on ne
se refait pas et on n’échappe pas à sa condition, mais aussi bien aussi
de mon expérience subjective, on ne se refait pas davantage sur ce plan
là.
*Une lecture logique qui fait suite à ma « découverte » des écrits de
Piaget et de Blanchet entre autres, écrits qui ne sont pourtant pas «
cachés », mais que nos traditions culturelles de distinction
intellectuelle ont eu une large tendance à laisser figurer au musée des
traditions scolaires et intellectuelles pour des raisons de facilité (ou
plutôt de difficulté), de modes, d’intérêt (d’intérêt de classe de
pensée), et certainement encore bien d’autres.
*Une lecture enfin « métapsychique » qui pourrait coller d’assez près à
la définition qu’utilisait Freud de l’expression « métapsychologie » :
il y va d’une interprétation en terme très pragmatiques de l’économie
psychique comme angle de vue de l’économie générale, aussi bien que
comme consistance collective au sens très large du terme (sociologique
et politique) de toute lecture des évènements et des « donnés » de
l’histoire individuelle de chacun, comme de celle du monde; donc c’est
l’opposition de l’individu au collectif, mais aussi celle du vivant au
social, de la nature à la culture, du moi à l’autre.
On pensera donc bien-sûr aux trois livres du monothéisme occidental
positif que je considère exclusivement dans tous ce propos compte tenu
de mon ignorance complète des cultures et des philosophies d’orient.
Mais alors je ne saurai trop quelle place réserver au troisième dont je
suis à peu près aussi ignare.
On pensera aussi aux trois sacrosaints registres du système général de
la psychanalyse lacanienne : le réel, l’imaginaire et le symbolique, qui
ont certainement du influencer mon classement dans les époques de sa
constitution. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, si la comparaison
reste valide en substance, je n’assimile plus rien d’un principe de
nouage topologique mutuellement symétrique des trois registres : je
parle d’un réel qui est coincé de façon univoque entre un symbolique et
un imaginaire ne pouvant avoir de contacts que par son interface. Je
parle d’un réel plan, plan d’inscription comme Deleuze et Guattari ont
pu souvent l’évoquer. Cela change donc l’ensemble du dispositif.
J’ai conscience que comme dans le cas des précédents sites (écrits et
non parlés pour la circonstance), cette triple finalité de parler dans
le même temps de psychologie, de logique et de politique, peut
constituer une difficulté pour l’auditeur ou le lecteur. Cela n’en
constitue pas moins une garantie de « cohérence », même si l’effet
produit est bien souvent celui d’une incohérence formelle ou
expérimentale (absence d’exemples par exemple).
La République comme concept double: VIDEO: 
Le mot-concept-signifiant-représentation-valise «République» est éculé
jusqu’au talon, mais il marche encore et il implique pour beaucoup
d’entre nous, consciemment ou inconsciemment, des transferts d’affects
phénoménaux!
C’est mon cas en tout cas: Je crois en quelque chose de la République.
De Gaulle n’y est certainement pas pour rien. J’ai le sentiment d’en
être issu. Mais j’ai aussi le sentiment d’en être insu. Ça se discute.
Et c’est bien ce que je discute ici.
Mais une chose est sûre, qui est aussi souvent omise pour ne pas dire
occultée, c’est qu’il n’y a pas un seul plan de la République: Il y a au
moins deux feuillets de consistance du plan d’inscription républicain où
que l’on se trouve et qui que l’on soit:
Il y a la République «nationale» qui emporte le sentiment de l’évidence
et de la banalité historique.
Mais il y a aussi la République «mondiale» des échanges libéraux et
internationaux qui n’en est pas moins une, et qui n’est pas moins
porteuse d’idéaux comparables, d’un rapport au droit comparable, d’une
éthique et d’une esthétique comparables. Elle est aussi République des
idées, République des droits, des concepts, mais pas des lettres.
Je sais que cette bipartition est mal vue et contestée par l'élite
intellectuelle distinctive de ces valeurs et distinguée par ses valeurs.
Mais maintiens cette vision théorique qui me paraît pratique pour
continuer à penser malgré les commandements de la distinction.
Il y a donc une sorte de malentendu automatique et dogmatique généré par
la seule référence au concept de « la » République, dès lors
que l’on escamote la dimension au moins duelle de cette substance ou de
cet attribut. Je dis « au moins », car on peut aussi
imaginer des tas de plans autres pour la « République »
comme concept, c’est-à-dire comme sentiment, ou comme sensation prélevé
dans une expérience du monde, ce qu’on appelle une phénoménologie. (Ne
serait-ce que la république des enfants, des animaux, des femmes, des
malades, des fous, etc.)
***
La République ne s’arrête pas pour nous français aux frontières de
l’hexagone. Peut-être précisément parce pendant des siècles elle a voulu
s’étendre comme ce fut la cas de tous les empires. De fait il y a pour
nous comme dans une sorte de retour de bâton colonial, une République
mondiale, un principe international de l’état de droit, une République
du droit international, qui fait autorité à l’échelle mondiale, dans un
rapport de force et dans un coup de force. Mais la question de savoir si
ce droit est « légitime », s’il est juste, s’il redistribue
correctement ses puissances, reste d’actualité et de façon
particulièrement cuisante.
Deux ou trois siècles de pratiques coloniales européennes ont préparé le
terrain d’une machine mondiale d’exploitation des biens et des
personnes. Ce qui fait que la façon dont les nations puissantes ont
utilisé la planète, se retourne aujourd’hui contre elles (biens et
personnes, je veux dire bien naturels et personnes culturelles) à partir
d’un consortium déterritorialisé de banquiers et d’assureurs, et à
partir d’une très vaste société d’actionnaires.
La République nationale se trouve donc enserrée maintenant dans un
réseau de relations d’argent totalement solidaires des relations de
guerre.
Elle est encore loin (sauf quelques exceptions comme Chirac et De
Villepin en 2003), d’avoir le courage de prendre position pour les
politiques de désarmement pacifiques ou du moins, civilisées.
***
Dans tout cet ouvrage j’emploie donc le terme de «
République » dans un sens large et aucunement limité à la
République nationale, à laquelle le lecteur ou l’auditeur francophone de
ces propos appartiendra le plus probablement, pour autant qu’il existe.
Le principe du singulier dans l’emploi du terme «la République» devra
toujours aussi être pensé avec cette relativité, car je pense tout
autant à la République où je m’exprime présentement, qu’à ses voisines,
et qu’aux Républiques potentielles théoriques ou affectives (idéales)
qui existent de par le monde, et surtout bien-sûr dans le cadre de la
SMEL («Société mondiale d’exercice libéral»), dont le caractère
républicain n’est pas suffisamment mis en évidence, et qui en comporte
pourtant tous les traits, à l’exception bien-sûr de la limitation
territoriale. Toni Negri parle à son sujet d’«empire». C’est sûrement
une vision cohérente et qui a tout son sens politique dans sa réflexion,
mais c’est un empire sans empereur, et qui repose sur un principe de
liberté des sujets, même si cette liberté est devenue un déterminant
bien peu enviable, dès lors qu’elle ne concerne plus que la seule
possibilité d’ « entreprendre ».
Le singulier de mon concept illustre donc davantage le caractère d’un
concept, beaucoup plus que la singularité d’un objet.
***
Une autre réflexion nécessaire ici au sujet de la République est que mon
propos n’est pas tant de parler d’elle que de lui parler à elle ;
c’est-à-dire de m’adresser à chaque citoyen d’ici ou d’ailleurs, pour
lui parler de la façon dont il représente « la » République,
en votant, mais aussi en parlant, en participant ou non au montage
permanent de cet objet conceptuel mystérieux et familier, pour ne pas
dire « familial ».
***
La discipline de la pensée républicaine commence officiellement avec
Platon mais doit exister dans le même temps sous une autre forme sur les
collines de Rome.
Elle va ensuite se transformer et s’adapter aux univers politiques qui
exigeront d’elle qu’elle les conserve.
Il y a un sentiment républicain qui entre de façon substantielle dans la
consistance même du concept : la République est comme les parents,
elle est même d’une certaine façon les parents : on en attend
quelque chose, on lui adresse des éléments de reconnaissance, on lui en
veut souvent de ne pas faire certaines choses, remplir certaines
conditions. C'est mon cas.
Comme la Nation, elle participe au sentiment d’existence collectif et
narcissique à la fois. De là à la divinisation ou à la diabolisation
hégélienne de l’état il n’y a qu’un pas. Nous sommes tous apparu dans un
monde social où ce pas avait été franchi depuis longtemps. La République
a su se parer au cours du XIXème siècle de tous les attributs de la
divinité et des fonctions cérémonielles qui vont de pair. Elle constitue
une ecclésia qui se plébiscite et s’honore elle–même. Elle est à
elle-même son propre objet de culte. Elle constitue une structure
religieuse narcissique qui dirige son propre culte et encadre sa propre
liturgie. Elections … Sélections…Fêtes maniaques…Utopies mélancoliques.
Déontologie.
Afin de prévenir certaines critiques si par bonheur je devais en
recevoir, je précise que :
Ce site se veut un acte et un effet d’expression à visée de persuasion
politique, c’est-à-dire de rhétorique, donc dans une certaine mesure un
appel à l’opinion, c’est un manifeste personnel, dans l’état actuel des
choses, mais en aucun cas un acte de propagande puisqu’il ne s’appuie
sur aucun dogme, aucun groupe de pression, aucune secte, et aucun parti,
ce qui serait encore plus grave.
Il ne constitue pas un traité de psychiatrie, ni de philosophie, ni
d’anthropologie, bien qu’il s’appuie de façon parfois instable sur ces
disciplines. Il ne présuppose de ma part aucune compétence. Il est
l’émanation du pur domaine de mon « opinion ».
Il n’est pas un manuel où un traité de logique : pas un manuel car je ne
reprends pas l’état actuel des grands chapitres de la logique qui se
trouve superbement exposé sur wikipedia par exemple, avec bien-sûr une
barre d’impossibilités entre les pages de langues différentes et
particulièrement entre l’anglais et le français : nous n’avons pas en
ligne les principia mathématica, mais nous avons tout ce qu’il faut de
Piaget.
Il n’est pas non plus un traité de logique puisqu’il s’appuie seulement
et autant qu’il m’est possible de le faire sur les traités de la
tradition et de l’ancien monde. Je rappelle la façon dont mon plan
cherche à évoquer la structure des grands traités de la philosophie
antique : physique, logique, métaphysique. La seule originalité que
j’apporte là-dessus (et je mesure la présomption que cela comporte),
c’est l’affichage des correspondances entre ces trois catégories telles
qu’elles figurent sur mon plan d’ouvrage.
Il n’implique en aucune façon ma responsabilité professionnelle : je
fais mon métier sans joie et pour vivre dans les moins mauvaises
conditions le capitalisme que je critique mais que je ne cherche pas à
détruire, puisqu’il constitue mon biotope politique. A ce sujet, je
verrai donc d’une mauvaise humeur qu’on me reproche d’outrepasser mes
devoirs de réserve, dans la mesure où je ne donne aucun exemple prélevé
sur ma pratique professionnelle, ce qui m’est parfois reproché, et ce
qui est une précaution que ne prennent pas de nombre de mes confrères.
Esthétique
immanente des éléments psycho-sociaux:
Condition de la sensibilité permettant de concevoir la chose publique,
et donc conditions de possibilité de l’expérience collective:
Introduction:
Des trois critiques de Kant seule la CRP comporte une esthétique
inaugurale, et pour l’occasion celle-ci est transcendantale. Cette sorte
de précaution oratoire très développée donne un caractère monumental à
l’ouvrage mais constitue aussi l’originalité et la rupture historique
qui fait de cette œuvre un moment « révolutionnaire » au
sens très sage du terme dans l’histoire des idées, mais d’une sagesse
qui n’en a pas moins renversé l’habitus ou la forme philosophique, et
donc politique: une critique est devenue possible sur la base d’une
prise en compte des intuitions «pures» comme condition de toute
connaissance possible.
La considération dans un dispositif parallèle, bien que référé au champ
d’immanence de l’expérience psycho-sociale, c’est-à-dire
«amphibologiquement individuelle et collective», me permet donc de
commenter des questions toutes premières de topologie de la position
subjective d’expression et d’énonciation de tout sujet humain ou non
humain.
Ce chapitre qui est donc le plus bref, est aussi peut-être le plus
important, chez Kant comme dans mon modeste pastiche.
Je rappelle que Kant a réservé le terme d’amphibologie à la confusion
pratiquée par les empiristes et par les idéalistes de son temps et des
précédentes périodes, entre les données empiriques de l’expérience
immédiate et les données a priori de l’idéalisme transcendantal. La
confusion entre soi et l’autre, entre le dedans et le dehors de
l’expérience vécue s’ils étaient repérables, entre le sujet de
l’énonciation et le nom du groupe d’appartenance, me semble réaliser une
vibration et un trouble constituant du même ordre: elle constitue un
sujet pour soi de la même façon que lorsque Kant parle de «
satisfaction pathologique » au sujet du jugement de goût. On peut
poser pour simplifier et par bon sens qu’il n’y a pas de sujet «
en soi », c’est-à-dire pas plus de cogito (du fait de
l’amphibologie), que de sujet transcendantal husserlien susceptible
d’ « intentionner » (ce qui serait le contraire
d’ « intuitionner ») des objets du monde par une
activité intentionnelle de la conscience.
Sartre avait d’ailleurs une conscience de ce manque à être
transcendantal de la conscience pour tout sujet : « La seule
façon d'échapper au solipsisme serait (...) de prouver que ma conscience
transcendantale, dans son être même, est affectée par l'existence
extra-mondaine d'autres consciences du même type. » (SARTRE, La
Transcendance de l'ego, 1966, p. 132)
Être affecté depuis l’au-delà par un autre moi-même serait plutôt le
propre de la conscience qui se constitue dans un champ d’immanence, bien
difficile à distinguer du champ social.
L’importance d’une esthétique immanente en tant que « sensibilité
à l’autre en tant que tel » nous apparaît donc comme condition
évidente d’une critique cohérente (bien que pathologique) du sentiment
républicain, qui ne peut se développer que dans un univers républicain.
Pour ces raisons par définition complexe et donc forcément «
compliquées à comprendre », j’ai voulu développer ici toute une
reprise de la logique ou plutôt des logiques en l’état où nous les
possédons si tant est qu’elles puissent se posséder, mais aussi toute
une « topologie » qui ne sera certainement pas sans évoquer
toute celle qu’a pu produire Lacan, et qui en est d’ailleurs
certainement une dérive, les connaisseurs pourront le confirmer.
Il reste que Lacan n'a pas voulu se compromettre à traiter de la
consistance intersubjective du sujet humain, c'est-à-dire du sujet
politique. Sans doute parce qu'il a jugé la démocratie insuffisante à
garantir un accès à son inconscient royal monarchique transcendantale
critique. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas réussi à tirer quelques
règles pour la direction de l'esprit de son usage mathématique d'une
topologie en laquelle il croyait trop. C'est la raison pour laquelle je
propose une topologie plus proche de celle de Kafka dans la colonie
pénitentiaire, et donc peut -être aussi plus proche de celle de Deleuze
et Guattari avec leur doctrine du plan d'inscription sur le corps sans
organes.
Je sais que c'est difficile. Ce chapitre est forcément résumé et
synthétique, et donc dialectique, même s'il se situe, pour pasticher
Kant, en ouverture de la logique.
Section I: VIDEO: 
L’espace psycho-social partageant.
Conditions géographiques de la conception publique.
«on passe de la diplopie à l'objet unique, non par une inspection de
l'esprit, mais quand les deux yeux cessent de fonctionner chacun pour
leur compte et sont utilisés comme un seul organe par un regard unique.
Ce n'est pas le sujet épistémologique qui effectue la synthèse, c'est le
corps quand il s'arrache à sa dispersion, se rassemble, se porte par
tous les moyens vers un terme unique de son mouvement, et quand son
intention unique se conçoit en lui par le phénomène de synergie
(MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 268.)»
« Je n’ai ni haut ni bas » J Derrida. Circonfession.
S’il y a une profondeur topologique et métaphysique des choses, alors,
il y une intériorité des êtres. Mais jusqu’à présent, cela n’est pas
prouvé.
Il faut partager un espace de vie ou d’expérience, c’est dire un espace
vécu si l’on veut pouvoir parler à qui que ce soit de sa propre liberté
(ou de son aliénation) dans ce même espace.
Cela stipule quelque chose du partage dans une géométrie qui ne semble
pas s’y prêter, c’est-à-dire concevoir l’altérité d’une parole (qu’on ne
fait jamais que répéter) en tant que l’on « reconnait » cette parole « à
» cet autrui, et dans le même temps se supporter comme « moi immanent »
ou comme lieu consistant de pensée, d’expression, de sentiment,
intégralement déterminé par cette autre parole ou l’ensemble de ces «
parole d’autres » qui ne vont pas toujours dans le sens ou dans les sens
qui pourraient « arranger » le moi en question, et le sujet qui souffre
en lui.
« Ma vérité me revient dans le message de l’autre sous forme inversée »
dit en substance Lacan.
Pourtant Lacan a imaginé toute sa vie un espace psychique a trois
dimensions : réel, symbolique, et imaginaire, inconciliables autrement
que par un nouage topologique savant.
C’est-à-dire qu’il est resté asservi jusqu’au bout à la tradition
euclidienne d’une représentation de l’espace par trois dimensions, ce
qui stipule une profondeur des choses. On pourrait en dire autant de
Freud.
Leibniz, Kafka, Deleuze, Guattari, entre autres ont pensé l’espace du
sujet comme un plan d’inscription.
Le magnifique paradigme du pli chez Deleuze stipule un être
d’inscriptions tout en palimpseste dans un plan infiniment compliqué et
replié sur lui-même.
Cette innovation de la géométrie stipule non pas un espace de trois
dimensions pour situer les objets agrémenté d’une quatrième dimension
subjective qui serait celle du temps. Au contraire cette conception de
l’espace vécu (par opposition au dieu omniscient ponctuel de Poincaré)
conçoit le réel comme une inscription dans le plan ou sur le plan de
consistance de l’être qui sépare les deux espaces topologiques confondus
de l’imaginaire et du symbolique, de la pratique et de la théorie
kantiennes.
L’être parlant ne parle que parce qu’il est écrit.
Voir les montres molles de Dali.
J’ai développé cette idée dans :
« Que le réel pourrait n'être qu'un espace à deux dimensions plus le
temps. » et le précédant, dans « textes psychologiques »
dans mon site « … encore un effort … ».
Section II: VIDEOS:


Le temps du sujet psychosocial partagé.
Conditions historiques de la conception publique.
Le temps du sujet psycho-social partagé n’est pas le temps des objets
inanimé, même si l’usage d’une mesure du temps leur confère toujours un
peu d’esprit. Le temps immanent, condition de tout « vécu » au sens de
la phénoménologie, est marqué par le partage difficile de l’être et de
l’altérité qui le constitue en être. Difficile de penser le temps pour
un quidam qui n’en penserait un autre. Avant quoi et après quoi ? Avant
et après qui ?
Il est clair que le temps est une intuition et n’est qu’une intuition.
Il est clair aussi qu’il est une institution et qu’il n’est qu’une
institution. (Bourdieu dit ça magnifiquement dans son cours sur l’état
au collège de France.)
Et tout ça « a priori » : Mais « a priori » de quel moment ?
Le sablier ou la clepsydre nous représentent toujours le rapport
critique de deux espaces en conflit avec une zone de partage et de
passage en turbulence, un étranglement, une angoisse d’objet. Le temps
est d’abord celui du sujet et celui du sujet est d’abord angoisse.
Sartre dit aussi tout ça superbement. Angoisse ou jouissance. Qu’il
n’est pas souvent facile de distinguer. Ou plutôt, dont la distinction
repose toujours sur un coup de force de la pensée positive. « Je sais où
j’en suis ». « Je sais ce que je dis ». Ca ne mange pas de pain. Faut-il
distinguer ? Là-dessus, Kant ne dit rien.
L’avant et l’après sont toujours l’avant et l’après d’une naissance. Ou
d’une mort. Le sujet psycho-social est effectivement partagé entre ces
deux « évènements » qui le déterminent à tous les sens du terme.
Avant ça et après ça, il est parlé par les autres, par « ses » autres.
On peut être sujet de n’être que parlé. Ou de n’être qu’inscrit. Aux
examens par exemple. Le temps subjectif, seul temps «réel», est à ce
partage de la passion et de l’action, qui fait l’attente de la décision,
l’attente du mot, la pensée, l’attention, le silence, ou la répétition
pour faire patienter, la comptine, la ritournelle de Deleuze et
Guattari.
En quoi le temps est-il du temps s’il n’y a rien à y vivre. Le temps des
planètes est celui d’une vie. Les planètes respirent. Les objets
concernés par le temps sont vivants, animés ou animaux, ils sont objets
de la génération et de la corruption.
Mais en deçà de ces catégories très métaphysiques de l’être il y a pour
l’être humain les rapports de société. Et là aussi se joue cette musique
et ce tourbillon du « passage »,
dans la structure du rapport des classes,
dans la structure du rapport des races,
dans la structure du rapport des sexes,
dans la structure du rapport des générations.
Conclusion
:
De l’histoire-géographie comme condition de toute République.
Cournot oppose la science à l’histoire.
Cette topologie du monde humain avec ses civilisations, ses empires, ses
nations, ses techniques, ses économies, son histoire et sa géographie,
lorsqu’elle s’organise en connaissance collective, ne peut produire
qu’une République. Une République n’est que la réalisation d’une
conscience collective de ce vécu dans une partie du monde. La république
est la forme de société qui se pense elle-même et se réfléchit « en
assemblée ».
Il n’est pas simple de définir une République. Les dictionnaires
étymologiques ne cranent pas sur la question. Libre conscience
collective d’être un collectif, conscience collective d’une certaine
liberté, liberté collective de la conscience d’une identité. Disons
qu’il n’y a pas de République là où il n’y a pas de liberté. Même si la
liberté qui se joue dans les républiques n’est pas toujours celle à
laquelle on peut aspirer !
Liberté de dire, d’écrire, de lire, qui stipule bien sûr de « savoir »
lire, écrire, et parler. Est-ce bien si sûr ?
On peut être libre penseur sans savoir écrire. Ou Lire. N’est-ce pas
précisément en constituant ces connaissances comme « savoir » qu’on
noyaute la dimension de liberté qui s’y joue. Il vaut peut-être mieux ne
pas savoir écrire que savoir écrire pour n’écrire que ce que la
République attend qu’on écrive en son sein : puisqu’elle rend possible
par ses structures la liberté de ses sujets, elle doit supporter que
chacun d’eux la critique selon la méthode kantienne puisque c’est la
seule. Il vaut mieux ne pas savoir lire si c’est pour reproduire la
liturgie d’une République insatisfaite et limitant ses effets
d’émancipation à quelques privilégiés. La fonction d’ « éducation » de
la République est donc une question qui peut être litigieuse (et qui ne
manque pas de l’être) :
Les conditions spatio-temporelles de la naissance d’une République ne
suffisent pas à garantir sa vertu démocratique. D’ailleurs la vertu
d’une République peut-elle reposer sur autre chose que l’idée
démocratique au principe de ses fonctionnements. C’est une partie de la
thèse que je souhaite défendre par cet ouvrage et les précédents : Je ne
vois pas comment une République quelle qu’elle soit, pourrait avoir
comme idéal politique l’oligarchie qui dans la quasi-totalité des cas
réels, la constitue.
Il reste que la démocratie comme concept n’est pas encore l’objet du
discours commun, pas plus que le débat n’est rendu réalisable en réalité
par les conditions politiques de la République dont ce devrait être la
première préoccupation.
Je dis ce qui devrait être plutôt que ce qui est. Ça ne m’empêche pas de
dire et donc de dénoncer ce qui est. C’est précisément parce que les
conditions républicaines de mon expression sont insuffisantes à
l’expression de ma liberté, qui n’est pas plus idiote qu’une autre, et
donc n’a pas lieu de rester plus longtemps sous le boisseau des
convenances d’une République que je respecte, parce qu’elle permet que
je produise cette expression, mais que je conteste, parce qu’il m’aura
fallu attendre cet âge avancé pour le faire, c’est-à-dire pour
m’émanciper à peu près complétement des conditions de la politique
éducative et donc dans une large mesure répressive, qu’elle a maintenu à
mon endroit, par l’entremise et la complicité d’une politique
économique, qui ne se dit jamais là où elle s’exerce et ne s’exerce
jamais là où elle se dit.
Convention de valeurs logiques.
Quand je parle ici de la valeur, ce pourrait être par opposition à la
couleur.
Piaget noircit les espaces non habités de ses formes logiques pour ce
qui concerne le calcul des propositions. (Eléments de logique opératoire
1949 chapitre V calcul des propositions)
J’avais commencé (sous son influence) selon cette méthode puis
insensiblement et au prix de gros dégâts méthodologiques, j’ai inversé
cette convention dans ma propre façon de présenter et donc de penser les
choses logiques et la logique des choses. Pourquoi?
Parce que représenter en blanc l’affirmation et en noir la négation m’a
un moment donné semblé constituer un postulat de principe, un a priori
esthétique et moral très occidental et WASP (white anglo-saxon
protestant). Et représenter en blanc la négation m’a semblé plus
intuitif sur le papier. Il est bien évident que l’expérience est
totalement différente au tableau noir où l’inscription de la négation
exige le moins de travail par opposition au papier où elle demande une
grande quantité de hachures ou de grisage. Mais au-delà de cette
anecdote, je me suis aperçu (à mes dépends en terme de clarté de
l’esprit) que cette convention comportait une sorte de mise en plis de
pensée peut-être aussi importante que la latéralisation chez
l’être humain et qui d’ailleurs pourrait bien l’impliquer.
L’auditeur-lecteur-visionneur (je ne dis pas « voyeur ») devra donc
prendre en compte que l’attention portée à ces schémas risque de
l’entrainer dans une orientation de type neurocognitive peut-être
difficilement réversible s’il est aussi lent et encombré que moi
psychologiquement à s’adapter à ces modèles.
Quoiqu’il en soit, cette difficulté m’a amené à comprendre que les
conventions autour de la question de la valeur symbolique de la lumière
touchent tout à la fois au corps propre, (j’ai toujours eu horreur du
soleil), à l’histoire de la pensée positive à l’issue du siècle des
lumières, mais peut-être dans le même temps à l’orientation politique
neuropsychologique lévogyre ou dextrogyre, si ce n’est même à l’opinion
qui l’accompagne dans le vieux continent européen.
J’en reste donc pour ma part à une vision de la lumière vers le ciel, au
principe d’élévation de la pensée vers les idées abstraites, même si je
prends au sérieux tout l’effort pragmatique allant en sens inverse,
c’est du moins ce que voudra illustrer ici ce schématisme immanent aux
conditions d’éducation et de naissance qui ont fait de moi ce que je
crois être ou son envers.
Cela dit ne nous méprenons pas : ce n’est pas la réalité ni le réel que
je noircis sur mon tableau blanc, c’est le domaine de l’imaginaire.
L’imaginaire est toujours plus ou moins un lieu théâtral et comme la
femme de Freud, un continent noir. Le réel n’a pas de place attitrée
dans ma petite topologie de l’être psycho-politique. Il est comme chez
Deleuze et Guattari un plan de consistance et d’inscription. Il n’y a
pas non plus d’intérieur ou d’extérieur : il y a un sol ou une base
initiale ou archaïque pour les perceptions qui est représentée par le
bas de la feuille ou du tableau et qui est solidaire des phénomènes
imaginaires, de la même façon qu’il y a une partie haute qui représente
les espaces d’émission et de perception des phénomènes symboliques. Il
n’y a pas d’intérieur mais il y a au centre du schéma une structure de
trou, un lieu de passage, un passage impossible qui conduit vers les
horizons infinis du réel, vers les possibilités infinies, vers les
surfaces de liberté absolue sans rapport à l’autre, sans question de
sens, sans attachement, sans que la convention de valeur n’ait plus la
moindre importance.
Logique immanente à la raison Républicaine.
La logique participe de la force et de la nature de la République: elle
est ce par quoi l'homme libre fait valoir sa pensée comme telle.
La logique pure se formule dans les écoles de la République et la
logique appliquée dans les rapports du travail et de la vie sociale et
culturelle.
Mais elles sont bien souvent confondue, le domaine scolaire cherchant à
mimer par ses travaux pratiques les réalité de la position des adultes
et les entreprises faisant par principe référence sans le dire mais en
permanence aux règles du bon comportement scolaire.
Analytique immanente des institutions de la République. Logique (intra-propositionnelle) des prédicats.
Introduction.
Écriture logique. (Mon écriture logique en pratique)
On lira d’une manière générale dans ces écritures (pour me faciliter la
frappe et pour favoriser l’effet frappant de ces sigles) :
V « pour tout »,
E « il existe »,
L « non »,
LV « ce n’est pas tout »,
LE « il n’existe pas »,
F(x) « le prédicat F s’applique à x » .
Carré logique d'Aristote.
Que fut-il en son départ?
VIDEO: 
Disons tout d’abord que peut-être et tout simplement parce qu’il est contemporain et concitoyen de Platon, Aristote mais surtout son carré logique, constitue la raison, en sa naissance, et la République, en sa naissance. Je ne pense pas vraiment rencontrer l’érudit du coin qui me trouvera une république avant Platon. Bien qu’on voit de tout en ce monde.
La
logique
et la raison dans le temps de la naissance de le République sont une
seule et même chose. Aujourd’hui les choses, même communes, ont un peu
évolué.
Mais il faut reconnaître à Aristote (peut-être plus qu’à Platon), le
mérite d’avoir posé un cadre qui a tenu le coup deux mille cinq cents
ans, même si, quoiqu’en pensât Kant, il était erroné.
Aristote a mis en question les modalités de la négation dans le
langage par quatre façon de nier:
contredire,
contrarier,
subcontrarier,
subalterner.
On n’a pas fait mieux jusqu’à Blanché,
et Piaget. Russel et
Witehead ont abordé le problème d’une autre manière, par le discours
sur la logique à la différence des Européens qui se sont intéressés à
la logique du discours.
Aristote n’a jamais
représenté le carré logique : Il l’a seulement formalisé dans les topiques et dans les analytiques,
ouvrages contenus dans l’organon,
avec les réfutations sophistiques, du moins à ce que peuvent en
témoigner les écrits actuellement transmis par la «tradition», pour le
dire vite.
Je présente pour ma part les choses (ces choses) en partant d’un
schéma, d’une «vision spatiale» de la connexion des concepts.
Attention: voir l’orientation
du schéma: Il faut renverser mon schéma d'un cran vers la
droite pour retrouver les commentaires classiquement faits par
Aristote:
|
AFFI |
A |
E |
NE |
DEVIENT CHEZ MOI |
E |
O |
|
RMO |
I |
O |
GO |
A |
I |
Quantification universelle et quantification existentielle sont latéralisées respectivement à gauche et à droite du schéma, de même les négativités et positivités sont respectivement en haut et en bas: ça peut faciliter la lecture et la mémorisation. C’est ce qui m’a manqué au début.
Axe des Psychoses: VIDEO:
La totalité n’est jamais une quantité. Le paranoïaque s’attribue une qualité sans limites: il a toujours raison. Mais c’est en limitant celle des autres : ExLFx, et il prélève son concept de qualité sur la toute qualité des attitudes schizo : VxFx.
La réelle qualité des choses ne peut pas se mesurer. Elle est infinie là où elle se trouve. On voit la relation qui unit le parano au schizo dans un rapport d’antinomie réflexive. Le parano se réfléchit comme quantité sur les caractères du schizo. Le schizo se réfléchit comme qualité par la place que lui laisse le parano dans le monde. Si le paranoïaque pense être son propre moi, le schizo pense qu’il est celui qui est, au regard d’un model connu. C’est une qualité: ça ne se mesure pas.
Axe des Névroses: VIDEO:
Toute méthode nécessite une remise des pendules à l’heure. Il faut dans la névrose définir un commencement. Seul le concept du zéro permet d’engager ce cheminement d’un point à un autre : VxLFx. La relation, elle, exclu tout recours méthodique de cet ordre: il n’y a pas de recette pour s’adresser à autrui. Il faut même pour s’entendre, abandonner toute velléité de repérage chez l’autre. Sans quoi on manipule mais on ne traite pas autrui comme un semblable. L’hystérie ne connaît que ce rapport de renoncement à l’objectivité pour «connaître». ExFx.
Verticalité Piagétienne: VIDEO:
(pourquoi piagétienne ? voir aussi axe immanento-transcendantal)
comme rapport du ciel et de la terre, direction de l’«abstraction» (déterritorialisation de DG), c’est la station debout humaine, l’érection à tous les sens du terme, vers le bas le matérialisme et vers le haut l’idéalisme, ciel kantien des idées, espace de projection de la pure pensée, l’au-delà des religions monothéistes. En bas « affirmo » illustre le pragmatisme inhérent à tous les matérialismes, grecs, français, en passant par celui de Marx et ce qu’il en reste. Le domaine du «réel»? En haut, le ciel kantien des idées et des idéalismes. Le domaine du «vrai». Le domaine aussi de l’inconscient. Pourquoi «piagétienne»: parce que c’est Piaget et lui seul qui a émis cette idée extraordinaire de concevoir une négation complète et une affirmation complète comme formules strictement logiques: celle qui contiennent toutes les autres et qui sous ce titre, orientent toute la structure de la logique occidentale.
Horizontalité Blanchéenne: VIDEO:
(pourquoi
blanchéenne? voir axe nomo-dramatique)
comme
dimension du rapport des êtres, ce que Guattari appelle axe de discursivation,
mais que j’ai aussi fait correspondre avec le rapport mythes et rites
du point de vue anthropologique, ce qui n’est pas si arbitraire que
ça, on me le concèdera. C’est la ligne dans laquelle nous permet de
nous déplacer le langage, horizon réel aussi bien qu’horizon de
pensée, ce qui fait consister un point de vue, et qui n’apparait donc
historiquement de façon structurée qu’avec la renaissance, mais qui
existait déjà en puissance chez Homère, peut-être chez Hésiode. Kant a
très bien illustré dans sa «religion dans les limites de la simple
raison» cette «limitation» qu’impose tout horizon d’existence, qu’on
ne peut pousser plus loin qu’en se déplaçant, dans l’espace ou dans la
métaphore.
L’usage de la quantité partielle et de son exclusion empêche cette
dimension de l’élévation morale ou onirique qui permet de voir les
choses de haut et nous rive au plan de consistance du sol, de la terre
ou de la peau, du corps ou de la surface d’inscription de ce qui se
vit dans une écriture ou dans une lecture, plan d’immanence de l’être
parlant.
Corrélats politiques:
La structure du carré comme illustrant les rapports des personnalités et des psychopathologies, va aussi donner lieu dans le même temps et dans le même mouvement, à une correspondance avec les régimes politiques de l’occident positif, depuis la première démocratie athénienne jusqu’à la sociale démocratie petite bourgeoise libertaire. Voir l’analytique : toute la deuxième partie.
Logique arrondie de
Piaget: VIDEOS: 
 (Malgré sa pratique
du quaterne)
(Malgré sa pratique
du quaterne)
Cette thèse qui m’appartient en propre est issue de ma lecture de Piaget.
Elle s’appuie sur des schémas simples, qui sont aussi bien des images puisqu’il s’agit de cette forme illustrée par des exemples variés comme un diabolo dont la gorge serait infiniment arrondie, une cheminée de centrale atomique, une double courbe hyperbolique, ou bien toute illustration des coniques de Pascal.
C’est une thèse métaphysique c’est-à-dire ontothéologique : elle illustre les conditions géo-topologiques de toute pensée possible comme de toute énonciation possible : comment puis-je dire que je pense ou penser que je parle ?
Il me faut pour cela passer par un canal qui comporte un étranglement, un rétrécissement, celui de la naissance, celui de l’angoisse, celui de la contrainte, celui de l’obligation d’une grosse production avec de petits moyens dans le capitalisme, celui de toute épreuve humaine.
Il me faut tout d’abord prélever sur le champ de l’expérience un ensemble de donnés (que j’écris au masculin). Je l’écris au masculin parce que ces donnés ne sont offerts par personne mais prélevés sur le champ de l’expérience. Ce ne sont pas des cadeaux, pas plus des cadeaux de la vie que des informations du journal télévisé ou de l’INSEE. C’est plutôt ce que Kant a bien nommé le « divers de l’expérience ». Deleuze et Guattari parlent souvent de « soupe primitive » mais ils parlent aussi avec Nietzsche des « eccéités ». N'oublient-ils pas ici la "nature"?
C’est toujours depuis le désordre "naturel" d’un contexte problématique parce que désordonné qu’on énonce quelque assertion que ce soit. Au début, il n’y avait pas le verbe, parce tout être était dans le potage. Mais il y avait la "nature".
A partir de ce bouillon amorphe des faits d’une existence, l’être va chercher des formes ou des formules, des régularités, des repères, et il va faire passer ces donnés à la moulinette de son angoisse et de son désir de connaitre, il va les élever et les entrainer vers le ciel des idées. Il va situer les objets dans des classements à extension universelle et les repérer sur des échelles infinies. La variété infinie des formules linguistiques les plus complexes pour désigner parfois les choses les plus simples, ouvre vers le ciel de tout être pensant les espaces infinis de l’au-delà, de la promesse d’avenir, du champ des possibles, un grand rouleau dans lequel tout est déjà écrit, mais sur lequel l’être pensant peut encore graver son « idée ».
Mais cela va nécessiter une circulation, un passage en flux (voir théorie des flux de Deleuze et Guattari). Leur théorie est d’une profonde évidence et pourtant elle omet le traitement des résistances aux flux, des étranglements, elle omet (ou du moins passe trop discrètement sur) la théorie des turbulences (malgré toutes les références à René Thom) : Là où ça résiste il y a turbulence, le flux laminaire n’est plus possible et la question se pose de savoir si l’on peut toujours « calculer », « prévoir », rationaliser, penser l’évènement, la turbulence, l’irrégularité. Le présent est une urgence. Même l’ennui est une urgence. Une turbulence, un désordre. Il y a aussi quelque chose de civilisé dans le désordre d’une foule. On fait la queue dans l’ordre puis arrivés au passage étroit, tout le monde se bouscule. Que se passe-t-il là où ça passe mal? Comment ça se passe là où cela ne se passe pas comme il faut ? Pourquoi fait-on la queue à l’entrée des lieux de spectacle ? A quoi sert le spectacle ?
On est donc à amené à questionner le phénomène de turbulence là où ça coince dans le matérialisme des flux et on s’en sort difficilement sans une théorie de l’angoisse où un pensée de l’angoisse, qui est déjà angoisse. Voir par exemple l’angoisse du transit intestinal chez les hypochondriaques constipés, voir aussi le rapport psycho-économique entre les consommateurs du potlatch bourgeois et les producteurs de l’économie rituelle du signe liturgique.
J’ai donc proposé dans la ligne de Kant un schéma immanent de toute transcendantalisation possible.
Il fonctionne topologiquement sur la figure du tore qui présente comme « trou » cette structure d’étranglement.
L’être humain se ballade à la surface de sa planète comme un aspirateur à informations. Comme tout animal il recherche des nourritures qui viennent d’en bas mais comme être pensant il recherche aussi des donnés qui viennent d’en haut. L’animal recherche d’ailleurs aussi des données, mais sans l’intention d’en faire une écriture, ou un ensemble de formules littérales, ou un « sens ». L’homme, jamais content de ce qu’il a, recherche pour prendre le terme de la philosophie « analytique » des « expériences de pensées ».
Cette opération constitue donc l’étage supérieur de l’appareil que j’essaie de distinguer dans la nature pensante, mais qui n’est pas forcément seulement humaine. C’est là que se produit un « processus dissipatif » au sens même de Prigogine. Si je dis «étage supérieur» c’est sans intention de favoriser les tendances naturelles de la distinction sociale. C’est un état de fait lié à la loi newtonienne d’attraction universelle. L’élévation et l’abstraction, c’est la même chose. Le matérialisme regarde toujours vers le bas. C’est aussi ce que j’ai voulu illustrer par le schéma que je présente. Bien que ce soit plutôt le schéma qui me le montre. Nous sommes toujours situés au cœur de cette « antinomie-contradiction ».
L’univers des possibilités de pensée ainsi que son lien aux choses du discours, est aussi vaste que l’univers des objets matériels. C’est pourquoi l’être ici s’intègre dans la structure de cette machine pascalienne. Tout changement de cap stipule une telle turbulence. Il en va de même du clinamen des anciens qui interroge ce même «moment» du passage à l’être, à l’existence. Je ne dis pas l’être-là mais l’ « être –ici », parce que dès qu’il est à l’épreuve de la dimension espace-temps, il « s’étrécit » et se confronte à son propre manque. Tout ce qu’a dit Sartre là-dessus dans l’être et le néant est bien-sûr plus probant que le présent propos.
Première partie: Analytique des concepts de la République. Logique des classes en France.
Chapitre I: exposition des concepts purs de la République démocratique:
Les concepts purs de la République sont les fonctions sociales de la
République. Et comme le dit Bourdieu, les fonctions sociales sont des
fictions sociales.
On pourrait dire que c’est aussi tous les produits de la division du
travail tels que les a distingué Durkheim.
Les concepts purs de la démocratie ne peuvent par contre répondre que de
la destruction de la force fictionnelle des fonctions sociales. Il n’y a
de fonction sociale en démocratie que celle du citoyen. Je parle
bien-sûr de la démocratie utopique idéale : celle que voudrait Etienne
Chouard. Mais j’ai peur que nous ne soyons pas nombreux à la souhaiter!
Ces fonctions sociales sont donc adéquates aux fictions républicaines
qui sont utiles pour détrôner les monarchies abusives, les tyrannies et
autres régimes impériaux, totalitaires ou despotiques, mais elles sont
totalement insuffisantes à l’installation du moindre des régimes
démocratiques.
Elles constituent par contre à merveille la structure autoritaire des
régimes oligarchiques que Sartre appelait les « démocraties bourgeoises
», et dont il est inutile de donner des exemples.
Ces concept peuvent se décliner en une séquence rapsodique de règles de
bonne conduite dans le cadre des institution républicaines :
Amour et respect du « sujet » de la République en tant que mineur.
Amour et respect du « citoyen » en tant que tel lorsqu’il accède de
plein droit à ce titre.
Amour et respect de l’ « électeur », organisé par les élus dans
l’intérêt des élus.
Amour et respect des « magistrats », des élus et des fonctionnaires, à
équivalence, pour obtenir des élus qu’ils aspirent à rentrer dans la
fonction publique et des fonctionnaires qu’ils aspirent aux fonctions
représentatives.
Amour et respect de l’ « expertise », mandatée et rémunérée par la
République, et dont l’impartialité ne pose jamais question,
particulièrement à l’endroit de cette dernière.
Amour et respect des « élus » par les élus dans l’intérêt de la
représentation et de la stabilité de la Nation, fût-ce dans l’alternance
qui fait son équilibre.
Enfin:
Haine et mépris du "pervers" en tant que catégorie psychopathologique et
qu'organisateur de pensée sociale et donc politique.
Expertise: Science du réel.
L’expert est censé être expérimenté, participe passé de « experiri » :
il est censé avoir éprouvé les concepts qu’il utilise, ou les objets.
C’est quasiment toujours le cas, et à ce titre on peut se demander à
quel titre je viens lui chercher noise ?
Il n’est pas typiquement un « sujet supposé savoir » car il est souvent
utilisé sur un mode ordalique mais il est toujours un « sujet pensant
savoir » : ce qui le caractérise c’est donc toujours un minimum de
narcissisme épistémologique : L’expert par définition, est content de
lui. Il est une image du narcissisme. Il est peut-être le narcissisme à
lui tout seul.
Ce n’est pas toujours le cas de ses obligés. Sa fonction n’est pas de
convaincre. On lui demande plutôt de la discrétion. Dont il est payé en
retour. Un devoir de réserve. S’il veut garder les reconnaissances de la
République, qui est prête à lui assurer les plus grandes immunités.
L’expert travaille ses dossiers, il s’informe, se tient au goût du jour
: il ne doit jamais paraitre surpris, ou alors, faire lui-même une
partie de l’évènement.
L’expert est toujours une femme ou un homme intelligent, noblesse
oblige. Il n’est par définition pas partisan et sait se tenir loin des
diatribes grossières des partis et de l’engagement. Il sait être discret
et a le sentiment de sa juste importance.
C’est beaucoup en fait car il ignore toujours sa vraie place qui est de
ne servir à peu près à rien, si ce n’est à garantir l’autorité des
dominants et des possédants. Comment pourrait-il en être autrement ?
L’expert sert la République, et ce aussi longtemps qu’elle n’est pas
réellement ou vraiment « démocratique » ou en phase avec ses enfants. Si
elle le devenait, à quoi servirait qu’un technicien s’interpose entre la
volonté commune et la République, ce « cher vieux pays ».
Bien que remontant au XIVème siècle, c’est en fait avec la psychiatrie
que le terme prend au début du XIXème siècle le sens non plus d’une
qualité personnelle du détenteur de l’expertise, mais de fonction
sociale donnant une compétence en droit et particulièrement auprès des
tribunaux. La première expertise à valeur juridique et constitutive d’un
usage social susceptible de faire institution, institution expertale,
est l’expertise psychiatrique, c’elle qui pose dans le champ social, les
limites de la déraison, et qui par conséquent, définit juridiquement
l’être raisonnable, l’être de raison, figure de la bourgeoisie, et
enfant chéri de la révolution bourgeoise.
Cette fonction sociale s’est répandu ensuite en tache d’huile sur tous
les autres sujets de la société dont elle graisse aujourd’hui plus que
jamais les mécanismes juridiques d’institution quand ce n’est pas la
patte des acteurs.
Perversion: Psychologie de l'Imaginaire
« L’insurrection doit être l’art permanent d’une république. » Marquis
de Sade
Perversion, diversion, conversion, aversion, insurrection ! Que penser ?
Comme concept et comme objet, la perversion ne cesse de poser question à
la raison positive, depuis que la tradition intellectuelle
psychiatrique, puis freudienne, en a posé les cadres à la fois dans le
champ expertal du discours du droit, et dans le champ intellectuel
postmoderne du discours freudo-marxiste.
Quand donc commence-t-elle ? Et jusqu’où peut-elle aller ? La seconde
question est plus facile à résoudre : On sait qu’elle n’a pas de
limites. Et on l’a vu. On le savait déjà au XIXème siècle avec les
grandes descriptions de Krafft-Ebing et l’exploitation à des fins «
scientifiques » des productions littéraires d’écrivains comme Sade et
Sacher Masoch. Mais on l’a vu surtout dans le champ de la politique
mondiale lors des conflits mondiaux du XXème siècle, et on le voit
encore dans toutes les nombreuses enclaves et zones de non droit que
génère structurellement le capitalisme concurrentiel financiarisé, tout
autant que dans ce qu’il peut rester des régimes « socialistes » ou «
communiste » dans les enclaves de ce qu’on pourrait maintenant appeler «
l’ancien système ». On le voit aussi depuis le voyeurisme juridique et
expertal issu de la tradition aliéniste et du positivisme républicain
combinés. Par exemple celui de la troisième République française, que la
cinquième a du mal a dissimuler et à maquiller.
La perversion constitue ce champ limitant, et donc non limité, qui
encercle le domaine du raisonnable tout autant que celui de la raison.
Elle s’étend sur tout le domaine de l’irraisonné sans la déraison, tout
l’espace des comportements où les acteurs n’ont à rendre aucun compte,
sans pourtant que leur jugement ne soit altéré. Il n’y a pas de «
symptômes » pervers : il a des comportements pervers.
L’usage du terme comme catégorie ontologique pour décrire un type
d’individu n’est guère pensable avant Sade ou Robespierre. Il n’y a de
perversion possible que dans un République réelle. On voit l’importance
du phénomène de la révolution comme subversion conditionnant de façon un
peu projective la possibilité de l’apparition dans la société des
hommes, d’une nouvelle classe d’individu.
D’un Robespierre ou d’un JB Carrier on dira : « ce n’est pas un méchant,
c’est un pur », nous dit Rosenvallon. Moyen en quoi se dessine une sorte
de partage particulièrement difficile à déterminer entre d’un côté les
psychopathologies avec les psychoses passionnelle notamment, mais aussi
les mystiques, les ascétismes délirants, la manipulation hystérique, les
différents délires de persécution, mais aussi bien le groupe des
schizophrénies et des pathologies dissociatives, et d’un autre côté ce
halo moins « structuré », cette périphérie moins facilement classifiable
des « pervers » et des « psychopathes », ou en tout cas à l’intérieur de
laquelle « tout est permis » d’envisager, toutes les anomalies, toutes
les formes de distance à la norme, toutes les outrances, et où « tous
les coups sont permis ».
C’est peut-être les concepts comme « dissidence » ou « insurrection »
qui portent à réfléchir ce rapport trouble et oh ! combien « constituant
», qui fait le lit de l’apparition du concept de pervers comme
catégorie.
Mais il y a encore « diversion, aversion, inversion » qui posent
question à ce curieux concept … curieux !
La psychiatrie a renoncé à ce « travail » de distinction, en particulier
avec le DSM qui ne sert qu’à ça, mélanger les malades et les pervers.
C’est ce renoncement qu’Elisabeth Roudinesco lui reproche,: que ne
le fait-elle elle, de proposer un système de la distinction?
Représentation: Politique du symbolique.
« La convention est
un abrégé du peuple. ». Au sujet du « despotisme de la
République » : « J’invite le peuple à se mettre dans
l’assemblée nationale, en insurrection contre tous les députés
corrompus ».
Maximilien de Robespierre.
Le concept de représentation se partage en langue française à armes égales entre la représentation psychologique et la représentation politique. Faut-il considérer ces deux sens comme autonomes et indifférents ?
La pensée ne peut se concevoir sans la représentation. La politique non plus.
Une image est toujours une représentation, et une
représentation est toujours une image.
Un signifiant est toujours une représentation, et une représentation est
toujours un signifiant.
Voilà qui règle les différents des linguistes et des sémioticiens.
Une image est toujours une image de chose. Ou de rien. Cela pose la
question du virtuel.
Le virtuel et l’hallucination sont des images de choses qui n’existent
pas. « Illusions » !
Un mot est-il une représentation de chose ou une représentation d’image
de chose ? C’est déjà un vortellung-rapresentant freudien
(c’est-à-dire pour nous « représentant de représentation »,
mais avec deux sens différents du terme), une image littéraire, une
étiquette. Ce que Lacan a écrasé sous le terme global de signifiant.
La représentation comme concept en français doit se partager entre l’imaginaire et le symbolique : il y a comme un feuilletage dialectique des abstractions. Il y a toujours une image qui représente une image, un mot qui représente un mot, un mot qui représente une image, mais il y a toujours aussi des images des mots. Elles peuvent être des images des lettres, ou des mots, ou même des sons.
|
Interprétation à partir du Carré de Descola |
||
|
Analogisme : |
DISCONTINUITES MORALES |
Rationalisme : Un mot représente un mot. (règne de la parole) |
DISCONTINUITES PHYSIQUES |
CONTINUITESPHYSIQUE |
|
|
Animisme : Une image représente une image. (stade du miroir) |
CONTINUITES MORALES |
Totémisme : |
On ne peut donc pas séparer la représentation politique de la
représentation psychologique. Il y a amphibologie dès le départ. Il y a
dès le départ, industrie de la représentation. Il n’y a pas d’artisanat
de la représentation. Pas de corporations de la représentation. Les
francs-maçons ne pratiquent pas la représentation : ils la
favorisent dans leur intérêt de classe.
Il y a plusieurs règnes : celui des mots où la parole se met toute au service du pouvoir, celui des images où les mots servent l’expression du vécu, du sentiment.
En votant pour des représentants quels qu’ils soient, nous sommes nuisibles à nos enfants pour les générations à venir, puisque nous renforçons les figements paranoïaques de la société de concurrence élitiste. Et d’une façon générale pour la santé de la civilisation à laquelle nous appartenons.
Mais on ne peut pas voter pour des opposants réels aux systèmes de la représentation car ils sont toujours comme représentants, dissimulés sous les oripeaux de la modestie populaire, de la gauche morale, de l’antiélitisme d’appareil et de propagande. La seule solution logique et politique est le refus du vote pour des représentants, ce qui est trop facile et trop simplement réalisable pour être envisager dans les conditions techniques de la postmodernité.
Chapitre II: Déduction des idées pures de la République:
Déduction :
Soit ces concepts dérivent par induction de l’expérience de la vie
républicaine moderne, mais ils peuvent être pensés en amont de tout
exercice de la République depuis la simple « imagination politique » des
acteurs, sur la base d’un connaissance historique des régimes politiques
de l’antiquité suffisamment évocateurs et « poussés », ou sur la seul
base des productions spontanées de « l’imagination immanente » à la
République.
Soit ils fonctionnent en vertu d’une adéquation naturelle avec
l’expérience politique. Cela stipulerait une harmonie préétablie de type
leibnizien. Pourquoi pas.
Soit c’est l’expérience qui dérive des concepts et ce sont les idées qui
fabriquent les régimes en fonction d’un imaginaire transcendantal :
C’est un peu l’opinion de Kant. Et ça se défend.
DONC:
Elimination des prolétaires et des schizophrènes au titre de la
prévention des insurrections révolutionnaires sur le mode soviétique.
Elimination des reliquats de la hiérarchie nobiliaire et des
paranoïaques au titre de la prévention contre tout retour possible à
l’ancien régime.
Exacerbation universitaire de la sélection scolaire qui concentre le
pouvoir dans les mains de la bourgeoisie dominante et installée.
Exacerbation populiste des divertissements médiatiques et des jeux
populaires pour maintenir au calme les exploités et favoriser le bon
déroulement des élections des représentants par définition au service
des institutions de la République Bourgeoise.
Travail (Aliénation)
Le sujet du travail est délicat : il est fragile. Le sujet n’est
d’ailleurs sujet que de cela, c’est ce que Lacan n’avait pas intégré à
sa belle théorie. Le sujet de la République travail pour la République
et pour être libre de parler dans la République, ce qui ne se produit en
fait que lorsqu'il arrête de travailler, ce qui met sa liberté en
péril...
La question du travail et la question qui travaille tout l’occident
positif avec une acuité en augmentation tendancielle permanente depuis
les abolitions affichées de l’esclavage.
Le travail reste comme concept, ce qui ne cesse d’être mis à la question
du savoir positif et de la morale politique de la pensée progressiste et
humaniste.
Le concept de travail est soumis de la part des républiques marchandes
(c’est-à-dire non démocratique) au travail institutionnel et commercial
de valorisation, c’est-à-dire d’euphémisation du concept lui-même, de «
travail ».
Je sais combien la sémantique de ces formules contraposées qui étaient
le péché mignon dialectique de Marx, exaspère les penseurs du
positivisme pragmatique adapté au monde libéral. Mais je ne vois pas
comment on pourrait faire sentir autrement, toute la distorsion et la
contorsion que l’idée même de travail dans son acception « moderne » (et
par moderne j’entends ici postérieures aux organisations du servage et
aux féodalités), impose aux travailleurs qui osent se hisser à la
dignité du penser « librement », qui n’est pas obligatoirement le penser
libéral.
Le libéralisme veut offrir à chacun, l’autonomie individuelle et le
droit de vendre à qui bon lui semble, sa force individuelle de travail,
et cela peut sembler de bon aloi sur le chemin vertueux de la liberté.
Mais c’est sans compter sur la fonction nominale négative de ce
signifiant (et je n’ai pas peur d’utiliser ici ce concept Lacanien et
louche), fonction en permanence euphémisée par la logique industrielle
et commerciale de la production des concepts dominants (c’est-à-dire de
« signifiants »).
Essayer de dire plusieurs choses en peu de mots constitue toujours une
présomption qui se trouve disqualifie par les accusations de complexité,
d’intellectualité ringarde ou de lourdeur. Je me soumets volontiers à
cette critique à laquelle je suis rompu et par laquelle je n’ai pas
encore été totalement rompu.
Le travail est exténuant : je veux dire le vrai travail, pas le travail
de représentation. Je ne parle pas des VRP qui sont de vrais
travailleurs au sens plein du terme. Je parle de la représentation
politique : ceux qui ne travaillent quoiqu’ils en disent, jamais, et qui
retirent tous les bénéfices du signifiant « travail », ce sont les
députés lorsque le régime est assis. Ceux de la commune avaient quelques
mérites et même quelques vertus, car ils engageaient leur parole, mais
aussi un courage réel en rapport de causalité réciproque avec l’état
post- révolutionnaire de la Nation. Mais lorsque les groupes en fusion
sont refroidis, lorsque les institutions sont prises en gelée, lorsque
le froid de la réaction fige tous les courages de l’action commune, le
travail redevient un idéal de la raison spéculative républicaine, en
dépit de toutes les nécessités critiques qu’appellent sur lui le bon
sens démocratique.
J’ai prévenu que ce sujet n’était pas simple : il en va de l’idéal de
simplicité comme de l’amour du travail bien fait : ce sont des concepts
doctrinaires ou césaristes : ils amènent à la réaction, ou ils sont
amenés par elle. Dali avait horreur de la simplicité. Pas encore assez
car ça ne l’a pas tout à fait empêché d’apprécier Franco. Mais au moins
il ne nous a pas servi la leçon de l’amour de travail.
A ce sujet il faut marier à la question du travail celle de l’amour. On
ne travaille que par amour, c’est-à-dire que de façon pathologique, au
sens de Kant. Je renvoie au chapitre concerné.
Toute dialectique politique qui refuse de reconnaître dialectiquement le
caractère réellement nuisible du travail comme institution mène aux
totalitarismes.
Famille (Propriété Privée)
En attente
Mais en attendant on peut donner l'adresse de l'article de Lacan sur la
famille écrit en 1938, écrit à la demande de Wallon, publié dans
l'encyclopédie Française, tome VIII, facile à trouver sur le net: voir
http://colblog.blog.lemonde.fr/2011/01/15/jacques-lacan-la-famille/
Patrie (Propriété Publique)
En attente
Chapitre III: Déduction des idées pures de la Démocratie:
Liberté (Isegoria)
La liberté ne peut être liberté que de parler (et d’écrire !), comme
Lacan disait qu’il n’y a d’être que de langage. Ou du moins elle ne peut
être liberté que de la parole qui découle d’une écriture. Il y a
bien-sûr une liberté d’écrire, mais elle n’aurait aucun sens pour celui
qui n’aurait pas parlé
La liberté de se mouvoir, d’aller et venir, de « circuler », et celle
qu’imagine le libéralisme, liberté d’investir son capital au règne d’une
concurrence « libre et non faussée ».
Qu’est-ce donc qui pourrait fausser les règles de la libre concurrence
sinon l’appropriation des monopoles, de la terre, de l’eau, des matières
premières, par les acteurs libres des sociétés qui traitent es agents
comme des objets ?
On voit donc qu’il y a deux libertés : Isegoria et eleutheria :
L’une, modeste, qui traite des conditions de l’accès à la parole dans le
champ politique, et l’autre qui est la liberté de faire selon son bon
plaisir, celle des puissant et du souverain.
Galates 5 : 13 Frères, vous avez
été appelés à la liberté (eleutheria), seulement ne faites pas de cette
liberté (eleutheria) un prétexte de vivre selon la chair; mais
rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.
Pierre 2 : 19 ils leur promettent
la liberté (eleutheria), quand ils sont eux-mêmes esclaves de la
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
Jacques 2 : 12 Parlez et agissez
comme devant être jugés par une loi de liberté (eleutheria),
Kant qui a permis de penser la liberté comme culture. Mais en oubliant
que la culture est aussi un commerce.
Egalité devant la loi (Isonomia)
La loi est la même pour tout le monde. Elle est simplement un peu plus clémente pour les neveux du ministre, pour les copains du maire, pour les héritiers des grandes fortunes. Selon que vous serez puissants ou misérables, ...
Fraternité (Isocratia)
En attente
Deuxième partie: Analytique des principes Républicains: Logique du rapport des classes, donc Logique de relations.
Chapitre I: Du schématisme des idées de l’entendement Républicain.
81 concepts intro
Mes 81 concepts à principe de validité universelle seront sans doute
arbitraires : ils prétendent cependant à une cohérence, voire à une
certaine complétude et exhaustivité. Mais soyons modeste : la machine
est trouée en son centre, et ses bords extérieurs chutent dans le vide
sidéral de l’univers symbolique et imaginaire des représentations
possibles : ici ce sera «symbolique» vers le haut, et «imaginaire» vers
le bas, ce qui n’est pas entendu comme évident pour tout le monde.
90 traits de l’être : Mais ces 90 concepts destinés à caractériser les
traits possibles de l’être quel qu’il soit (pas forcément humain !)
seront tous «cernés» par leurs concepts limitrophes ou par les deux «
trous noirs » pour reprendre une métaphore pas si métaphorique que ça,
telle qu’elle fût contestée à Deleuze et Guattari par Alan Sokal et le
tout jeune encore Jean Bricmont dans les années 1996-1997. Tomber dedans
et tomber dehors, c’est toujours tomber. C’est en cela que mon schéma
est « topologique ». Et encore se posera-t-il tout au long de cette
présentation, la question de savoir si l’on est à même de distinguer le
dehors du dedans et inversement.
Ces catégories m’ont été au départ inspirées par les problèmes de la
psychopathologie, mais le propre de ce que j’ai développé à partir
d’elle, c’est un ensemble de correspondances bijectives avec les
concepts ou les catégories de la tradition philosophique ou politique,
puis avec les éléments de la logique (des classes, des relations, des
prédicats et des propositions).
Par psychologie ou psychopathologie j’entends l’ensemble des rapports au
symbolique.
Par philosophie ou politologie j’entends l’ensemble des rapports à
l’imaginaire.
Par logique d’une manière générale j’entends l’ensemble des rapports au
réel.
L’ensemble des catégories ou des éléments de catégorisation élaborés
dans cet ouvrage a pour finalité de parcourir une structure du
schématisme de l’entendement partagée par le plus grand. Il n’est donc
pas aliéné à l’usage de la seule langue française bien que je n’en
connaisse pas d’autre efficacement.
La mise en évidence de cette forme ou de cet agencement princeps et
collectif n’a pas pour seul but la production esthétique de grilles de
lecture. Elle induit un jugement de société qui aboutit à une sorte de
programme politique proposé non pas au vote puisqu’il s’agit un peu de
se débarrasser de ça, mais à la réflexion sur le fait politique dans la
chose politique par l’être politique que réalise chaque psychologie
individuelle : comment penser, mais aussi comment échanger les concepts
de la République ?
Axes du schéma
L’axe vertical du schéma semble facile à penser. Personne ne confond le
haut et le bas comme on peut confondre sa droite et sa gauche.
La droite et la gauche conditionnent la possibilité d’une écriture et
d’une chronologie : c’est l’axe du temps comme dans le classique «
repère orthogonal» du cours de math.
L’axe du ciel à la terre a été très largement exploité métaphoriquement
par les religions monothéistes. C’est l’axe de l’espace. Il conditionne
de façon particulièrement déterminante le sentiment d’intériorité
: il pose une intimité vers le bas et une transcendance idéale du sujet
vers le haut. Le dehors est toujours un endroit qui se trouve à ciel
ouvert. L’intime nous rapproche toujours du sol et du territoire.
On ne peut pas penser l’envol ou l’élévation sans un sentiment de la
gravitation universelle autrement que depuis un objet sol dans
l’assiette duquel on ne peut que se sentir inclus. Remettons en scène le
texte fulgurant de Kant dans la CRP :
«De l'impossibilité où est la raison pure en dissension avec elle-même
de trouver l'apaisement dans le scepticisme» :
«Quand je me représente (suivant l'apparence sensible) la surface de la
Terre comme une assiette, je ne puis savoir jusqu'où elle s'étend. Mais
l'expérience m'apprend que, où que j'aille, je vois toujours devant moi
un espace où je puis continuer de m'avancer, par conséquent je reconnais
les bornes de ma connaissance chaque fois effective de la Terre, mais
non pas les limites de toute description possible de la Terre. Mais si
je suis allé assez loin pour savoir que la Terre est une sphère et que
sa surface est une surface sphérique, je puis alors connaître d'une
manière déterminée et suivant des principes a priori, même par une
petite partie de cette surface, par exemple la grandeur d'un degré, le
diamètre de la Terre, et, par ce diamètre, la complète délimitation de
la Terre, c'est-à-dire sa surface ; et bien que je sois ignorant par
rapport aux objets que cette surface peut contenir, je ne le suis pas
cependant quant au périmètre qui les contient, à sa grandeur et à ses
bornes.»
Un peu plus loin dans la « Dialectique transcendantale », Kant précise
ce qui différencie « borne » et « limite» :
« Toute ignorance est ou bien ignorance des choses, ou bien ignorance de
la détermination et des limites de ma connaissance. Or, quand
l'ignorance est accidentelle, elle doit me pousser, dans le premier cas,
à rechercher dogmatiquement les choses (les objets), et dans le second,
à rechercher de manière critique les limites de ma connaissance
possible... La détermination des limites de notre raison ne peut se
faire qu'à partir de fondements a priori, mais nous pouvons reconnaître
aussi a posteriori qu'elle est bornée, encore que ce ne soit là qu'une
connaissance indéterminée d'une ignorance qu'on ne supprimera jamais
entièrement, reconnaître, dis-je, qu'elle est bornée, grâce à ce qui
dans tout savoir, nous reste toujours encore à savoir. »
Les deux axes orthogonaux du schéma sont donc dans le vocabulaire de
Kant ceux du temps et de l’espace, des deux catégories pures de la
sensibilité, par opposition aux deux axes obliques qui supporteront ici
plus volontiers les catégories d’objet (ou de sujets puisqu’à ce stade
du développement des concepts, c’est la même chose). Je ne peux
penser un objet que pour autant que j’accommode ma subjectivité aux
conditions de sa donation. C’est ainsi que la révolution
copernicienne de Kant nous impose sa règle : un usage régulateur
de ma conscience et non un ensemble de règles déterminantes
universellement valides. Ce n’est que mon sens moral qui tentera
de raccorder ma contingence existentielle aux nécessités
transcendantales d’une pensée aspirant à l’universalité, c’est-à-dire à
être partagée par le plus grand nombre.
Axe horizontal nomo-dramatique
L’axe horizontal de mon schéma, celui dans lequel l’être personnel se déplace, est représenté par l’axe nomo-dramatique : C’est celui qui va du rite au mythe et de la loi au récit. C’est l’axe de discursivité pour Guattari tout comme c’est l’axe du temps, par opposition à celui de l’espace qui va sur le schéma topologique de l’être de haut en bas.
A droite le récit de la passion, l’histoire des
demi-dieux, les mythes fondateurs et le récit des origines, la rapsodie.
A gauche la loi et la règle fondatrice, celle des Saints, François,
Benoît, Ignace de Loyola, puis celles des Républiques, constitutions de
l’être suprême : la loi, l’ordre, la liturgie, les livres
fondateurs, les codes, les index, la structure.
Axe diachronique de la parole, du chant, de la
musique, on peut aussi dire qu’il est une sorte d’axe du temps,
dimension temporelle dans un repère orthogonal sans origine.
Le croisement des axes n’autorise aucun « zéro ».
Pas plus qu’on en trouvera
comme possibilité sur l’axe vertical, immanento-transcendental.
|
Liturg juridiq |
Lymphat |
Apragma |
Léthargie |
Mœurs |
Frénésie |
Hypochdr |
Sanguin |
Epop Myth |
L’un des paradoxes de cet axe figure ici avec les positions politiques de la gauche et de la droite et réciproquement : cela nous rappelle combien ce vocabulaire est arbitraire et doit donner lieu en toute situation à une dialectique qui est à proprement la dialectique du politique : la partie à ma gauche est la droite du schéma et inversement. La subjectivité, le sens de lecture, l’orientation sont ici en question. Toute la question du sens y est impliquée. On y voit figurer toutes les formes littéraires de l’occident.
Je l’ai nommé « nomodramatique » par référence au cours de Stéphane Chauvier (Université Paris – Sorbonne) au Collège de France le sous la direction de Jacques Bouveresse.

Insistons sur le fait qu’à cet étagelogique (car c’est un « étage dans mon schéma), les expressions «ou» et «et» signifiés par le point, ont une signification confondue, qui peut aussi bien s’appeler « ou bien ».
Axe vertical immanento-transcendantal
Beaucoup plus facile à concevoir et à penser que l’axe nomo-dramatique,
celui-là organise l’espace, la hiérarchie, la religion. Il est l’axe de
l’en-deçà à l’au-delà. Il évoque pour l’être humain le concept
anthropologique de Leroi-Gourhan du redressement humain, avec la
libération de la main, l’opposition du pouce. L’une et l’autre ont
permis l’invention de l’outil et celle de l’écriture. Mais avec aussi
tout un tas d’autres corolaires tout aussi fondamentaux : l’exposition
du sexe à la vue, la simplification du « pas », la latéralisation
impliquant le rapport à l’autre par « embrassement », sans compter
l’embarras des bras, l’exposition du corps humain au projectile,
l’élévation du regard au-dessus du sol permettant de dégager un «
horizon » et une « assiette » existentielle. On pourrait en dire encore.
Cet axe est bien sûr aussi directement lié au système des astres :
astrologie-astronomie, des médecins grecs et néoplatoniciens à Copernic,
Galilée, Kepler, Newton, Einstein.
C’est aussi ce que Deleuze et Guattari ont désigné comme dimension des
opérations de « territorialisation-déterritorialisation » avec tous les
attendu d’une telle conception, qui sont innombrables et obligent à
revisiter de fond en comble l’espace humain, son sol, sa maison, son
ciel. Du pragmatisme le plus terre à terre aux idéalismes les plus
éthérés, au ciel kantien des idées, les outils et machine de guerre et
de production, autonomisent du sol et se détachent du sol. Phyllums
rhizomatique et constellations d’univers chez Guattari, depuis les flux
énergético-signalétiques et les territoires existentiels.
Se tenir debout ne va pas sans cet alourdissement de ce que Lacan
appelait « l’immaturation constitutionnelle du petit d’homme ».
Immaturation qui fait notre force et notre faiblesse. Notre aptitude à
la chute tant exploitée métaphoriquement par l’ancien testament.
- Plan du plan: VIDEO: Plan kantien à géométrie assez peu variable:
- Introductions:
- Esthétique immanente des éléments
psycho-sociaux: Condition de la sensibilité permettant de
concevoir la chose publique, et donc conditions de possibilité de
l’expérience collective:
- Introduction:
- Section I: VIDEO: L’espace psycho-social partageant. Conditions géographiques de la conception publique.
- Section II: VIDEOS: Le temps du sujet psychosocial partagé. Conditions historiques de la conception publique.
- Conclusion : De l’histoire-géographie comme condition de toute République.
- Convention de valeurs logiques.
- Logique immanente à la raison
Républicaine.
- Analytique immanente des
institutions de la République. Logique
(intra-propositionnelle) des prédicats.
- Introduction.
- Première partie: Analytique des concepts de la République. Logique des classes en France.
- Deuxième partie: Analytique des
principes Républicains: Logique du rapport des classes,
donc Logique de relations.
- Chapitre I: Du schématisme
des idées de l’entendement Républicain.
- 81 concepts intro
- Axes du schéma
- Axe horizontal nomo-dramatique
- Axe vertical immanento-transcendantal
- Oblique Psychotico-psychologique
- Oblique Névrotico-politique
- Coin exhibitionniste des oligarchies électives séductrices
- Coin hystérique des oligarchies électives sincères
- Coin masochique des anarchies
- Coin obsessionnel des oligarchies sélectives honnêtes
- Coin parano des monarchies et des empires
- Coin sadique des tyrannies et des despotismes
- Coin schizo des démocraties non représentatives
- Coin voyeur des oligarchies sélectives autoritaires
- Côté lymphatique des oligarchies humaniste et religieuses
- Côté mythique des états religieux exploitant le récit
- Côté rituel des états religieux autoritaires et figés en sectes ou en églises.
- Côté sanguin des monarchies parlementaires électives
- Structure en X
- Clavier des intempérances et des «positions» républicaines.
- Chapitre II: Du système des idées de la république vu au travers des catégories de Piaget.
- Chapitre III: Du principe de la distinction des compétences républicaines en «sélectives-expertales» et «électives-spectaculaires».
- Chapitre IV: Du schématisme de l’entendement concernant la chose sexuelle.
- Chapitre I: Du schématisme
des idées de l’entendement Républicain.
- Synthèses schismatiques immanentes
aux institutions de la République. Calcul des propositions.
- Première partie : Des paralogismes de la pensée républicaine.
- Deuxième partie : Des antinomies de la raison républicaine.
- Troisième partie : Solution critique de ces antinomies : La démocratie.
- Quatrième partie : L’idéal de la raison républicaine : perdurer, être soi. Raison=République.
- Cinquième partie: VIDEOS: Des mobiles de la République. Examen critique de l'analytique. De la non existence des névroses et des délires chroniques, et donc de la «raison» républicaine.
- Sixième partie : De la suprématie de la Démocratie dans sa liaison avec la République.
- Septième partie : L'existence de la liberté comme postulat de la raison républicaine.
- Amphibologie des concepts de la République: Travail et liberté, famille et fraternité, patrie et égalité. (Tab Blanché)
- Mon amphibologie volontaire des niveaux et des plans de lectures des phénomènes psychologiques et politiques.
- Analytique immanente des
institutions de la République. Logique
(intra-propositionnelle) des prédicats.
- Méthodologie:
- Méthodologie de la République.
- Chapitre I : La discipline. (Platon) (Hegel) (De Gaulle) Constitution.
- Chapitre II : Les canons.
- Chapitre III : L’architectonique. Rigidité de la structure : la domination de la pensée bourgeoise.
- Chapitre IV : Les chantiers républicains de l’Histoire. La IIIème République et le devoir de mémoire.
- Chapitre V : Euphémisation (et amphibologie?)
- Chapitre VI : Ne pas répondre.
- Chapitre VII : Scandale.
- Chapitre VIII: Représentation méthode.
- Méthodologie de la Démocratie.
- Méthodologie de la République.
- Travaux Pratiques au sujet de Jean Rodriguez : 9 VIDEOS
- Hommages:
- Conclusions
- Epilogue
L’homme s’élève au-dessus des autres animaux quand il ne monte pas
dessus, les rabaissant à l’usage d’instruments. Et lorsqu’il les élève
aujourd’hui c’est en batteries.
C’est l’axe de l’espace et non pas celui du temps.
Oblique Psychotico-psychologique
L’axe oblique montant sur mon schéma de droite à gauche depuis la fange
matérielle et matérialiste de la base vers les évidences simplissimes de
la monarchie idéale du moi constitue l’axe du pur politique et du
psychologique tout à la fois. Il oppose de façon radicale deux
conceptions du monde en apparence totalement antinomiques mais qui sont
aussi dans un rapport évident de complémentarité anthropologique. C’est
l’axe de la folie politique, du tout ou rien, l’axe de l’histoire longue
sans considération du social, sans en passer même par la question de la
représentation.
C’est aussi le trajet sans compromis et sans représentation des peuples
à leur souverain, l’objet univoque des anthropologues, l’espace immédiat
de la tradition orale, des peuples « sans écriture », un monde sans
capital et sans travail, le maître et l’esclave. Un monde dans lequel la
liberté et entière et non problématique : le monde de la psychose. Le
chef, le roi, a toujours raison. Nul esclave ne peut travailler à son
rachat. Savoir absolu de l’esclave et féroce ignorance du chef.
Puissance et simplicité des archaïsmes. Sade, Jésus, Hitler, Gandhi.
Cet axe va directement du passé au présent sans même s’encombrer des
nécessités de la raison, et a fortiori de la raison républicaine. La
République implique le social et ses corollaires que sont le travail et
le capital. Le monde de la psychose est en général enfermé ou décapité
par la République. La raison, et a fortiori la raison positive tente
d’interrompre cette naturalité monarchique dont on retrouve la trace
dans toute la sphère de l’anthropologie même la plus évoluée :
Lévi-Strauss, Bataille, le Quai Branly,…
Oblique Névrotico-politique
C’est pour parler comme Hegel le « moment du refoulement ». Une sorte
de Hegel freudien.
Ce moment ne peut pas se concevoir sans le précédent, le moment «
psychotique», parce que le schéma que je présente s’est progressivement
ouvert à l’échelle des temps historiques de l’occident positif. Il y va
de la mise en place de la raison et de la fondation d’une République
idéale, que j’écris ici avec une majuscule, celle qui, dans toutes ses
formes, fait l’objet de cette critique.
Le danger réside par la mondialisation dans l’aplatissement en sens
inverse de la structure sur cet axe de la névrose avec un oubli non pas
de l’être comme le craignait Heidegger tout en l’oubliant de fait
pragmatiquement, mais l’oubli du monde et notamment du monde politique.
Rosanvallon distingue sans fin le « social » du « politique » : cet axe
matérialise celui du seul rapport social et du seul jeu social au
détriment de tout jeu d’implication politique réelle.
On pourrait d’ailleurs dire aussi que c’est « l’axe de l’autre », mais
sans référence moralisante pour nous tenir à distance de Georges Bush.
Ce n’est pas plus que l’autre l’axe du bien ou celui du mal. Le
refoulement n’est pas une catégorie de la morale. Dans toutes ses
formes, il peut être favorable ou nuisible selon le contexte : depuis la
résilience ou la castration structurante, jusqu’à l’oubli de l’être
sus-cité dont on a vu les effets.
L’axe de la névrose est celui du montage « industrie-travail-capital »,
quelle que soit la date à laquelle on situe son origine. De fait dans le
mot comme dans la chose, on peut considérer que ce montage est celui de
la République. Je sais que cette équation fera jaser les bonnes âmes
universitaires. C’est aussi leur manière de rester dans une critique qui
n’écorne pas leur propre autorité et donc leur propre légitimité.
Coin exhibitionniste des oligarchies électives séductrices
On pourrait dire du fascisme qu’il est l’amour en commun de l’autorité
: on pourrait auusi le dire de l’hystérie !
L’exhibition n’est pas la monstration : elle ne montre pas ce qu’elle
dégage : elle le soustrait, littéralement, elle le dérobe. Ou plutôt
elle en épuise la valeur en un flash. Elle brule. Elle consomme. Elle
perce, désarticule, crève le ballon de baudruche de la valeur. Exhiber
c’est rompre le charme.
C’est donc l’attitude pervertie d’un « sujet » isolé pour ne pas dire
solitaire, mais c’est aussi bien la mise en société de l’indicible du
manque et de la castration de l’être social là où il est le moins
entendu, le moins compris.
L’exhibition condamnable procède de l’honnête hystérie par empêchement
ou par facilité : comme tout système pervers d’expression, elle se
dégage à partir des règles de la structure psychopathologique de
référence qui lui correspond dans mon schématisme de l’entendement
immanent aux sociétés de l’occident positif.
Mais encore une fois ici, le dé-bobinage pervers de la structure
concernée ne se réalise pas que dans le champ psychologique et
psychopathologique, puisqu’il implique en même temps le fonctionnement
des structures politiques, à un autre niveau mais dans le même
mouvement, au niveau de la chose collective : et c’est alors le montage
fasciste qui s’élabore : le spectacle généralisé de la jouissance
généralisée et de la violence généralisée : les jeux du cirque (mais
aussi bien ceux du stade), la télé, la société du spectacle.
L’exhibitionnisme n’est pas qu’une histoire de petit jardin et de sortie
d’écoles. Il y a aussi ce rapport tenu et tendu du politique et des
média, la question de la politique spectacle, la non séparation avec ce
quatrième pouvoir dit « médiatique» que ne connaissaient ni Aristote ni
Montesquieu.
Le fascisme ne fonctionne qu’à base de spectacle (il n’est que de voir
sur ce sujet ce « film évènement » qu’à sorti en France Pier Paolo
Pasolini en 76), qu’à base d’exhibition consenties ou arrachées, qu’à
base de violence collectives et individuelles imposées par un pouvoir
autoritaire toujours à la fois voyeur et dissimulateur, et qui éduque le
prolétariat à l’exhibition consentie, celle qui commence avec la musique
militaire, la récitation pétainiste en classe, le déferlement des
houligans dans les stades d’Angleterre et d’ailleurs. Il y a toujours
cette dimension du regard et du regard collectif. (Voir aussi « Une
journée particulière » d’Ettore Scola avec Sophia Loren et Mastroianni.
Il y a tout ce jeu ambigu de l’exhibition et de la dissimulation qui est
le propre de ce que pratique le régime fasciste et de ce qu’il impose à
ses sujets. Notons qu’on retrouve ce même porte-à-faux dans toute la
frange « spectaculaire » et particulièrement « médiatique » dans
l’occident capitalistique libéral libertaire libertin. On en voit jouer
aussi toute la puissance de facticité dans ce rapport au « public » du «
représentant » potentiels ou patenté lors de cette orgie de sentiments
et d’opinion que constitue avec la permanence du « gardien »
platonicien, la « campagne électorale ».
***
C’est donc bien l’apparition de cet axe diagonal de la « névrose », « «
simulation-dissimulation » comme disait Bruno Etienne, mais surtout
cette dialectique d’autorité qui passe par l’in-compossibilité
structurante « élection-sélection », c’est cet écartement relativement
récent dans l’histoire de la raison positive, qui a rendu possibles des
régimes d’une nocivité dont les plus redoutables empire n’ont pas été
capables.
Je développe ces points pour bien relativiser la pensée simpliste qui
consisterait à poser « sadomasochisme »= perversions graves et «
exhibitionnisme-voyeurisme »= perversions bénigne, et cela de la même
façon qu’il conviendrait de penser la névrose comme une forme bénigne de
la psychopathologie, et la psychose , une forme grave. C’est pourtant
ainsi que les innombrables prétendants à la « normalité » (Onfray
en tête), se sont toujours défendu d’appartenir à la classe
hyper-stigmatisante des psychotiques, que pourtant la plupart du temps,
ce soit cette structure-là qui les soutient.
Coin hystérique des oligarchies électives sincères
L’hystérie n’a pas vraiment d’âge mais elle caractérise l’occident, de
même peut-être que l’intérêt porté au sexe d’une manière générale. Elle
a par contre évolué dans le sens de la chronicisation, et elle n’a pris
sa forme « psychologique » qu’avec le dégagement progressif l’émancipant
de la pensée religieuse survenue entre le moyen-âge et les lumières :
elle ne peut réellement constituer un « trait de personnalité » qu’avec
la reconnaissance du sentiment comme caractéristique de l’animal bipède
sans plumes. Je ne parle pas de son langage.
Elle constitue avec manie et mélancolie les seuls termes de la
nosographie psychiatrique à avoir franchi le mur de la modernité, mais à
la différence des deux autres, elle n’a pas conservé intégralement son
champ sémantique mais l’a altéré (ou du moins elle l’a fait évoluer)
dans le sens de la constitution progressive d’un concept de personnalité
(différent de celui des tempéraments), qui n’était pas envisageable pour
Hippocrate ou même pour Galien, et ne le sera pas avant La Bruyère ou
Pascal, et les « moralistes français ». Car on pourrait dire que le «
caractère » constitue la forme de passage entre le tempérament et la
personnalité. C’est la « peinture de l’esprit » qui fige en caractère
puis plus tard en « personnalité » ce que l’on peut dire d’une personne.
C’est donc de l’hystérie « moderne », « personnalité » normale ou
pathologique que je traite ici et non de ce tableau presque éthologique
de l’antiquité qui avait sans-doute en partie pour fin de reléguer le
sexe faible à sa juste place, celle des contorsions, des incohérences et
du « maniérisme ». On peut d’ailleurs peut-être aussi faire remonter en
Italie l’hystérie personnalité à la naissance de ce « mouvement » et de
cet art de la « manière » de représenter les sentiments et les émotions
qui n’est présent nulle part en Europe dans les pratiques antérieures.
L’hystérie constitue donc un « tableau » ou une « représentation
permanente » où la théâtralité se conjugue avec l’hyper expression,
voire le forçage des traits. Elle a tendance à faire exister l’espace
social comme une « scène », elle fabrique des contextes collectifs dans
lesquels elle crée l’ « émotion » partageable et donc presque
obligatoirement partagée. En amont de tous les gens de théâtre, elle «
met en scène », produit le sens collectif et parfois même commun, et on
peut dire dans une certaine mesure qu’elle « fait l’évènement ».
Au plan de la psychopathologie, elle constitue la position où une
personne se prévaut de son appartenance au clan, au totem, à la famille.
Elle occupe donc sur mon schéma la place proche du terrain qui vise les
conditions du « récit », l’endroit où l’on peut dire qu’il existe un
héros, au moins un, qu’il existe un but, un désir, une finalité, une
croyance : ExFx
Coin masochique des anarchies
En regard du sadisme comme perversion de l’individualité ou du régime
paranoïaque monarchique, le masochisme réalise la pente naturelle
perverse de la schizophrénie ou de la personnalité schizoïde.
Commentons au passage le fait que je ne distinguerai jamais dans ces
propos le « syndrome typique de la maladie » de la forme « personnalité
» comme le fait toujours la psychiatrie traditionnelle pour ne pas dire
un peu réactionnaire, aujourd’hui enterrée par le DSM, pour la bonne
raison que je ne crois pas à la consistance autre que socio-génique de
ces affections (je développe ces thèses dans « De la non-existence … »).
Je rappelle aussi à cet endroit combien le Christ représente pour moi le
paradigme fait homme de la schizophrénie comme concept, et comment ce
qui dans son « histoire » (à tous les sens du terme), se termine dans
une attitude qui peut faire penser à un scénario masochique, là où au
contraire, il stigmatise par excellence la position d’une recherche
inconditionnelle du vécu collectif « démocratique », sans bien-sûr
aucune référence à ce terme corrompu de la tradition aristotélicienne,
mais en référence à un idéal du « bien vivre ensemble », qui ne peut se
réaliser ici-bas et idéalement que dans un collectif schizo de schizos
et pour schizos.
La réelle dégénérescence du concept donc, qui ne peut aller pour moi que
dans le sens de l’ « anarchie », concept absolutiste et incompatible
avec le projet d’organisation démocratique, reste donc cependant accolée
à celui-ci de par cette nécessité de la suppression tendancielle de
toute autorité, qui en fait supprime dans l’anarchie toute souveraineté
et toute autorité en fantasmant là un ordre transcendantal inhérent à
une sorte de nature humaine égalitaire et pacifiste dont on ne voit pas
les preuves de l’existence se confirmer tous les jours. Cela stipule une
dose de naïveté que seul permet la consistance animiste de ce quadrant
dont on rappellera la logique formelle affirmative:
VxFx autrement dit « tout va bien ».
Père, pardonne-leur ! Ils ne savent pas ce qu'ils font. (Luc 23,33-34)
Coin obsessionnel des oligarchies sélectives honnêtes
Choisir, classer, éliminer, sélectionner, ranger, toutes ces attitudes
sont celles de l’obsessionnel aussi bien que celles du gouvernement ou
de l’institution sélective au service de l’oligarchie représentative.
C’est la même chose. Il y a toujours une méthode d’emboitement pour se
retrouver dans la soupe primordiale des évènements et s’y retrouver,
pour se sentir appartenir ou ne pas appartenir à des catégories plus
fines que celle du clan ou du totem, celle de la classe, celle du tabou.
Rhizome des possibilités et des impossibilités kantiennes, encadrement
du possible, sélection par l’exclusion des faits et des êtres «
acceptables », élimination des insuffisances, des défauts d’aspect, des
impuretés, voire d’une catégorie stigmatisée, et stigmatisante lorsqu’on
passe au correspondant pervers extérieur voyeuriste avec les sociétés de
surveillance.
L’obsession est une modalité du penser comme la sélection est une
modalité du gouvernement. On ne peut plus s’arrêter. Il faut toujours
aller vers la pureté, vers le simple, vers le seul, vers la misère. Elle
a une valeur pratique par sa tension d’adaptation vers les réseaux
matériels et symbolique disponibles. Elle réalise les conditions de la
pensée que Philippe Descola appelle « analogiques », c’est-à-dire ce qui
a fait la grandeur de la renaissance en Europe : la constitution du
catalogue de toute connaissance possible, le rangement et le classement
par emboitements de l’herbier, de la botanique, de la zoologie, qui
commence avec les « cabinets de curiosité », les « jardins des
plantes », les « histoires naturelles » (Aldrovandi, Descartes,
jusqu’aux anthropologies de Linné et Buffon, et même jusqu’ à Darwin, en
passant par Lamarck).
La pensée obsessionnelle est déterminante de la constitution de toute «
science » même si elle n’en réalise qu’une condition nécessaire et non
suffisante. Il faut pouvoir dénommer les objets ou les « numéroter »,
avant de les mesurer, de les peser, de les « évaluer » dans un processus
scientifique qui ne pourra tendre après cette étape qu’à l’instable
équilibre idéal et idéaliste réalisable entre cette position et
l’outrance des certitudes paranoïque que toute science est susceptible
de produire comme conclusion d’un parcours au départ modeste et
méthodique faute d’être « terre à terre ».
Cette pensée fonctionne par négation et par élimination principielle,
par le doute hyperbolique :
VxLFx
Coin parano des monarchies et des empires
« Dans la région la plus sombre du champ politique, le condamné est celui qui dessine la figure symétrique et inversée du roi.» M. Foucault Surveiller et punir P 33
A l’angle supérieur droit du schéma que je présente avec présomption mais nécessité, s’applique la forme totalisante royale du pouvoir absolu confiné dans les mains d’un seul individu (ou d’un seul groupe très restreint, « consulat », gente, mais ces modèles n’ont jamais fonctionné autrement qu’en « montant au pouvoir » une « personnalité » en général hors du commun, à tous les sens du terme).
C’est la case de l’autorité incontestée et du « culte de la personnalité » que Khroutchev reprochait si innocemment à Staline. (Voir texte)
Le pêché mignon qui préside au sentiment de persécution paranoïaque est le même que celui qui organise dans la collectivité humaine le dictat d’un seul aux fins de la conservation du groupe. On pourrait penser qu’il n’y a aucun rapport entre ces domaines psychique et collectif. Sauf que le « condamné » de Foucault représente une classe, une catégorie de déviants, de malades, d’anormaux, que le traitement normatif va remettre en conformité avec le corps social. Il est nécessaire pour que la figure du souverain soit royale et monarchique, incontestable et incontestée.
C’est le propre de la pensée structurelle et critique de Foucault et de ses contemporains, que d’avoir opéré cette confusion, Kant aurait dit cette « amphibologie », entre le monde intérieur du psychisme et le monde extérieur de la société avec ses problèmes politiques.
Il y a une position logique de la toute positivité du monarque ou du chef, et de la toute négativité de ses antinomies ou de ses ennemis (voir par exemple le supplice de Damien qui inaugure le livre cité).
Pour Lacan le paranoïaque est celui qui croit être lui-même. Il dit : « Je suis moi ».
Hypertrophie du moi, psychorigidité, fausseté du jugement. C’est donc la définition du terme historique de paranoïa en psychiatrie.
Cette position logique, c’est la négation du particulier, la désignation du persécuteur, ExLFx.
Coin sadique des tyrannies et des despotismes
"A l'origine de l'humanité, il y
avait deux catégories de gens : ceux qui se vouaient à l'agriculture
et à l'élevage, et puis ceux qui étaient bien obligés de protéger les
premiers, parce que les animaux sauvages et féroces risquaient de
manger les femmes et les enfants, détruire les récoltes, dévorer les
troupeaux, etc. Il fallait donc des chasseurs, des chasseurs destinés
à protéger la communauté des agriculteurs contre les bêtes fauves.
Puis, il est venu un moment où ces chasseurs ont été si efficaces que
les bêtes fauves ont disparu. Du coup, les chasseurs sont devenus
inutiles, mais inquiets devant leur inutilité, qui allait les priver
des privilèges qu'ils exerçaient en tant que chasseurs, ils se sont
eux-mêmes transformés en bêtes sauvages, ils se sont retournés contre
ceux qu'ils protégeaient. Et ils ont, à leur tour, attaqué les
troupeaux et les familles qu'ils devaient protéger. Ils ont été les
loups du genre humain. Ils ont été les tigres de la société primitive.
Les rois ne sont pas autre chose que ces tigres, ces chasseurs
d'autrefois qui avaient pris la place des bêtes fauves, tournant des
premières sociétés." Les Anormaux, Michel Foucault, éd.
Gallimard Le Seuil, coll. Hautes Etudes, 1999, Cours du 29 janvier 1975,
p. 89
Comme le mythe freudien de la horde primitive, celui de Foucault a une
certaine apparence de simplicité ridicule, mais son irréalisme dissimule
une force mythique d’explication qui ne peut pas être totalement déniée.
On se dissipe ici vers les constellations d’univers dans des espaces
aléatoires de possibilités infinies que suscite la structure perverse.
Le sadisme n’existe que depuis Sade ce qui n’exonère ni Caligula ni
Néron de pouvoir être subsumés sous ce concept. Il date de Sade en tant
que concept, ce qui nous rappelle que les objets existent avant les
concepts qui les désignent. D’autre diraient que l’existence précède
l’essence.
On voit bien comment l’histoire du monde politique a du asseoir
l’apparition des monarchies sur des comportements de violence sans
limite et de pratiques inconditionnelles du pouvoir.
On voit donc encore une fois ce que ce trait de fonctionnement
psychopathologique (pervers en l’occurrence) de l’individu comporte à la
fois de collectif et de politique : le « sadisme » comme réalité
collective avant son concept, constitue une vision du monde qui a dû
rendre possible dans les époques anthropologique de constitution de ce
que Deleuze et Guattari ont appelé l’ « Urstat », forme archaïque de
l’état, les aspects monarchiques les plus violents et les plus barbares,
en même temps qu’elle réalise avec Sade lui-même, la forme moderne et
maniérée par excellence de ce que la monarchie des lumière a pu
théoriser de plus esthétiques sur les formes possibles de gouvernement.
Sade parle tout le temps de gouvernement et on a fait de lui un modèle
central de la psychologie individuelle. Toujours cette amphibologie
constitutive de notre ignorance organique d’êtres humains.
Et comme pour la paranoïa, mais cette fois-ci dans les espaces non
contraints de la perversion, ce rapport à la nécessité logique de
l’élimination du mauvais objet, mais non pas nuisible car trop puissant
comme dans la paranoïa, mais ici, nuisible car trop petit et trop
faible. Erotisation darwinienne du principe de la sélection naturelle,
conditions de tous les racismes au sens fort du terme.
On écrira donc encore ici ce principe logique d’exclusion du moinde
élément pour la sélection des meilleurs : ExLFx
Coin schizo des démocraties non représentatives
Ce point d’ancrage du schéma est le plus récent dans l’histoire de la
psychiatrie (Bleuler 1911), mais aussi le plus archaïque du point de vue
anthropologique puisqu’il correspond aux puissances de la pensée
magique, animique, le plus archaïque et le plus moderne à la fois :
C’est où l’on voit que le schéma est à lire dans une transversalité
diachronique et fonctionnelle : je rappelle que les opposés sont opposés
par des positions toujours « contradictoires » ou « inverse »,
c’est-à-dire ni contraires ni subalterne, dans le vocabulaire
d’Aristote, et ni réciproques ni corrélatives, dans le vocabulaire de
Piaget. (Je renvoie au carré d’Aristote qui n’est pas d’Aristote)
La schizophrénie est la maladie de la mise en scène et de la prise au
sérieux de l’idéal social du peuple, des aspirations du grand nombre.
Elle est décrite psychiatriquement comme maladie de la « dissociation »
de l’esprit. C’est une définition probante devant les descriptions de ce
que Chaslin a appelé la « discordance », phénomène plus intéressant
cliniquement. Elle caractérise aussi ce que Freud a désigné comme
symptôme structurel sous le terme de « spaltung ».
Mais tout cela, pour probant que ce soit sur le plan de la description
clinique et psychopathologique, correspond au plan phénoménologique, et
c’est d’ailleurs logique, à une perception de la totalité sous un même
caractère de possibilité : tous sont différents et divisés, mais tous
peuvent partager une vision commune, tous peuvent prétendre à l’action
commune, tous sont concernés par le projet d’être la nation, le pays,
l’état, le monde. Il est effectivement logique que la dissociation ou la
division de l’esprit, réalise à titre de compensation au moins mais même
à titre de compétence, l’esprit de communauté dont la forme la plus
aboutie dans l’histoire des religions notamment, est réalisée par le
personnage conceptuel du Christ.
Cette « personnalité schizo » apparait comme objet d’expertise au moment
et seulement au moment des grandes révolutions prolétariennes, entre
1905 et 1917, elle est l’argument que la psychiatrie bourgeoise oppose
aux velléités révolutionnaire des « petits ».
Tous peuvent être sauvés, ce qui ne veut pas dire que tous le seront,
mais on est aux antipodes de l’exigence paranoïaque qui veut qu’un
certain nombre (les persécuteurs ou les méprisables) soient éradiqués du
champ (« nous restions bien loin du bonheur des débiles » dit Nietzsche
dans L’antechrist).
On pourra donc écrire par principe à cet angle du schéma :
VxFx
C’est aussi la raison pour laquelle cet angle du schéma est en
correspondance avec le point de vue politique « démocratique », mais pas
du tout au sens courant de ce terme, qui désigne les oligarchies
représentatives libérales libertaires de Clouscard, mais au sens tout
simplement strict ou « logique » du régime politique qui considère que
VxFx !!!
Coin voyeur des oligarchies sélectives autoritaires
Depuis la position obsessionnelle considérée structurellement comme
névrotique, l’ascension vers les espaces pervers du voyeur, mais aussi
bien de la surveillance et de la vérification perverse, constitue la
périphérie, située partout, du regard de Dieu, épicentre de la pupille
du divin regard, lieu surplombant de l’autorité, mirador de la
conscience collective et individuelle, la position du voyeur est
toujours protégée des intempéries, dissimulée ou discrète, à la fois
fixe et ubiquitaire, caractérisant volontiers l’efficacité du
fonctionnaire zélé.
Il n’y a pas d’état sans un réseau périscope panoptique de surveillance.
La voyure conditionne les pratiques sociales ou plutôt « politique » de
sélection comme l’exhibition conditionne l’orgie électorale à peu près
permanente qu’encourage la « démocratie représentative ».
L’état constitue un panoptique d’où les élus et les énarques regardent
par des trous de serrure les souffrances des milliers de petits
travailleurs qui les « travitaillent », et ils se laissent voir en sens
inverse par ces même trous de serrure a l’acmé de leur jouissance dans
la chambre noire du pouvoir, en une image qu’ils projettent ainsi dans
leurs conscience renversée sous forme de « loisir » : le luxe et la
consommation à tous les sens du terme. Dans le boudoir et sur la plage.
Les aristocrates et le prolétariat.
Ce n’est plus la boule protoplasmique freudienne et sa couche corticale
exposée aux excitations du monde extérieur, c’est la boule
aristocratique marxiste et sa couche corticale destinée à exciter le
prolétariat du monde extérieur.
Elle sélectionne ceux qui auront le droit d’y entrer par leur capacité à
imiter les modèles de la jouissance dominante, c’est-à dire la
jouissance de domination, celle qui se pratique du côté du sadisme, mais
aussi compatible avec l’exhibitionnisme commandité par l’habitus
fasciste.
Il faut ce type de machine d’état avec des voyeurs obsessionnels
asservis et dévoués à la cause paranoïaque du monarque magnanime et de
ses sadiques de palais, pour faire tourner de façon toujours un peu
boiteuse (à la Richard III), la structure du rapport des classes.
La voyure est la seule perversion qui ne soit quasiment pas sanctionnée
par la machine juridique : elle se sent trop concernée. Qu’y-a-t-il-de
plus voyeur qu’un procureur ? Qu’un inspecteur ?
Le panoptique est d’abord une machine de droit.
Côté lymphatique des oligarchies humaniste et religieuses
Le tempérament lymphatique pose donc une attitude passive et
globalement soumise qui peut tout autant exprimer une psychopathologie
chronique de la passivité et de l’inhibition, que la soumission aux
règles collectives de comportements rituels qui font la structure des
institutions les plus sectaires et les plus rituelles, voire les plus
autoritaires. Mais il n’en constitue pas moins une attitude pouvant se
vouloir compréhensive et accueillante, non jugeante, voire
contemplative.
Cette position déjà connue dans l’antiquité occidentale constitue dès la
médecine hippocratique le dispositif tempéramental propice à favoriser
les modes de fonctionnement collectifs figés sur des habitus répétitifs
réguliers, des règles, des rites, rites religieux, rites d’institution,
des automatismes, des règlements, des lois, des convenances.
On est du côté « nomique » ou « nomologique » d’un bi pôle de l’histoire
ou de l’historicisation dont l’autre extrémité constituera le côté
dramatique ou « poïétique » au sens d’Aristote.
Cette disposition donne donc lieu dans sa forme extrême à des liturgies,
des formalismes ou des légalismes pervers dont on sait très bien qu’ils
structurent et garantissent les institutions tout autant que les «
mythes fondateurs » chers à Dumézil.
Un tel tempérament chez une personne va donc de pair avec une tendance
collective à l’organisation politique d’une société de type oligarchique
sélective, mais avec une finalité égalitaire pour tous ceux qui se
soumettent aux rites ou aux règles tacites ou explicites du groupement
distingué par ces règles.
Tous ne sont cependant pas susceptibles de participer à ce bonheur :
LVxFx
Côté mythique des états religieux exploitant le récit
Le mythe et une affaire qui tournait dans l’antiquité, et c’est une
affaire qui tourne aujourd’hui. Pas de la même façon. C’était l’inceste
plutôt du premier type. C’est aujourd’hui celui plutôt du deuxième. Au
sens de Françoise Héritier.
Le mythe est le récit qui fait qu’on aime un personnage, ou qu’on le
condamne. Il est fondateur de la personnalité elle-même. Donc aussi
fondateur de civilisation et des rapports de société.
Le mythe est d’une certaine façon fabriqué de toute pièce par la
civilisation où il apparait, mais il fabrique de toute pièce aussi la
civilisation où il apparait: avec lui, elle n’est plus la même qu’avant.
Il est totalement imbriqué à la question marxienne de l'histoire. Mais
que peut-on savoir à proprement parler de l’apparition d’un mythe ?
Côté rituel des états religieux autoritaires et figés en sectes ou en églises.
La rito-mythologie est en charge d’orienter l’anthropologie la plus
basale et la plus incontestable.
Ce que l’on dit des rites et des mythes, il est difficile de l’inventer.
Ou alors c’est dangereux. Et peu pertinent.
Il y a un pôle de souscription aux rites de société, qui pour autant
qu’ils servent à décrire les faits de société, n’en appartiennent pas
moins aux structures mentales des individus. L’inconscient individuel et
collectif de chacun d’entre nous est pétri d’un ensemble de rites
intégrés très tôt, qui participe à la constitution de ce que Bourdieu
appelle un « habitus ».
De même mais par un ensemble de mécanismes qui sont incompatibles le
l’inconscient en question est pétri d’un ensemble de mythes transmis et
partagés par le seul fait de l’identité culturelle, mais dans le mythe,
c’est l’énoncé qui conditionne l’action, alors que par le rite, l’action
conditionne l’énoncé. Il y a un sens des choses. C’est ce rapport au
discours qui a fait nommer par Félix Guattari «axe discursif» dans
son diagramme des aménagements. Je le garde toujours en référence car il
a fortement inspiré au tout départ le mien.
Le rite participe du discours au sens où il est constitué d’un ensemble
de gestes, de comportements, d’attitudes, qui sont tous à la foi
conditionnés par un corpus de règles tacites ou écrites, mais aussi
qu’il conditionne un discours de commentaire des faits, qu’il constitue
une sorte de support évènementiel des actes sociaux de discours, même
s’il n’est pas typique en tant que processus sociale de ce qu’on entend
par évènement.
Bourdieu au sujet de sa propre fonction oppose le sacerdotale au
prophétique comme on opposera le rituel au mythique dans ces visions des
fonctions psychosociales.
« Je me suis lancé sur le problème de
la position du sociologue parce que j'ai voulu sortir du rôle
prophétique et aller vers le rôle sacerdotal du sociologue, ce qui est
plus reposant pour l'auctor considéré et pour que vous ayez le
sentiment que je n'impose pas le monopole de la violence symbolique
qui m'est conféré. De même que l'État usurpe le pouvoir de
construction de la réalité sociale qui appartient à chaque citoyen, de
même un professeur est investi d'une sorte de monopole provisoire qui
dure deux heures pendant plusieurs semaines, le monopole de la
construction sociale de la réalité. »
Sur l’état. Ch 2 Cours au Collège de France de 1989 à 1992, Raison
d’agir chez seuil 2012.
Le rite dans ce schéma n’aura pas forcément le monopôle du religieux
même si l’on peut y voir une tendance majeur de la religion, puisque de
la même façon la religion implique un rapport au mythe quasiment
systématique, et on voit donc comment cette ligne horizontale qui sépare
le ciel et la terre est naturellement conditionnée par le fait religieux
aussi bien que par les faits de discours, ce qui est d’ailleurs
probablement à peu près la même chose.
On impose et on s'impose ici le systématisme de la répétition et de la rigidité des rôles et des fonctions pour garantir la puissance de l'institution et sa propre puissance de sujet dans l'institution, en adoptant le camp des suivsites qui partent du principe que tous ne sont pas bons même dans le sein des saints et qu'il faut imposer à chacun l'obéissance inconditionnelle au rite si l'on veut continuer à bénéficier des avantages consistants de l'adhésion à la secte: LVxFx
Côté sanguin des monarchies parlementaires électives
Le tempérament sanguin appartient aux caractérologies de la renaissance
et même de l’antiquité.
Ce type de réactivité physique aux évènements va de pair avec le goût
des grands récits, la passion des grandes aventures, des épopées, les
mythes et la mythologie, réalisant à l’extrême la mythomanie lorsque ce
trait se radicalise en perversion.
Il est aux antipodes du tempérament lymphatique qui réalise tout en
retenue l’hyposthénie et la passivité propice à l’adaptation aux rites
et aux régularités de l’institution qui à l’extrême réalise l’habitus
liturgique pervers si utile dans l’histoire aux institutions
religieuses.
Le tempérament sanguin organise les mouvements d’humeur et suscite les
moments d’émotions qui scandent l’histoire et l’expression des
regroupements sociétaux.
On se situe sur l’axe de mon schéma qui est indiscutablement le plus
difficile à comprendre. Il correspond à ce que Guattari a appelé l’axe
de « discursivité ». J’ai pour ma part depuis le début de cette
élaboration traité cette dimension comme celle d’une anthropologie
polarisée entre les deux pôles de la rito-mythologie. On peut encore
l’appeler la dimension historique ou temporelle avec ici le pôle
dramatique ou poético poïétique au sens d’Aristote par opposition à
l’autre bout au pôle nomique ou nomologique ou « légaliste ».
Dans l’écriture logique de ces places, on posera avec tout autant de
difficulté la négation de la totalité : c’est parce que tout n’est pas
dans l’ordre et parce que tout n’est pas satisfaisant que le personnage
concerné par ce trait de caractère va en appeler à une aventure
héroïque, une croisade, une guerre juste et grandiose au service du
récit identifiant et auto-persuasif. La fameuse prédiction
auto-réalisatrice.
Ce dispositif est vital pour entretenir la vitalité de tout gouvernement
annexionniste et colonial. Il repose sur la fonction de mobilisation du
mythe, du sentiment national, du patriotisme, de l’enthousiasme
politique. A l’extrême de la mythomanie perverse collective, le
terrorisme réalise le joint dans l’innommable qui rapproche dans
l’infini topologique la mythomanie collective de la nécessité
d’obédience liturgique qui fait toute la consistance des sectes.
On y croit. Tous ne sont pas incapables de fournir à la Nation des héros
et de la grandeur : LVxLFx
Structure en X
En
attente.
Clavier des intempérances et des «positions» républicaines.

Ce tableau n'est pas lisible sans les commentaires qui vont avec, je le dépose cependant pour la couleur en attendant la mise en ligne des commentaire videos qui me posent pour l'instant quelques problèmes techniques.
Chapitre II: Du système des idées de la république vu au travers des catégories de Piaget.
Première analogie : principe de permanence.
«Groupes constitués»
Il n’y a de communautaire que l’illusion d’être ensemble. … On se
côtoie sans se rencontrer; l’isolement s’additionne et ne se totalise
pas : Raoul Vanheigem
La structure de groupe est définie par les mathématiques comme «
algébrique » et « abstraite ».
Son but étymologique dans l’algèbre est de « réduire toute fracture ».
L’abstraction nous entraine vers le ciel des idées.
Caractéristiques du groupe :
C’est un ensemble. Un ensemble muni d’une opération (ou d’une loi de
composition interne).
Muni d’une « opération » associative (loi de composition interne
associative).
Admettant un élément neutre.
Admettant pour chaque élément un symétrique.
Cette structure permet grâce à l’axiomatique de Péano et à son
utilisation du concept de « successeur », de repérer tout élément dans
le groupe et de lui affecter un nombre entier naturel. C’est ce qui
permet de distinguer ce que Piaget a nommé « groupement » et « treillis
», et dans lesquels cette propriété n’est pas applicable. Dans un
groupement on sait de tel élément de l’ensemble qu’il fait partie de
l’ensemble ou d’un ensemble de niveau supérieur ou n’en fait pas partie
(Par exemple on sait que dans le groupement des animaux, l’homme (ou
plutôt « un homme ») ne fait pas partie des « oiseaux »), mais on ne
peut ordonner les éléments à l’intérieur du groupement considéré. On
voit déjà l’usage politique qui peut être fait de ces définitions au
service soit de l’option démocratique pour considérer les individus dans
un groupement, soit dans un groupe ordonné et ordonnant à velléités de
fonctionnement oligarchique ou monarchique.
Accepter l’idéal démocratique, c’est accepter une sorte de renoncement
de savoir, de renoncement à l’idéal de classement algébrique des
individus, accepter une part d’indétermination des acteurs dans
l’optique du jugement dernier. L’égalité des conditions est à ce prix.
Dans le parti ou dans l’institution le premier rentré passe avant le
deuxième. Dans la démocratie digne de ce nom ils peuvent se faire des
politesses.
Institutions et Partis
Le parti comme la "chambre", lieu d'expression des partis, est la
structure d’expression qui dans la république se prend pour le tout.
C’est la puissance paranoïaque d’expression du politique.
Il ne peut être qu’ordonné, hiérarchisé, autoritaire, ordonnant, c’est
dire si tout parti laisse fuser quelques relents de fascisme, de nazisme
ou d’une manière générale, de totalitarisme.
Il fonctionne comme fonctionne en logique ou en mathématique un groupe
au sens fort du terme : chacun y a d’une certaine manière sa place, et
numérotée ou du moins en relation de bijection avec l’ensemble des
entiers naturels. On est dedans ou dehors. C’est une monade qui n’a
point de fenêtre, mais dans laquelle chacun se range par ordre.
Il tolère mal les scissions et requiert de ses membres soumission,
obéissance, croyance, voire « adhésion ».
On comprend que les régimes à parti unique soient par définition
totalitaires : c’est la seule vertu du multipartisme représentatif que
de mettre à mal les régimes totalitaires, ce qui est certes la plus
fondamentale des vertus en politique. Mais malheureusement, le monde est
mal fait, quoiqu’il en dise (le parti), il est incompatible avec
l’essence de la démocratie : Ce n’est que par l’assomption de sa
spaltung fondamentale, entre liberté d’expression et nécessite de
représentation, que le monde et son âme pourront réaliser les pépites de
démocratie directe dont ils sont capables. Un parti est un monde dans le
monde : il en est du monde et des mondes, comme du parti est des partis
: l’habitus langagier qui fait de la singularité la totalité a tout à
gagner à se con-frotter à l’habitus langagier qui fait de sa totalité
une singularité.
Le propre du parti est d’avoir comme point de vue une sorte de scotome
central narcissique autodéterminant. On se persuade d’autant plus de son
existence qu’on est incapable d’en prendre conscience et a fortiori,
d’en faire l’analyse. Il n’a de parti que sur le mode de l’inconscience
collective du fait individuel et de le l’inconscience individuelle du
fait collectif. L’inconscient, c’est le parti. Même dans ses formes les
plus libérales. N’allons surtout pas penser que le parti comme
structure psychique ou politique, soit préférentiellement une référence
à l’URSS ou à la chine communiste historique. L’institution a presque la
même structure d’existence sauf qu’elle accepte (lorsqu’elle l’accepte
!) le principe de ne représenter qu’une fonction particulière dans
l’exercice de la République. Dans cet ordre d’idée on pourrait dire que
le mauvais gouvernement est dans une république, l’institution qui
remplit toutes les fonctions, et que le bon est celle garanti la
division des pouvoirs. La preuve est maintenant faite qu’ils sont en
pratique, difficiles à diviser. Il est plus facile de diviser le travail
que le pouvoir.
Deuxième analogie : principe de production.
«Treillis» et «réseaux», «Rhizomes»:
Le treillis est l’organisation d’un ensemble d’éléments dans lequel
chaque paire d’élément est bornée vers le haut par un ensemble
englobant, et vers le bas pas un plus petit domaine commun.
Piaget nous dit qu’un treillis est « un ensemble partiellement ordonné
par un relation ». Il parle aussi souvent de structure d’ « emboitements
» : Elle constitue donc ce qu’on pourrait appeler un ensemble
d’appartenance et de possessions.
Elle constitue aussi une structure intermédiaire entre le groupement
sauvage et spontané tel qu’il peut se constituer au grès des évènements
historiques dans la nature humaine ou même dans une nature non humaine :
des groupements se forment quand il s’agit de la survie des êtres ou des
manières d’être ensembles, et ils sont tenus de se doter d’un certain
niveau d’organisation.
Guattari parle à ce niveau de « rhizome » ou « phylum » mécanique et
abstrait. De fait on est probablement à l’acmé de toute abstraction
possible : c’est la machinerie dans laquelle on tente de dégager un «
concept » pour chaque chose.
C’est le niveau d’organisation de toute pensée qui demande : « Comment
peut-on ranger les concepts ? »
Guattari dit « il n’y a pas de raison que deux concepts se suivent ».
Mais il y a des concepts qui se suivent. Que fait-on avec ça. Des
boites. Plus précisément des emboitements. Un treillis est un ensemble
de boites emboitées. Un ensemble d’emboitements. Il s’agit de ranger :
nous somme au pôle obsessionnel du carré que je propose qui n’est pas un
treillis mais qui le comporte.
Associations
Une association se pose toujours comme fonctionnant par rapport à un projet commun ou à une idée commune.Cela peut-être un objet et on s’approche alors du totémisme décrit par Philippe Descola, que je qualifierai aussi de société hystérique d’appartenance de classe.
Cela peut être un concept et on s’approche de la société analogique décrite par Philippe Descola, que je qualifierai aussi de société obsessionnelle de classement.
Dans tous les cas l’association présente l’avantage de n’être pas directement dépendante des structures centralisées de la République et se narcissise dans l’idée le plus souvent totalement surfaite de sa liberté et de sa compétence critique.
Elle présente au moins l’avantage de la sincérité au moment de sa naissance. Au départ une association est toujours « pure ». Comme les enfants. C’est la société qui la corrompt. Partout où la République voit naître des « associations », c’est-à-dire là où elle ne veut pas ou ne peut pas les interdire, comme on aime à entendre les premiers mots maladroits de nos enfants, elle leur adresse immédiatement des œillades amoureuses, comme les prix que Marx perçoit dans les œillades amoureuses que la marchandise lance à l’argent.
« L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénabilité absolue, parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lit tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits, comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même. En même temps, les prix, qui sont pour ainsi dire les œillades amoureuses que lui lancent les marchandises, indiquent la limite de sa faculté de conversion, c'est-à-dire sa propre quantité. » Marx Le capital Livre I Première section : Marchandise et monnaie.
Troisième analogie : principe de communauté.
«Groupements
constituants », ou groupements au sens de Piaget:
La substantivation confine ici au participe présent. Elle présentifie
l’action. Le groupement est presque le mouvement de se grouper :
autodéfense collective : le « Cachons nous derrière ce mur » de Sartre
dans sa critique de la raison dialectique.
Le groupement constitue la part la plus active du groupe social, la plus
vécue, la plus ressentie, c’est dire si elle est théorique.
Nous appartenons au même groupe parce que nous nous regroupons et nous
ne nous regroupons pas forcément parce que nous appartenons au même
groupe, ou alors ce n’est pas très bon signe, même si c’est souvent le
cas.
Le groupement est de toute évidence le plus sympathique des ensembles
humains, au sens étymologique du terme.
Pour Piaget il se confondrait presque avec ce qu’on pourrait appeler la
race, ce qui peut donner une lecture louche du vocable dès lors que l’on
parle des choses humaines. Le groupement est l’ensemble des éléments
pour lesquels la question de l’appartenance ne se pose pas. C’est le
grumeau de consistance ontologique, le conglomérat, le rassemblement
sans la République, de fait, immédiat, qui se pose sans poser question,
l’évènement, l’histoire telle qu’elle nous tombe dessus.
Le groupement est la forme de l’ensemble qui recrée une nature là où la
culture pose problème. On pourrait aussi bien l’opposer au «
regroupement ». On est loin de la structure mathématique du groupe. On
fait avec les moyens du bord. Et il n’en constitue pas moins une «
structure » fondamentale pour les mathématiques autant que pour la
philosophie politique et pour son antinomie relative, la politique sans
philosophie.
Assemblée Constituante: Propriété privée des moyens de la
production affective et intellectuelle («ton corps parlant
est-il à toi?») :
Rappel de «constitution»: La République quelle qu’elle soit est
république pour autant qu’elle s’est dotée d’une constitution, et que
ses citoyens sont supposés par elle en accepter les règles. Les accepter
c’est accepter qu’elles ne soient pas remises en question. Accepter
c’est autant accepter son appartenance à la République qu’accepter comme
telle que la République, soit, ce qu’elle est. Cette acceptation passe
par l'acceptation de sa constitution.
Pourtant, en permanence, son conatus est interrogé par son désir de
révision constitutionnelle. En permanence elle peut être tentée de
reconsidérer les règles de base de son être, et en permanence elle est
aux prises avec cet empêchement, qui tient au fait qu’elle doit accepter
presque inconditionnellement ce surmoi juridique qu’elle s’est elle-même
donné, et qui la constitue à tous les sens du terme. Il y a donc un
double-lien typique dans le rapport à soi-même et donc dans son essence,
de la République.
Et celui-ci ne préjuge en rien du régime politique dont elle se dote.
Bien qu’il soit toujours interrogé par le concept lui-même de démocratie
et par ses nombreuses consistances et/ou inconsistances.
Pierre Rosanvallon décrit avec brio dans son cours au Collège de France
de 2011-2012 les structures de garantie et la possibilité
institutionnelle d’un recours cyclique ou critique à la révision des
institutions par des structures critiques de la constitution en place.
Il reconnaît cependant que tout groupe «constituant» ne peut naître et
se dissoudre aussi vite qu’à l’occasion de crises objectives
«historiques» qui sont imprévisibles et «ininstituables». L’expression
«structures critiques» est de moi et j’en mesure le caractère oxymorique
mais elle n’en est pas moins opératoire et nécessaire pour décrire la
santé comme les pathologies de l’esprit de démocratie.
Quelqu’un comme André Belon, qui n’est susceptible ni d’intéressement,
ni d’abus de position dominante, ni de facticité ou de mauvaise foi, lui
qui est plus que tous, pour la reconsidération de la constitution, s’est
embarqué dans un montage associatif pour soutenir un projet de
constituante: C’est une fois de plus le monde à l’envers: on ne peut pas
attendre d’une association qu’elle se donne pour vocation de critiquer
ses propres conditions d’existence.
La proposition de reconsidération constitutionnelle telle qu’elle a été
offerte à l’opinion en France, aux Pays Bas et en Irlande n’est plus
dans les cartons de la CEE depuis longtemps, et on n’est pas prêts d’en
ré-éprouver les résultats avant quelques révolutions institutionnelles.
Comme tout être pensant, la République vit à l’épreuve de son propre
conflit psychique. Elle est porteuse d’un inconscient qui laisse passer
quelques retours du refoulé. Elle vit ses propres secousses de
l’intérieur, même quand son environnement climatique (les humeurs des
autres) est au beau fixe.
Au fond nous ne sommes plus en 1789 et la question d’aujourd’hui n’est
plus «comment pourrait naître (ou plutôt renaître) une république?»,
mais «comment celle qui est en place peut ressentir et juger sa propre
constitution?».
Une république qui ne peut réfléchir sa propre constitution est
condamnée à devenir une république débile (et on en connaît), ce qui
pourrait s’appeler une secte, soit une dictature. Il y a plusieurs
dérive possible aujourd’hui en occident pour une dictature: Dictature du
prolétariat (nous y avons échappé), dictature monarchique (ça s’appelle
une tyrannie ou un despotisme, 89 nous en a un peu protégé), dictature
de la religion (c’est plutôt maintenant le tour du monde musulman),
dictature de la bourgeoisie et de l’argent (nous y sommes).
Chapitre III: Du principe de la distinction des compétences républicaines en «sélectives-expertales» et «électives-spectaculaires».
Cette distinction est celle qui a été impliquée ici dans le chapitre
«axe oblique névrotico-politique».
Parce qu’il y va de ce développement de la conscience malheureuse et
responsable, au début de l’ère «moderne» avec les révolutions
«modernes», aussi bien copernicienne que kantienne, ou aussi bien
américaine que française. Il y va effectivement de la fabrication
progressive et laborieuse bien que relativement rapide et récente dans
l’histoire du monde de cette opposition des moyens qui n’avait pas de
sens dans l’antiquité et qui trouve son acmé avec la critique du
spectacle des lettriste en France en 68.
C’est la psychiatrie ou la pratique de la psychiatrie qui a mis au monde
l’usage et la pratique de l’expert et de l’expertise. (Voir «structure
en X du schéma»)
C’est aussi le paradigme de tout ce que Pierre Rosanvallon appelle
«démocratie de type capacitaire»: d’un côté sélection élective des
«capacités à gouverner» par toute une machinerie électorale de
campagnes, de propagande, et de l’autre une sélection scolaire formelle
des «meilleurs» qui tend à reconstituer en permanence sur le terreau du
«peuple», tous les traits de distinction qui font l’aristocratie d’état
et l’élitisme républicain que Bourdieu a si bien mis en évidence.
Cet élément du comportement collectif qui constitue dans le sentiment
vécu de la classe moyenne nous apparaît d’une évidence ne nécessitant
aucun commentaire, sans que l’on ne réalise jamais trop qu’il est
incompatible avec les structures de l’antiquité, de la féodalité ou même
de l’âge classique.
La fonction distinctive de l’école n’existe pas dans ces époques
pourtant non dispensée d’avoir à dépendre d’un ensemble hiérarchique et
structuré du rapport des classes.
On rencontre principalement dans la bonne bourgeoisie intellectuelle des
acteurs discrets qui pensent fortement qu’il n’y a plus de classes
sociales et qu’il faut en finir avec ces discours proto ou néo
marxistes. C’est ceux qui voudraient voir l’aplatissement de la
structure dans la confusion de ces deux types de compétences
: que les élus soient les plus méritants. C’est une affaire qui marche
assez mal.
Tout me porte à penser qu’il existe encore quelques reliquat de classes
sociales et de classements sociaux, et que je suis en grande partie le
résultat de cet organigramme d’appartenances historiques et
géographiques, que des forces occultes du classement (bien qu’assez
largement analysées par nombre de penseurs critiques aujourd’hui).
Simplement les conditions du classement sont bien plus qu’hier,
influencées par les deux systèmes antinomiques de distinction que sont
d’une part la société hystérique du spectacle avec ses composantes
fascistes de propagande électorale, et d’autre part la société
obsessionnelle scolaire sélective avec ses composantes nazies de
sélection eugénique dans l’ordre du goût et des dispositions à la
«collaboration». Attention à ne pas «mésinterpréter» mon propos: je
n’accuse pas l’école de nazisme ni la bonne société des spectacles de
fascisme au sens que l’histoire a laissé de ces termes. Je les situe
simplement structurellement comme des «attracteurs» susceptibles de
structurer comme par aimantation les institutions elles-mêmes de l’école
ou du spectacle. Ces institutions sont en soi toute civilisation et
toute bonnes mœurs dès lors qu’elles s’en tiennent au cadre structurel
des fonctions sociales fixées au plan d’immanence de l’être psychosocial
que j’ai illustré dans cet ouvrage, par opposition aux positions
d’institutions qu’on peut dire «perverses»: voyeurisme et sélection
nazie sur des critères n’ayant plus aucune référence avec le terrain (on
connaît ces dérives qui peuvent prendre tous les degrés entre l’honnête
obsession scolaire un peu poussé et la crapulerie totalitaire au service
d’une puissance d’asservissement occulte et sans attaches), et d’autre
part l’exhibitionnisme et les pratiques de propagande électorale
fasciste sans aucun rapport avec la bonne hystérie des acteurs du champ
social dont le seul défaut est l’identification qui les lie à des
personnages hauts en couleur du champ politique (et du clan politique)
auquel ils veulent se persuader d’appartenir.
Chapitre IV: Du schématisme de l’entendement concernant la chose sexuelle.
Que faire du divers de l’intuition appréhendé par des penseurs comme
Philippe Descola ou Françoise Héritier ? Constater qu’il est
condition d’un logicisme schématique immanent (Carré de Descola, Théorie
de l’inceste du deuxième type chez Héritier (inceste avec les affins)).
Ajoutons à ces structures immanentes les concepts fragiles mais porteurs
de « machines célibataires » chez Deleuze et Guattari, et la
question non posée depuis eux des sexualités collectives, et en
particulier institutionnelles (Platon, Fourrier, etc).
La conscience humaine du fait sexuel semble toujours se situer en
limites des possibilités de la structure transcendantale des relations,
soit avec l’épreuve d’une logique immanente des relations. La relation
sexuelle n’est un « rapport » que par la mixité imparfaite
qu’elle exige toujours. Le rapport sexuel n’est jamais symétrique,
jamais « égalitaire », jamais « réversible ». Il
décale. Il distingue. Il oppose. Il différencie, comme le rapport
social, même à gauche, en particulier à gauche.
Et pourtant, et malgré cette asymétrie foncière, il semble toujours plus
ou moins impliqué par des faits de structures, des événements
répétitifs, des rigidités de déroulement. Il y a comme des règles, non
pas positives, mais inscrites dans l’histoire des conditions sociales du
rapport sexuel entre les humains.
C’est la façon dont le schématisme de l’entendement (humain) génère les
conditions possibles de la vie affective de l’être humain: il y a comme
des structures logiques et civilisationnelles à la fois qui rendent
possibles ou qui encombrent la sexualité pour tout le monde et qui
passent bien au-delà de la conscience positive que l’acteur peut s’en
donner comme représentation.
C’est une chose d’avoir une vision métaphysique du rapport sexuel comme
Lacan qui avait pourtant une sainte horreur de la métaphysique qu’il ne
cessait de pratiquer, c’est une autre chose de penser dans une sorte de
cynisme matérialiste une sexualité biologiquement conditionnée par je ne
sais quelle phéromone ou neuromédiateur.
Mais dans tous les cas il y a ce qui est possible et ce qui ne l’est
pas, sachant que la pratique de ce qui est possible rend toujours à la
fois impossible celle de ce qui était possible, tout en possibilisant
davantage le possible, mais aussi que la pratique de l’impossible rend
possible ce qui était impossible, voir nécessaire chez le pervers par
exemple, s'il existe en tant qu'objet.
Ce vrillement et cet asymétrie du possible et de l’impossible aurait pu
être abordé par Aristote au moment de sa pensée de la quadrature des
quantifications qui n’étaient pas encore le carré logique, mais il n’a
par définition pas exploré les espaces de la logique modale qui
impliquent de plein feu le rapport subjectif : il ne cherchait que
les conditions épistémiques de l’objectivité.
Le monde de l’être sexualisé, même plus ou moins, ne vise qu’à
l’inconsistance de ces consistances du rapport logique des êtres, ou à
la consistance de l’inconsistance de la connaissance (ou du sentiment,
c’est la même chose), qu’on peut prendre de l’objet que l’on convoite,
faute qu’il nous soit proposé.
La rencontre de l’objet, les conditions de la rencontre de l’objet,
voilà ce qui ne peut pas se penser par la méthode scolastique que
l’école continue même aujourd’hui dans le monde entier, d’enseigner.
Synthèses schismatiques immanentes aux institutions de la République. Calcul des propositions.
Première partie : Des paralogismes de la pensée républicaine.
En attente.
Deuxième partie : Des antinomies de la raison républicaine.
Je reprends donc ici sans modifications a priori les antinomies psy que j’avais mis en exergue en 2000 :
PSYCHOLOGIE
Thèse O : L’obsessionnel va toujours au plus près de l’objet, pour
parvenir à connaître ou à énoncer les choses telles qu’elles sont,
dût-il y épuiser toute son énergie, notamment par la mise en doute
systématique selon la méthode cartésienne de tout donné émanent de son
environnement empirique.
Antithèse O : L’obsessionnel fait état des conditions douloureuses et
rigoureuses de sa recherche épistémologique de la vérité pour se
dédouaner en permanence de la reconnaissance vis à vis de lui-même et de
l’entourage, de sa propre " vérité " et notamment de sa propre sévérité
sexuelle et agressive.
Thèse S : Le schizophrène supprime les intermédiaires pour accéder par
le sens et par les sens à l’essence des êtres, et partant, renonce à
tout pouvoir que lui-même, en tant qu’individu, pourrait exercer sur les
autres.
Antithèse S : Le schizo se supprime lui-même en tant qu’être en
puissance, et se plonge ainsi dans un rapport où il a sur l’autre, une
sorte de pouvoir absolu, puisqu’il devient ainsi une sorte d’éponge
subjective absorbant tous les affects et devenant ainsi capable de poser
sur ceux-ci un regard détaché donc objectif.
Thèse P : Le paranoïaque annule tout sentiment de blessure subjective,
c’est à dire pour lui, altérant le narcissisme secondaire, par le
recours à une absolutisation du sentiment de soi et de la certitude qui
le soustrait d’une façon radicale au jugement d’autrui dans son propre
jugement.
Antithèse P : Le paranoïaque commande à lui-même et à autrui ses propres
actions et ses propres jugements, dans un rapport de domination
conceptuelle et de certitude qui à lui seul définit la seule condition
nécessaire pour donner sa consistance à la raison spéculative et à la
raison sociale.
Thèse H : L’hystérique exprime ses sentiments tels qu’ils sont vécus et
par-là, respecte infiniment sa propre conscience, l’interlocuteur et la
société à qui il s’adresse.
Antithèse H : L’hystérique distord toujours l’expression de ce qu’il
ressent, créant ainsi en permanence entre son intimité et le monde (et
même sa propre personne), un décalage et un espace de facticité qui
ménage quoiqu’il arrive les conditions de son propre pouvoir et de son
propre plaisir.
POLITIQUE:
Le républicain intellectuel isole l’objet « République » des agressions
qui le menacent par le doute et le déni de tout ce qui n’est pas
purement républicain en la République. (jacobinisme)
Le républicain intellectuel doute en permanence que la « République »
telle qu’elle est, soit purement « républicaine ».
(révolutionnaire)(Blanqui)
Le démocrate idéaliste imagine l’accord parfait des consciences
démocratiques au service d’un régime politique théorique qui est le plus
beau mais le moins possible.
Le démocrate pragmatique provoque en permanence les contradictions et la
mauvaise conscience du bourgeois dans l’optique d’une critique dont on
lui reproche toujours le caractère « théorique ».
Le monarchiste dogmatique assure ses jugements de valeur sur une
tradition et des rapports d’appartenance qui renvoient aux lois de la
nature. (De Gaulle, Toqueville)
Le monarchiste pratique (même constitutionnel) se persuade de son droit
historique c’est-à-dire de sa « légitimité » même incomplète, mais « par
l’histoire », à connaître et garantir l’âme du peuple (Guizot)
Le républicain sentimental manifeste en permanence sa joie sincère
d’appartenir au groupe politique qui représente pour lui les vertus et
la condition du bonheur de tous. (Hugo)
Le républicain sentimental arrange sa réalité et la réalité qu’il reçoit
de telle sorte la République comme objet lui soit toujours redevable des
passions qu’il lui consacre. (Hugo)
|
Il existe nulle part un être nécessaire, de manière inconditionnée, que ce soit dans le monde ou en dehors du monde ou conçu comme sa cause. |
Le monde n’a pas de commencement et n’a pas de limites dans l’espace et il est donc infini aussi bien du point de vue du temps que de l’espace. |
Il n’existe pas de liberté : tout dans le monde a lieu d’après les lois de la nature. |
|
Toute substance composée est constituée de parties simples et il n’existe nulle part quelque chose d’autre que le simple ou que ce qui en est composé. |
Kant
Antinomies |
Aucune chose composée dans le monde n'est constituée de parties simples et il n'existe nulle part rien de simple en elle. |
|
La causalité d’après les lois de la nature n’est pas la seule forme de causalité à partir de laquelle on peut déduire l’ensemble des phénomènes du monde. Il est donc nécessaire de supposer, en outre, une causalité par la liberté pour expliquer ces phénomènes. |
Le monde a un commencement dans le temps et est limité d’un point de vue spatial. |
Un être nécessaire, de manière inconditionnée, fait partie du monde que ce soit comme sa partie ou comme sa cause. |
Troisième partie : Solution critique de ces antinomies : La démocratie.
Qu’est-ce que « la » démocratie ?
C’est entre autres l’objet de toute cette présentation parce qu’elle est
contenue en puissance dans le concept même de République.
C’est aussi un fantasme structurant de l’occident positif comme les
mythes peuvent en être des récits fondateurs.
C’est un régime politique présent dans la pensée de quiconque pense la
politique, mais absent jusqu’à présent de toute réalité sociale,
collective et historique.
C’est un organisateur collectif de la pensée collective. Il faudrait
pour bien faire savoir ce qu’est la pensée.
On peut se demander s’il existerait une idée de « l’âme d’un peuple » en
l’absence de la démocratie comme concept, s’il existerait même l’idée du
politique ou de la politique en tant que tels.
Il n’en reste pas moins que la démocratie depuis son début (on sait où
et quand) constitue donc un premier contenant à toute pensée positive du
politique comme du psychisme. Elle reste une visée, un horizon. Très
rares en définitive (et ce n’est pas plus mal) sont les penseurs à
vraiment l’éliminer de leur projet (Nietzsche, Heidegger, Deleuze, …).
On pourrait d’ailleurs s’interroger sur leurs motivations (une certaine
élévation …). On laissera ici ce propos de côté.
La démocratie comme concept est autant l’idée d’un type de gouvernement
ou d’un régime politique, qu’une conception basale du collectif comme
lieu d’échanges possibles, ou que l’idée même d’une critique possible
des dogmatismes aristocratiques issus de la tradition.
L’idée grandiose des penseurs des cimes que je viens de citer repose sur
un sorte de petit pragmatisme à bon marché stipulant l’impossibilité
pratique et politique de toute organisation démocratique et donc
l’utilité pratique d’y renoncer d’entrée de jeu : c’est une formule
confortable pour l’élite pensante. Mais rien n’est moins évident dans le
siècle où nous sommes et je pense au contraire que le système du
gouvernement du peuple par le peuple est de plus en plus réalisable,
avec peut-être même maintenant une déconcertante et insultante facilité,
insultante à l’endroit de tous ceux qui se prétendent d’un désir de
démocratie et qui font tout pour qu’elle n’apparaisse nulle part, à
commencer par aller voter rituellement et benoitement pour des
représentant paranoïaques exhibitionnistes et ignares.
S’il faut la penser comme concept on sait qu’il est un héritage de la
Grèce, (lorsqu’elle était riche), mais une vision synthétique de l’objet
dans les conditions de l’occident « moderne » nous oblige à prendre en
compte le rôle majeur joué aussi par le Christ dans la réalisation
matérielle historique et dialectique des faits de démocratie. Sur ce
canevas les révolutions politiques américaine et française du XVIIIème
siècle ont favorisé cette synthèse, relayées par les parlementarismes
américains et européens du XIXème.
Et malgré tous ces combats, ces efforts, ces souffrances, nous n’y
sommes toujours pas !
Je ne développe pas ce chapitre pour éviter les redites.
Quatrième partie : L’idéal de la raison républicaine : perdurer, être soi. Raison=République.
La République est rationnelle, quelle qu’elle soit, elle est raison. Et
la raison est République pour la pensée, et n’est que république. Et
l’une comme l’autre, la République et la raison, sont en outre
paranoïaques.
Ce n’est pas une tare. C’est la place que Philippe Descola a réservée au
« rationalisme » dans son schéma des comportements de
civilisation : le plus abouti dans un certain sens. Mais aussi le
plus coupé des réalités de la « base », à tous les sens du
terme.
Il n’y a pas de République sans un moi collectif, « fort »
comme aurait pu dire Freud. La République, c’est le moi du collectif, la
démocratie, c’est son ça. Le surmoi, lui, reste l’ouvrage des
aristocraties et des oligarchies parlementaires, interdit obsédant de
l’obsession de la sélection des meilleurs par les meilleurs, mais aussi
bien fascination hystérique de l’élection et du théâtre des nominés par
le peuple en liesse, pulsion bien plus que volonté, « libido
electandi » pourrait-on dire. Peut-être ce deuxième terme
devrait-il être appelé en toute logique le « sous-moi
» : ce qui soutient le moi, le peuple soutien de ses
représentants. Freud n’y avait pas pensé : il est aussi nécessaire
au moi d’obéir à la loi venue d’en haut d’un surmoi dominateur et
menaçant, que de répondre de la loi venue d’en bas, du corps, d’une
libido sans limites d’exigence, et toute aussi menaçante.
Quel est donc ce rapport de la démocratie à la raison ou à la
République ? On sait bien qu’elle a vocation depuis le début, à
contrôler les outrances de la République. On sait moins qu’elle contrôle
aussi celles de la raison. Elle raisonne la République, et elle raisonne
la raison. La démocratie est par essence « réflexion ». Il
n’y a pas de république autocritique. Il n’y a de démocratie
qu’autocritique.
Quoiqu’il en soit de l’ensemble de la structure de l’être que je tente
d’illustrer ici, la seule place possible échue à la République comme
régime politique est celle du sentiment paranoïaque de la certitude
d’être soi-même, hypertrophie du moi, égocentrisme, psychorigidité,
idées de grandeur, méfiance, susceptibilité exacerbée. Certains auteurs
ajoutent fausseté du jugement, fausse modestie.
La Raison est la partie publique de la pensée : la «République».
J’ai réalisé cette évidence en rédigeant cet ouvrage : la raison
n’est ni plus ni moins que la République elle-même, au sens large
certes : elle recouvre tout le concept de « république
» et rien que ce concept. Ni elle ne le déborde, ni elle ne laisse
subsister en lui de manque. On peut imaginer une relation bijective
stricte entre toutes les parties du concept de «République» et celle du
concept de «raison».
Il n’y a pas de raison avant la première forme de République et pas de
« République » avant la première forme de «
raison ».
Cette équation nous permet de faire d’une certaine façon l’économie d’un
concept, et pas des moindre.
Il s’agit toujours ici de ce mirage de la distinction psycho-politique
que j’ai dénoncé et dénonce encore dans mes productions de façon très
solitaire. La question n’est pas tant de savoir s’il est bon de
confondre (contre Kant) des usages que l’on croyait distincts, mais
plutôt qu’il est bon de ne pas rester dupes et dupés dans une
distinction d’artifice qu’une tradition de pensée (peut-être
cartésienne) a maintenue active dans la conscience collective
occidentale. Et je ne précise ici « collective » que pour
rappeler combien c’est inutile et combien on peut ici enlever le mot
sans changer en rien le sens de ma phrase.
La raison est une forme de gouvernement caractéristique de l’occident,
gouvernement des esprits et des âmes aussi bien que gouvernement des
peuples, des nations, des pays.
La raison ne sert à rien en régime monarchique, même si les féodalités
ont toujours peu ou prou fonctionné sur les scories rationnelles des
régimes qui les ont bordées, dussent-elles alors se borner à en
transmettre les textes, à les traduire et à les copier. Je tombe
peut-être un peu ici dans le péché romantique d’obscurcissement du
moyen-âge qu’on a trop connu : la raison n’est pas le seul
composant de la lumière : il faut aussi pour parvenir à quelque
lucidité lui adjoindre une puissance d’adhésion à la réalité, une
énergie propre dont il faut convenir qu’elle n’était pas non plus le
propre du moyen âge.
La raison est chose publique, c’est ce qui la rend si «
politique », contrairement à ce que le cognitivisme basalement
scientifique veut lui faire taire. Il n’y a pas de raison individuelle
sans une conception collective des échanges, sans une idée de la chose
commune, sans l’échange des femmes, sans un certain nombre de
commandements sexuels qui régentent la structure du rapport des classes,
sans un interdit de l’inceste familial en surface, apparence d’un
commandement corporatif de l’inceste en réalité. (Voir la République de
Platon)
La « République » est ce qui organise dans l’occident
positif cette structure du rapport des classes d’exercice professionnel,
cette structure du rapport des métiers, des fonctions sociales, en
fictions sociales.
Il peut donc paraitre redondant sinon inutile de proposer une critique
de la raison « Républicaine ». Mon intention dans cette
histoire n’est pas tant de rendre plus consciente cette équation
«raison=République», que de préciser que le seul moyen républicain
d’échafauder aujourd’hui une critique de la République quelle qu’elle
soit, c’est de passer par la catharsis du délire démocratique, dont
l’actualité rend la réalisation tellement dangereusement possible (et je
dis « dangereusement » par ironie à l’endroit du sentiment
de l’opinion encore dominante, pour combien de temps ?).
D’où les hésitations possibles sur le titre de mon ouvrage :
« Critique démocratique de la raison » suffirait largement.
Mais il est peut-être bon de rappeler que nous vivons sous le signe
mental de cette redondance et de ce maniérisme positif qui consiste à
persuader l’être de la Nation qu’il est partagé entre un corps et une
âme, un entendement et une sensibilité, une nature et une culture.
Je retombe ici d’ailleurs à mon corps défendant sur la position
anti-kantienne d’un Clouscard dont la forme de mon ouvrage pourrait
avoir à souffrir, mais je rends grâce à l’un comme à l’autre de leurs
méthodes critiques respectives, puisqu’il faut une République pour
pouvoir penser la démocratie, et une démocratie pour pouvoir critiquer
la République.
Cinquième partie:
VIDEOS: 

 Des mobiles de la République. Examen critique de l'analytique. De la non
existence des névroses et des délires chroniques, et donc de la «raison»
républicaine.
Des mobiles de la République. Examen critique de l'analytique. De la non
existence des névroses et des délires chroniques, et donc de la «raison»
républicaine.
…
une fiction sociale n'est pas fictive. Hegel disait déjà que
l'illusion n'est pas illusoire. Ce n'est pas parce que l'officiel
n'est jamais que l'officiel, ce n'est pas parce que la commission
n'est pas ce qu'elle veut faire croire qu'elle est, qu'elle ne produit
pas pour autant un effet parce que, malgré tout, elle parvient à faire
croire qu'elle est ce qu'elle veut faire croire. Il est important que
l'officiel, bien qu'il ne soit pas ce qu'il fait croire, soit pourtant
efficace.
Pierre Bourdieu COURS AU COLLEGE DE FRANCE DU 25 JANVIER 1990
Extrait de ma thèse de 1985 (Clermont Fd) :
« Appliquer en 1956 au centre neuropsychiatrique de Dakar-Fan la
nosographie, les présupposés théoriques et les traitements élaborés par
une médecine européenne depuis toujours, voilà ce qu'auraient pu, en
toute logique, faire les psychiatres mandatés en 1938 par le
gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française pour assurer
"hygiène" et "prophylaxie" mentales. De cette expérience est née au
contraire une connaissance nouvelle tendant, bien sûr, à modifier les
règles du jeu européen pour la pratique africaine, mais aussi à remettre
en question le sens et la pratique de la psychiatrie des pays dits
"développés". Ne se prétendant d'aucune antipsychiatrie, Henri
Collomb et son école nous en disent long sur la question des délires
chroniques (et leur existence). Ils parlent d'ailleurs souvent de
"schizophrénie", parfois de "délires chroniques", jamais de "paranoïa".
Faut-il en conclure qu'il n'y ait pas de paranoïaques dans l'Afrique
traditionnelle ? La question importe peu, puisqu'il n'y a pas non plus
de schizophrènes: "Dans les sociétés africaines traditionnelles,
les maladies mentales chroniques (du type psychose chronique) étaient
rares ou pratiquement inconnues ; le type même de la maladie mentale
était la bouffée délirante" (A. p.104). "Dans les rares isolats,
relativement épargnés par la contamination culturelle occidentale, le
type de maladie mentale le plus fréquent, le seul connu est la psychose
aigüe de type bouffée délirante" (B. P.1169).»
Ce sont des constatations massives et révolutionnaires qui datent de
1956.
Elles ont été depuis totalement refoulées et oubliées du discours
prétendument scientifique de la psychiatrie occidentale.
On peut mesurer l’étendue et l’épaisseur du voile d’ignorance, pour
reprendre le terme de John Rawls, que les pratiques du DSM ont entre
autres étendu sur cette forte réflexion naissante des conditions du
colonialisme, pas uniquement européen.
Ainsi il nous reste aujourd’hui à démêler ce problème : en quoi les
délires chroniques, paranoïa et schizophrénie, possèdent-il la moindre
existence objective susceptible de justifier les innombrables et
coûteuses recherches sur leur cerveau, sur leur matérialité (voir encore
aujourd’hui Alain Prochiantz qui fait un cours au collège de France).
Je soutiens donc une genèse historique du problème très simple un peu
dans la ligne du premier Foucault, mais qui m’est plutôt apparue comme
une évidence à la suite de la lecture des travaux d’historiographie
critique de Michel Clouscard :
La paranoïa remonte comme concept et comme objet d’une pratique
médico-juridique au code Napoléon, à la sortie de la révolution
française en Europe, au désir inconscient de la classe bourgeoise
d’éradiquer du champ de la vie républicaine cette image inversée du roi,
ce personnage à éliminer comme une autre sorte de double corps du roi,
sanctionner par l’humiliation du jugement psychiatrique et par la mise
en asile tout ce qui peut rappeler de près ou de loin la monarchie, et
particulièrement sa forme absolue ou de droit divin : le paranoïaque
endosse cette lourde charge, cette responsabilité coupable d’avoir à
représenter dans le champ social, le reliquat mal jugé de la figure
estompée du monarque : il a à payer pour tous les excès des monarchies
antérieures et révolues pour ne pas dire révolutionnées. Stigmatiser par
le biais de l’expertise psychiatrique naissante, sa personne, c’est
garantir le régime bourgeois contre le retour au pouvoir de ce type de
personnalité auto-légitimée par l’histoire. C’est assoir la nouvelle
classe bourgeoise sur un savoir-faire intellectuel et juridique, sur un
savoir d’expert, sur un diagnostic de personnalité et donc de personne.
C’est l’apparition dans l’histoire de la première « personnalité » digne
de ce nom : je ne dis pas tempérament, je ne dis pas caractère, je dis «
personnalité ». La première personnalité est « paranoïaque ». Je le pose
en thèse : c’est d’ailleurs ce qui ressort de ma thèse de 1985 (mise en
ligne sur http://melchisedek.free.fr/encoreuneffort/). Je ne suis pas le
seul à le dire :
"C'est par statut que le despote est
un criminel, alors que c'est par accident que le criminel est un
despote…. Le premier monstre juridique que l'on voit apparaître,
se dessiner dans le nouveau régime de l'économie du pouvoir de punir…,
le premier monstre repéré et qualifié, ce n'est pas l'assassin, ce
n'est pas le violateur, ce n'est pas celui qui brise les lois de la
nature ; c'est celui qui brise le pacte social fondamental. Le premier
monstre, c'est le roi. C'est le roi qui est, je crois, le grand modèle
général à partir duquel dériveront historiquement, par toute une série
de déplacements et de transformations successives, les innombrables
petits monstres qui vont peupler la psychiatrie et la psychiatrie
légale du XIXe siècle." Les Anormaux, Michel Foucault, éd.
Gallimard Le Seuil, coll. Hautes Etudes, 1999, Cours du 29 janvier 1975,
p. 87
De la même manière donc, mais en outre de cette thèse non répandue, je
soutiens aujourd’hui la thèse complémentaire de la naissance du concept
de schizophrénie au moment des révolutions russes, comme défense de la
part des classes bourgeoises montantes européennes des années 1910
contre la menace véritablement révolutionnaire, c’est-à-dire contre les
révolutions prolétariennes : il fallait mettre de côté toute figure de
la révolte dans le peuple, et dans les masses laborieuses. Il fallait
assurer la pérennité de la machine industrielle, il fallait sanctionner
préventivement dans l’œuf toute sédition des travailleurs, il fallait
menacer de mise à l’écart dans le même lieu, dans le lieu de ce même
mélange, ceux qui se prenaient pour Napoléon mais qui voulaient un
retour à une sorte de féodalité d’empire, et ceux qui voulaient casser
la nouvelle autorité bourgeoise, son savoir-faire, son expertise, ses
institutions juridiques. Un nouveau couple de personnages apparait alors
: le schizophrène et son expert, le révolté et son juge, le gavroche et
son bourgeois, qui n’est pas obligatoirement son père. C’est une course
au plus malin, au dernier mot : c’est l’intellectualisation absolue du
rapport des classes. C’est la parole contre la praxis. Le schizo ne s’en
sort jamais. Il a toujours raison. Il a toujours tort. Il a tort d’avoir
raison. Il est gentil. Il est malheureux. Il est grandiose. Il est
irrespectueux. L’expert a le pouvoir. Il a le pouvoir de son côté. Et il
en use : c’est sa force : le schizo lui n’aime le pouvoir que pour
l’abandonner. Il le laisse à l’institution : pour la ridiculiser.
Ensuite, bientôt, ce sera les camps de la mort. L’histoire va trop vite
dans ces années-là. L’expert psychiatre du XIXeme siècle et des suivants
assure la consistance étymologique du concept d’expert dans l’occident
positif capitalistique.
…dans la littérature anti-jacobine,
contre-révolutionnaire, vous allez trouver l'autre grande figure du
monstre qui rompt le pacte social par la révolte. En tant que
révolutionnaire et non plus en tant que roi, le peuple va être
précisément l'image inversée du monarque sanguinaire. Il va être la
hyène qui s'attaque au corps social.
Les Anormaux, Michel Foucault, éd. Gallimard Le Seuil, coll. Hautes
Etudes, 1999, Cours du 29 janvier 1975, p. 91
A l'origine de l'humanité, il y avait
deux catégories de gens : ceux qui se vouaient à l'agriculture et à
l'élevage, et puis ceux qui étaient bien obligés de protéger les
premiers, parce que les animaux sauvages et féroces risquaient de
manger les femmes et les enfants, détruire les récoltes, dévorer les
troupeaux, etc. Il fallait donc des chasseurs, des chasseurs destinés
à protéger la communauté des agriculteurs contre les bêtes fauves.
Puis, il est venu un moment où ces chasseurs ont été si efficaces que
les bêtes fauves ont disparu. Du coup, les chasseurs sont devenus
inutiles, mais inquiets devant leur inutilité, qui allait les priver
des privilèges qu'ils exerçaient en tant que chasseurs, ils se sont
eux-mêmes transformés en bêtes sauvages, ils se sont retournés contre
ceux qu'ils protégeaient. Et ils ont, à leur tour, attaqué les
troupeaux et les familles qu'ils devaient protéger. Ils ont été les
loups du genre humain. Ils ont été les tigres de la société primitive.
Les rois ne sont pas autre chose que ces tigres, ces chasseurs
d'autrefois qui avaient pris la place des bêtes fauves, tournant des
premières sociétés. ( p. 89)
Le couplage anthropophagie-inceste,
les deux grandes consommations interdites, me paraît caractéristique
de cette première présentation du monstre sur l'horizon de la
pratique, de la pensée et de l'imagination juridique de la fin du
XVIIIe siècle. Avec ceci : c'est que dans cette première figure du
monstre, Marie-Antoinette, la figure de la débauche, de la débauche
sexuelle et, en particulier, de l'inceste, me paraît être le thème
dominant. Mais, en face du monstre royal et à la même époque, dans la
littérature adverse, c'est-à-dire dans la littérature anti-jacobine,
contre-révolutionnaire, vous allez trouver l'autre grande figure du
monstre qui rompt le pacte social par la révolte. En tant que
révolutionnaire et non plus en tant que roi, le peuple va être
précisément l'image inversée du monarque sanguinaire. Il va être la
hyène qui s'attaque au corps social. Et vous avez, dans la littérature
monarchiste, catholique, etc., anglaise aussi, de l'époque de la
Révolution, une sorte d'image inversée de cette Marie-Antoinette que
représentaient les pamphlets jacobins et révolutionnaires. (p.
91)
Barruel, dans l’Histoire du clergé
pendant la Révolution, raconte l'histoire d'une certaine Comtesse de
Pérignon, qui aurait été rôtie place Dauphine avec ses deux filles, et
six prêtres auraient été, eux aussi, brûlés vifs sur la place, parce
qu'ils avaient refusé de manger le corps rôti de la comtesse. Barruel
raconte aussi qu'on a mis en vente au Palais Royal des pâtés de chair
humaine. Bertrand de Molleville Maton de la Varenne, racontent toute
une série d'histoires : la fameuse histoire de Mademoiselle de
Sombreuil buvant un verre de sang pour sauver la vie de son père, ou
de cet homme qui avait été obligé de boire le sang extrait du cœur
d'un jeune homme pour sauver ses deux amis ; ou encore, des
massacreurs de Septembre qui auraient bu de l'eau-de-vie dans laquelle
Manuel aurait versé de la poudre à canon, et ils auraient mangé des
petits pains qu'ils auraient trempés dans des blessures. Vous avez là
aussi la figure du débauché-anthropophage, mais dans laquelle
l'anthropophagie l'emporte sur la débauche. Les deux thèmes,
interdiction sexuelle et interdiction alimentaire, se nouent donc
d'une façon très claire dans ces deux grandes premières figures de
monstre et de monstre politique. Ces deux figures relèvent d'une
conjoncture précise, bien qu'elles reprennent aussi des thèmes anciens
: la débauche des rois, le libertinage des grands, la violence du
peuple. Tout ceci, ce sont de vieux thèmes : mais il est intéressant
qu'ils soient réactivés et renoués à l'intérieur de cette première
figure du monstre…
L'autodestruction de la nature, qui est un thème fondamental chez
Sade, cette autodestruction dans une sorte de monstruosité déchaînée,
n'est jamais effectuée que par la présence d'un certain nombre
d'individus qui détiennent un surpouvoir. Le surpouvoir du prince, du
seigneur, du ministre, de l'argent, ou le surpouvoir du révolté. ..
Il n'y a pas de monstre chez Sade qui soit politiquement neutre et
moyen : ou il vient de la lie du peuple et il a redressé l'échine
contre la société établie, ou il est un prince, un ministre, un
seigneur qui détient sur tous les pouvoirs sociaux un surpouvoir sans
loi. De toute façon, le pouvoir, l'excès de pouvoir, l'abus de
pouvoir, le despotisme est toujours, chez Sade, l'opérateur du
libertinage. C'est ce sur pouvoir qui transforme le simple libertinage
en monstruosité. (p. 93)
[...] la grille d'intelligibilité qui
a été posée par Freud à la névrose est celle de l'inceste. Inceste :
crime des rois, crime du trop de pouvoir, crime d'Œdipe et de sa
famille. C'est l'intelligibilité de la névrose. Après a suivi la
grille d'intelligibilité de la psychose, avec Melanie Klein. Grille
d'intelligibilité qui s'est formée à partir de quoi ? Du problème de
la dévoration, de l'introjection des bons et des mauvais objets, du
cannibalisme non plus crime des rois, mais crime des affamés.
(p. 96)
Il me semble que le monstre humain,
que la nouvelle économie du pouvoir de punir a commencé à dessiner au
XVIIIe siècle, est une figure où se combinent fondamentalement ces
deux grands thèmes de l'inceste des rois et du cannibalisme des
affamés. Ce sont ces deux thèmes, formés à la fin du XVIIIe siècle
dans le nouveau régime de l'économie des punitions et dans le contexte
particulier de la Révolution française, avec les deux grandes formes
de hors-la-loi selon la pensée bourgeoise et la politique bourgeoise,
c'est-à-dire le souverain despotique et le peuple révolté ; ce sont
ces deux figures-là que vous voyez maintenant parcourir le champ de
l'anomalie. Les deux grands monstres qui veillent sur le domaine de
l'anomalie et qui ne sont pas encore endormis — l'ethnologie et la
psychanalyse en font foi — sont les deux grands sujets de la
consommation interdite : le roi incestueux et le peuple cannibale.
(p. 97)
Sixième partie : De la suprématie de la Démocratie dans sa liaison avec la République.
En attente.
Septième partie : L'existence de la liberté comme postulat de la raison républicaine.
J’écris aujourd’hui une présentation de ma nouvelle idée de la liberté.
C’est dire que l’ancienne devait déjà être aliénée. Tout mon montage a
pu me laisser perplexe quant à l’emplacement à consacrer à la liberté
comme concept au sein des concepts psycho-politiques que j’ai souhaité
dégager de leur gangue médiatico-scolaire. Quel est donc le type d’objet
ou l’ensemble d’objets, de phénomènes, quel est le divers de mon
intuition qui a pu se trouver subsumé sous ce concept, liberté ?
Il m’apparait aujourd’hui que la réponse à cette question est plus ou en
tout cas tout autant conditionnée par la structure logique du rapport
des concepts fondateurs d’expérience : je m’explique :
La liberté est-elle donnée ou plutôt est-elle présente comme objet au
principe des situations paranoïaques ou des situations schizophréniques
? Ce n’est pas tant la seule phénoménologie psychiatrique de
l’expérience vécue qu’une conception logique du rapport des concepts,
qui aura déterminé en moi ce que je crois pouvoir attendre et comprendre
d’une liberté.
Je suis libre de subsumer les expériences vécues que je veux sous le
terme de liberté, mais je ne peux pas inconditionnellement le coller à
toutes les sauces (sauf si je suis un adepte de la politique
représentative électorale (voir description de la langue de bois chez
Franck Lepage sur le Net).
Je suis libre de placer la liberté dans un camp mais je ne peux pas la
poser dans les deux à la fois : pas sous le même rapport, sinon je
retombe dans l’amphibologie kantienne du concept de la réflexion.
Et la phénoménologie de l’expérience vécue des autres m’est imposée au
travers de l’histoire des concepts : je ne puis traiter de la position
logique du concept de liberté sans situer dans le même temps «
inconsciemment » (encore une acception de cet adverbe), les concepts
d’égalité, et de fraternité, mais aussi de travail-famille-patrie. Voir
la position de ces concepts dans le rapport logique qu’impose l’étoile
de Robert Blanché (qui se trouve par une sorte d’ironie renversée des
déterminismes, être l’étoile juive).
On dira en accord avec Lacan pour qui la liberté c’est la psychose,
qu’elle peut être pensée soit dans le camp de la schizophrénie, soit
dans le camp de la paranoïa, mais pas dans le deux à la fois. Cela va de
soi.
La Paranoïa comme liberté peut se comprendre à partir de
l’interprétation historique de personnages comme De Gaulle : il a choisi
le combat, la guerre, l’indépendance des états unis, l’arme et l’énergie
nucléaire, le nom du père, le rapport de respect au travail, l’autorité,
autant de paradigmes qui peuvent constituer pour la vieille Europe les
conditions d’une idéologie et d’une logique positive paranoïaque.
Mais la schizophrénie peut aussi bien se concevoir comme liberté à
partir d’un personnage comme le christ, en amont des lectures
exégétiques des différentes églises qui sont aussi forcement
l’interprétation parano d’une association positive du sabre et du
goupillon. Le Christ passe outre la paternité ici-bas pour la renvoyer
dans l’au-delà, le travail au service des sentiments et de la relation
et non l’inverse, la guerre intégrée ici-bas au présent de la relation
psychologique et affective dans une logique subjective paradoxale
(schizophasie des évangiles)( ne laisse pas la peur m’empêcher de te
suivre, …Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive).
Ajoutons que du point de vue de la psychologie de la culpabilité et de
l’économie de la dette, la névrose et son cortège d’angoisse n’est pas
compatible avec quelque position de liberté que ce soit, et c’est bien
en quoi je suis d’accord ici avec Lacan.
Amphibologie des concepts de la République: Travail et liberté, famille et fraternité, patrie et égalité. (Tab Blanché)

Que le travail soit l’antinomie de la liberté, que la famille soit l’envers de la ségrégation fraternelle, que la démocratie imaginaire matérialiste soit l’inverse de l’institution républicaine idéaliste, c’est ce qui pour notre éducation positive et scolaire n’apparait pas en première logique. Mais on pourrait aussi bien situer en haut la démocratie théorique inexistente dans les faits et en bas la République pratique hyper-réelle . Ces valeurs sont en conflits, et on voit bien par exemple se dessiner ces conflits dans toute la géographie ou géométrie argumentative qu’a développée Pierre Rosanvallon dans ses travaux sur l’histoire des institutions républicaines.
Mais que « travail-famille-patrie » soient des contraires c’est encore plus inhabituel puisqu’on les pense comme des lieux complémentaires, de même que « liberté-égalité-fraternité » sont alors des subcontraires: on ne peut pas ne pas être dans l’un, sans ne pas être dans l’autre : et ce sont tous des complémentaires selon trois positions. C’est toute la force du model de Blanché appliqué à des concepts qu'il n'aurait certainement pas accepté.
On voit bien que cette façon de passer de l’opposition à la complémentarité voire à l’équivalence indique une forte tendance à la confusion des contraires. Faut-il confondre ou distinguer, se confondre ou se distinguer ? On entend ici sonner les morales contradictoires du libéralisme et de la démocratie populiste la plus mal notée.
Leibniz avait-il tort ou raison de confondre presque par principe l’objet et son concept, et de rendre ainsi indiscernables les occurrences de l’objet avec ce concept, ou aurait-il dû chercher à toute force à rendre distinct chaque occurrence du concept sous le titre d’un objet particulier ? Particularité de l’objet et universalité du concept constituent les repères pour éviter une confusion que Kant reproche à Leibniz, mais aussi bien cet « amalgame » réalise-t-il le vécu « in situ » du rapport aux choses tel qu’il nous arrive ou telles qu’elles nous arrivent.
Peut-on avoir « liberté et égalité et fraternité » ou bien est-ce « ou-ou » ?
De même pour « travail, famille, patrie ».
La formule logique mais aussi la sensibilité commune nous indique pour le premier les « ou » et pour le second les « et ».
|
A affirm univ T |
T.Z |
E négat univ Z |
|
|
|
|
|
I affirm part LZ |
LT.LZ |
O négat part LT |
Mon amphibologie volontaire des niveaux et des plans de lectures des phénomènes psychologiques et politiques.
C’est un parti pris méthodologique de ma part. Je le dois aux idées de
Deleuze et Guattari … qui ne cessaient de dire que le délire est un
phénomène politique. C’est la fameuse théorie du « micro-politique » :
par exemple je pense que la névrose est aussi un phénomène politique à
l’échelle de la personne. La névrose est toujours plus ou moins
l’expression psychopathologique de la réalisation des idéaux de la
bourgeoisie. Idéaux aristocratiques, et idéaux socialistes. De la même
façon, la psychose réalise l'expression des idéaux paranoiaques des
monarchies réelle tout autant que les idéaux prolétariens des
démocraties potentielles.
Et au fond ce n’est pas une amphibologie problématique ou déficitaire
que je viens ici dénoncer, mais une amphibologie critique et salutaire
visant à résoudre les méfaits structurels de l’idée délirante de
distinction positiviste du capitalisme narcissique historique : la
distinction des phénomènes du monde en « psychologiques » et «
politiques » et toutes les distinctions qui vont de pair, constituent
une croyance, une religion, la religion du sujet, celle qui démarre
vraiment avec la renaissance, au moment où les conditions de la critique
kantienne commencent à apparaître dans le monde intellectuel, au moment
où se pose la question de la «réflexion», au moment de la perspective,
du miroir, de la chambre obscure, de la lunette et du microscope,
de la phrénologie, des classifications, à l’issue de l’amour courtois.
On se persuade d’être capable de distinguer des domaines qui font
postuler une autonomie du sujet de la parole et de la pensée. On se
persuade avec Descartes d’être capable de distinguer l’esprit et la
matière, et bientôt avec Kant la culture et la nature, l’entendement et
la sensibilité. On se persuade d’être capable de liberté, ce qui n’avait
de sens auparavant, qu’en tant qu’appartenance de classe sociale, en
tant qu’homme non esclave, et en tant que citoyen d’une « république ».
Il y a donc un ménage à faire avant d’envisager toute condition d’une
critique de la pensée critique.
La pensée critique de la pensée critique n’est pas une simple pensée
critique puisqu’elle est une pensée critique à la deuxième puissance.
C’est en quoi on ne doit pas confondre la critique déterminante de
l’objet qu’elle considère, et la critique réflexive qui s’adresse à son
propre jugement. Le monde communiste aujourd’hui disparu ne s’y était
trompé qu’à moitié, puisqu’il avait utilisé comme mécanisme stigmatisant
et culpabilisant le rituel de l’autocritique. Simplement il n’avait pas
pris en compte ou pris au sérieux, l’intérêt intellectuel de la
démarche. On peut d’ailleurs considérer que le capitalisme dérégulé fait
la même chose en dispensant de la même façon tous ses apparatchiks de la
moindre autocritique, et en taxant non pas les consommateurs, mais les
endettés ce qui revient souvent au même, d’énormes plus-values.
Nous avons donc, dans un sens comme dans l’autre, tout à gagner en
termes de qualité de conscience et de qualité du système politique, à
réaliser que la distinction que nous opérons entre les dispositifs de
notre conscience et ceux du régime politique auquel nous appartenons
sont les deux faces d’une même monnaie, qui n’est sonnante et
trébuchante que pour autant qu’elle est rigide, c’est-à-dire
métallique, c’est-à-dire inscrite dans un système de valeurs
matérielles, dures, mathématiques et sans phrases, mais en définitive
d’autant plus justes qu’elle sont plus dures, c’est-à-dire plus
métalliques. Revenons au Franc, revenons à l’or, revenons au plancher
des vaches. Aux choses en soi. Mais comment le faire sans "réifier"?
Sans passer par la perversion d'un vécu ou d'un régime?
Méthodologie:
Méthodologie de la République.
Chapitre I : La discipline. (Platon) (Hegel) (De Gaulle) Constitution.
La République est la forme de la nation qui fonctionne sur le mode
prescriptif et qui, en paiement d’une protection, exige des habitants
une discipline.
Un ensemble très hétéroclite de modèles historiques nous apparaît avec
les imagos paternelles des Républiques remarquables de l’histoire: on
peut citer les visions de Platon, de Hegel, de De Gaulle, mais on
pourrait aussi penser à la République de Weimar, à la troisième
République française.
On voit bien que «Travail, Famille, Patrie» illustre les bases d’une
discipline dont la République pose les lois, à la différence des
«Liberté, Egalité, Fraternité» qui illustre les règles politiques non
moins exigeantes de la Démocratie, que je gratifie aussi d’une majuscule
car je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas y prétendre.
On peut s’amuser à faire figurer ces concepts, que j’appellerai plutôt
des préceptes, sur le double triangle en opposition contradictoire de
Blanché selon la géométrie suivante:
Voir Amphibologie des concepts de la République. (Tableau Blanche
Politique)
J’avais ajouté sur ce schéma les formes princeps que Piaget appelle
« affirmation et négation de p et de q», et surtout l’axe
supplémentaire qu’il génère dans le schéma pour en confirmer
l’organisation en quaternes par la mise en évidence de l’affirmation
complète et de la négation complète.
On voit donc ici en verticale les bases des deux triangles de Blanché.
Les deux triangles à bases horizontales constitués par les prédicats
totaux de Piaget ne qualifient pas des contraires ou des sub-contraires
mais posent le problème de leur « inversibilité » folle : on peut tout
changer sans que la cohérence du système se perde.
On peut s’amuser à lire cette structure spatiale des concepts comme
rédigée sur deux portées complémentaires :
Une base stable œdipienne républicaine reposant sur l’interdit de
l’inceste du premier type, l’Europe viennoise, l’Angleterre victorienne.
(Une monarchie parlementaire étant objectivement partie intégrante de la
structure républicaine).
Une base plus mobile, en phase liquide ou gazeuse démocratique reposant
sur l’interdit de l’inceste du deuxième type et s’originant dans les
habiti libertaires libertins de la noblesse décadente et de la
bourgeoisie du XIXème siècle d’après la restauration.
On voit bien sur cette écriture les rapports d’antinomie entre les deux
consistances politiques du jugement praticables dans les conditions de
la «modernité» ou de la «postmodernité».
On voit bien aussi comment dans la dite modernité, ces termes ont
focalisé les options et les oppositions possibles en une géométrie non
euclidienne mais assez rigide et déterminante pour la raison pure
occidentale.
Chapitre II : Les canons.
En attente. Voir: (Constitution) Association d’André Bellon : Constituante.
Chapitre III : L’architectonique. Rigidité de la structure : la domination de la pensée bourgeoise.
La question de la structure parait innocente au néophyte, mais elle est
déterminante du rapport lui-même des classes et des êtres. Elle est
aujourd’hui très largement méprisée par la mouvance pragmatiste et
positive du monde intellectuel adapté au libéralisme. Il n’y a pourtant
pas de vie sociale sans un jeu structurel sur la base de règles
formelles, ce que Bourdieu appelle « règles du jeu ». La vie humaine est
la partie de la vie biologique ou de la vie de la nature qui joue avec
ses propres limites dans la nature. Avec les limites de soi.
Hors les limites de la vie humaine, que l’être y soit individuel comme
dans la modernité, ou social comme dans tout récit des origines chez les
anciens, ces limites de l’humanité sont les limites de ce qui permet le
libre jeu d’une structure : l’homme ne peut penser sa liberté que dans
un structure contraignante, dans l’espace d’un ensemble de règles qu’on
peut appeler « juridiques » ou « morales », mais qui conditionnent la
possibilité de cette «liberté » devenue symbolique de sa propre place
dans la nature : l’homme est l’animal dont la liberté ne peut être
distinguée que dans un rapport de société.
La structure pour impensable qu’elle soit à beaucoup, reste une
contrainte nécessaire à toute désaliénation possible : on ne peut
s’émanciper d’une structure de contrainte que par la contrainte d’une
autre structure intériorisée et intégrée.
« Une structure suppose tout d'abord une notion de totalité,
c'est-à-dire, d'un ensemble d'éléments qui comportent des lois en tant
que système et des lois différentes des propriétés des éléments
eux-mêmes. » dit Piaget dans son article sur « Le structuralisme » paru
en 1969 dans les Cahiers internationaux de symbolisme, 17-18. (Voir
aussi le « Que sais-je ?) Pour Piaget le structuralisme est une méthode
scientifique et non une doctrine.
C’est de la doctrine susceptible d’émaner des différents structuralismes
historiques que les pensées actuelles du libéralisme pensent avoir tout
à craindre. Elles ont peur de tout sauf du laisser-aller et de la main
invisible. Pourtant je trouve que ces deux outrances font plutôt peur.
Structure politique du rapport des classes.
Structure mentales du rapport des êtres.
Structure du rapport des deux précédentes avec les formes
d’impossibilités que cela stipule.
Il est difficile d’exprimer quelque pensée que ce soit qui ne soit par
sa nature même de pensée conditionnée par la structure du champ (terme
foucaldien de la première époque) dont sont extrait les éléments
comparés ou discutés.
Le refus d’accepter l’hypothèse de la structure participe d’un empirisme
de bon aloi en son départ puisqu’il veut donner toute la place à
l’expérience pure. Seul compte le donné tel qu’il est reçu par le sujet
de la perception. Mais c’est oublier que celui-ci reçoit les par les
antennes d’un système d’intégration qui met en œuvre les outils les plus
variés et n’a pas sitôt intégré un objet qu’il est passé au crible de
ses expériences antérieures, comparé, interprété, jaugé à l’aune
d’innombrables systèmes de valeur, de classement, de mesure, et en fin
de compte, de jugement.
On peut toujours dissimuler les structures de l’expérience sous le
bureau de l’expérience, c’est-à-dire oublier qu’on fait l’expérience, il
n’empêche que l’expérience réelle dans les conditions du monde réel ne
donnera jamais les mêmes résultats si les cadres ou les conditions
structurels de la réception de deux objets semblables ou de deux
évènements semblable diffère un tant soit peu.
Chapitre IV : Les chantiers républicains de l’Histoire. La IIIème République et le devoir de mémoire.
Il n’y a jamais identité entre le souvenir et les preuves objectives de l’évènement.
Postulat d’un être qui serait machine
d’enregistrement :
Point de vue : bonhomme de Laplace.
Constitution scolaire du « savoir ».
Voir texte : « L’âme est moire. »
Chapitre V : Euphémisation (et amphibologie?)
Formule générale de la politesse pour l’entrainement des foules,
l’euphémisation est le modèle du gouvernement par la promesse. On peut
dire que c’est à Bourdieu que revient le mérite d’en avoir distingué la
formule et reconnu la puissance dans le champ social. Elle peut faire
penser à l’échelle de la politique des adultes à ce que l’on applique
spontanément dans la mauvaise éducation prodiguée aux enfant que l’on
veut intéresser à ce dont on considère que ça doit intéresser les
enfants. Pour les adultes l’euphémisation passe presque systématiquement
par le filtre de la représentation.
L’un des objets les plus outranciers et devenu totalement inconscient de
la pratique de l’euphémisme dans les Républiques et par les Républiques
est appliqué au concept lui-même de la démocratie : il n’est pas une
institution des Républiques qui ne se prétende des idéaux et des
réalités de la démocratie. La disparition concomitante du concept
d’oligarchie réalise une véritable lésion à l’endroit du moindre bon
sens politique, mais celui-ci est tellement étouffé dans l’œuf universel
du suffrage des représentants, que la nature démocratique des
institutions les plus oligarchiques et les plus crapuleuses apparait
dans le théâtre médiatique comme démocratie sainte et parfaite.
Une question se pose entre « amphibologie » comme confusion de concepts
antinomiques et fondateurs, et euphémisation comme attitude de
gouvernement ou de domination amenant l’individu, ou le groupe, à
prendre des vessies pour des lanternes, ou des institutions pour ce
qu’elles ne sont pas, bien au contraire ….
On voit que l’un est l’attitude qui consiste à induire sciemment ou plus
ou moins inconsciemment la confusion, par opposition à l’autre qui est
le résultat de cette confusion et la soumission aux intérêts qui la
souhaitent.
Prendre une oligarchie bourgeoise pour une démocratie réalisée, c’est le
sentiment vécu du citoyen de base de la République française à longueur
de journal télévisé ou de lecture du Monde (je parle du journal, celui
qu’on lit d’autant plus qu’on est moins sensible aux réalités du monde).
Donc l’euphémisation non seulement existe et n’est pas une conception
purement théorique de Bourdieu, mais en outre elle est réalisée dans la
conscience servile de tout un chacun qui vote encore pour des
représentant quelle que soit sa bonne foi et sa qualité humaine.
Chapitre VI : Ne pas répondre.
Laisser faire-laisser passer comme laisser dire-laisser-pisser.
Laisser dire peut être une façon très efficace de gouverner et de
dominer puisque c’est invalider la valeur ou la puissance d’un dire.
C’est la censure qui se censurant en tant que censure, annihile d’autant
plus efficacement l’être censuré en tant que tel. Cela stipule bien-sûr
une République tellement sûre d’elle qu’elle puisse se permettre de
laisser dire. Cela fonctionne donc de pair avec un narcissisme collectif
qui n’est le propre que de la très grande institution sûre de l’amour
que lui vouent ses sujets. On voit mal les tyrans, les dictateurs, les
despotes utiliser cette technique de domination évoluée. Il faut en être
passé par les organisations panoptiques des sociétés de contrôle pour
pouvoir sans risques relâcher cette pression que les différents «
paternalismes » n’avaient pas pour puissance d’abandonner facilement.
La République a trouvé son plus haut raffinement depuis les formules
d’autorité de la troisième et des autres avec cette formule discrète et
impensable de la République irresponsable.
Chapitre VII : Scandale.
La République pose certains problèmes à tout acteur républicain qui
conçoit le monde social comme une réalité : le scandale de la République
ce n’est pas que les représentants, les parlementaires, les présidents,
les maires, les préfets soient naïfs ou cyniques, incompétents ou
mafieux, égocentriques ou paranoïaques ou hystériques, ce n’est pas que
le concept de démocratie soit utilisé à tout bout de champ pour désigner
des régimes oligarchiques bourgeois ou des monarchie parlementaires
déguisées en démocratie.
Non le scandale de la République c’est l’existence des syndicats, qui
bénéficie d’avantages octroyés par la République, pour organiser leur
revendication d’une certaine manière qui comme le veulent les structures
de la République bénéficient aux apparatchiks des syndicats et en aucun
cas aux militants de la base qui croient qu’il y a une base et qu’ils en
font partie.
Le scandale c’est que des acteurs sociaux peut nombreux au regard des
masses mais nombreux localement lors des festivités revendicatives
organisées par la République, descendent dans la rue pour exprimer des
critiques contre des institutions et des représentants pour lesquels ils
ont voté. Cela est scandaleux!
Le scandale de la République des voyous discrets ne réside pas tant dans
les institutions que dans la conscience coupable et malheureuse, mais
âpres aux bénéfices dissimulés du citoyen moyen qui érotise l’élection
et la sélection pour se prémunir de ce qu’il considère comme les risques
de ce que serait un véritable démocratie de partage des pouvoir et des
biens, de tirage au sort, de vigilance institutionnelle.
Il est scandaleux qu’un ensemble de copains pistonnés par des
instituions spécialement destinées au piston des petits gladiateurs de
sa représentation, syndicale ou non, les barricades ambulantes
officielles de la République, soient représentées au journal officiel
comme représentations objectives ou « statistiques » de l’ « opinion ».
Cela est scandaleux par rapport à l’opinion réelle des travailleurs
souffrants et modestes qui savent rester à leurs places de travailleurs
modestes, ce qui est d’ailleurs un pléonasme si toutefois on parle de la
réalité du travail, et non pas de la représentation du travail, ce qui
n’est jamais la même chose.
Le scandale de la République, c’est d’ailleurs typiquement et uniquement
le problème du travail.
Il est vrai que « le problème du travail », ça peut sembler imprécis, et
ça peut sembler un « faux » problème soulevé ici de façon inadéquate et
déplacée. C’est ce que la conscience bourgeoise argumente toujours. Le
travail à un tropisme naturel à être concerné par le scandale. Non que
le travail soit scandaleux en soi bien au contraire, puisqu’il est
scandaleux de ne pas faire son « travail », ou de ne pas avoir de «
travail ». Ce qui n’est jamais envisagé dans ce montage logique, c’est
spuisse être scandaleux en soi. Ce qui est scandaleux dans la
République, c’est aussi de poser ou de penser que le travail puisse être
scandaleux en soi. C’est de penser que le scandale, ce soit de favoriser
les conditions d’une culture du travail. C’est-à-dire d’une
représentation de la nécessité de travailler comme valeur essentielles
de la République, de Jules Ferry à Luc Ferry.
Je répète donc pour qu’on m’entende bien : ce qui est scandaleux ce
n’est pas tout ce qui ne va pas autour du travail, c’est le travail en
tant que tel, et en tant que concept. C'est le fait que le travail
existe dans une société qui pourrait parfaitement s'en passé, quoiqu'en
dise le bon-sens libéral visant à mettre au travail, les acteurs sociaux
du libéralisme.
Chapitre VIII: Représentation méthode.
Seul le débat dans les conditions du désir de parole des acteurs et du
maximum de liberté des mêmes acteurs, est susceptible de produire des
temps de pensée favorables à une analyse des OCR :
organisateurs collectifs du refoulement. J’ajoute souvent collectif mais
ce n’est pas forcément nécessaire, car le refoulement individuel et à la
fois la résultante et la cause du collectif et réciproquement.
C’est une théorie osée de la psychanalyse, de poser qu’une liberté soit
à même de favoriser la levée des refoulements. Les psychanalystes
dogmatiques, qui ne manquent pas, défendent plutôt la thèse de la
psychanalyse génératrice de liberté. Ce n’est pas mon idée, ni mon
expérience. On pourra toujours dire que c’est par échec ou incomplétude
de mon propre parcours dans cette noble corporation. Je n’en doute pas.
Mais je ne vois pas non plus ces effets de liberté chez les autres,
thérapeutes ou patients.
Par contre que le débat dans les rarissimes conditions où il peut se
développer ait des vertus émancipatrice, j’en constate les effets sur
moi et sur autrui, avec cette limite très draconienne de remplir ou de
rencontrer les conditions d’un tel débat.
Le refoulement collectif (concept très large) façonne la forme des
institutions de la nation, de l'état, de la République, mais aussi celle
des institutions internationales, qui n’en sont pas moins républicaines.
Le débat de même peut se dérouler en théorie à tous les niveaux de ce
que la planète recèle comme espaces d’échanges, quand et seulement quand
une initiative en a permis l’éclosion. Et ce n’est certes pas l’espace
parlementaire qui risque de remplir cette fonction bienheureuse pour
l’humanité souffrante.
Il nous appartient donc aussi bien individuellement que collectivement
de remuer autant que faire se peut le bocal des conditions de
possibilité du débat, ce qui peut se comparer à la recherche de l’or par
les mercenaires d’un pays encore peu occupé et exploité.
Pourquoi les strictes conditions du débat démocratique seraient elles
plus que d’autres favorables à la critique du refoulement collectif ?
Pour la même raison que l’association permet en psychanalyse l’émergence
de signifiants refoulés: la liberté n’est pas qu’un phénomène
individuel: toute liberté conditionne des évènements et des prises de
consciences communes, et est conditionnée par elles.
Un débat est une association fragile et temporaire qui force la
production du sens critique. La machine critique kantienne est sensible
au forçage de la rencontre quasi aléatoire de signifiants politiques.
Ceux-ci existent en puissance dans le discours commun de toute société.
Ils existent en acte lorsque les conditions de la liberté du débat sont
remplies. Mais tout et tous concourent dans la République bananière et
jacobine, à ce qu’elles ne le soient pas. Et il en est de même dans la
république mondiale des paradis fiscaux et du secret bancaire.
On voit donc que dans tout univers politique les OCR sont immédiatement
antinomique aux conditions du débat «réel» et réciproquement. Seul donc
le «débat» purement démocratique permet comme espace distinct de lieu et
de temps de réunir les conditions d’une analyse réelle des OCR, comme il
en est en psychanalyse de la «technique des associations». On entendra
ici le terme «association» au sens d’un usage «réel », c-à-dire qui va
bien au-delà est reste bien en deçà des systèmes de récupération
commandités par la loi de 1901 en France par exemple. Le lieu du débat
se constitue plutôt là où il y a des associations qui ne se déclarent
pas ….
La «déclaration» en tant que prophétie auto-réalisatrice, la
«déclaration de soi», l’auto-institution, l’officiel dans l’acte de sa
propre représentation, la représentation « officialisante » de
l’officiel, toutes ces attitude d’autorité constituent in situ les
opérateurs collectifs du refoulement: ça veut dire : «On ne
questionnera plus la validité de l’institution, on ne mettra même plus
en question sa valeur, on intègre l’autorité en tant que telle, on
l’accepte et on s’y soumet.»
Le refoulement collectif a pour finalité la servitude volontaire. Il
conditionne l’acceptation inconditionnelle de l’autorité. Il réalise
l’antinomie radicale du débat.
Méthodologie de la Démocratie.
Chapitre I : Analyseur collectif des forces de refoulement collectif.
Une action sociale est-elle possible dans le sens d’une analyse
collective des conditions du refoulement collectif: c’est la question du
débat et du désir de débat qui est en question, c’est-à-dire la question
du désir de démocratie.
J’ai longtemps cru qu’une telle action serait possible du fait du désir
universel de démocratie dans l'«inconscient collectif» des masses
travailleuses. J’ai compté sans le refoulement collectif bourgeois dans
l’inconscient collectif des masses travailleuses.
Faut-il pour autant renoncer à toute opération d’appel à débat (c’est le
nom que j’avais donné au site que j’avais dédié à cette opération).
J’ai mis entre guillemets le terme «inconscient collectif» car la
question du refoulement et de l’inconscient est encore chaude à cet
endroit: les masses travailleuses refoulent sans doute tout ce qui fait
leur aspiration au débat et à la démocratie, au bénéfice de tout ce qui
peut constituer leur désir refoulé d’embourgeoisement.
Dans un tel contexte, on comprend mieux pourquoi toute opération de mise
en débat de quelle question politique que ce soit, est vouée à passe
sous les fourches caudines des lois «le chapelier» encore largement à
l’œuvre inconsciemment, de la lutte bourgeoise pour la représentation,
c’est-à-dire des médias. Les médias sont au fond le lieu de naissance de
la pulsion d’exercice démocratique et sont en même temps les
croque-morts de la démocratie directe. Si l’on pense comme c’est mon
cas, que seule est vraiment «démocratique» la forme directe de celle-ci
(ce qui n’est pas celui de Pierre Rosenvalon par exemple), on comprend
l’intérêt politique que j’adresse aux medias…
Une critique du refoulement collectif de la représentation passe donc
probablement par une critique des médias. Certains s’y sont attaqués
avec courage, talent, et détermination. Je pense à Pierre Carles en
particulier. On ne peut pas dire que ces initiatives soient porteuses
d’effets fulgurant dans la réalité publique. Il faut dire que la
fascination par les médias nuit à la puissance critique de la guerre
contre les médias. On pourrait dire la même chose du pouvoir, au sens où
Foucault employait ce terme dans sa première période: la fascination
pour le pouvoir nuit à la critique du pouvoir. On pourrait dire la
même-chose aussi pour le monde syndical. Tous ces univers de référence
constituent forcément peu ou prou, des positions paranoïaques. Pour
accéder aux conditions d’une action collective même microscopique (micro
politique, mais pas forcément au sens de Deleuze) dans le sens de cette
critique opérée par un sujet, et mise en commun pour un réseau (rhizome
au sens de Guattari), il faudra ou il faudrait sûrement que chaque
acteur soit susceptible de passer la barrière de toutes ces fascinations
(et donc de tous les fascismes) et de tous les refoulements
correspondants.
Une pratique démocratique du débat violant la loi tacite des bonne mœurs
du débat est-elle possible dans le champ des sociétés protégées par leur
pratique euphémique et narcissique du concept de démocratie, je veux
dire par les sociétés riches et «avancées» (de moins en moins
d’ailleurs), de ce qu’on pourrait appeler l’occident positif? Cela
stipule de toute façon un viol, ou une transgression.
"La pureté des principes, non seulement tolère, mais encore requiert des
violences. Il y a donc une mystification libérale." Merleau Ponty
Chapitre II : Des clips de moins de cinq minutes.
Pour ne pas emmerder avec de longs discours présomptueux, même si je
sais qu’on me reprochera les présomptions du mien ….
La maladie du monde de la représentation se joue dans la recherche de la
compétence, du savoir, de l’autorité. La forme ou la figure consacrée de
cette représentation dans le domaine intellectuel, c’est le cours, la
conférence, le long discours. (Il s’agit ici de la parole : on pourrait
faire les mêmes remarques sur le livre par opposition au « papier », au
courrier personnel plutôt qu’au mailing, au billet d’humeur plutôt qu’à
l’éditorial, …). Tout l’habitus de la République utilise cette structure
de l’ouvrage ou de l’œuvre (si possible académique) pour faire taire le
débat et l’échange qu’appellent les très refoulées aspiration à la
démocratie là où elles se cherchent ou se cachent.
J’opte donc pour une forme à la fois plus modeste (même si mon
initiative n’a rien de modeste), plus maniable, plus légère, plus
émancipante (au moins pour moi) en tout cas moins autoritaire, moins
aliénante, plus pratique, sans perdre si possible de puissance de
justification théorique : des clips court (moins de cinq minutes)
développant rapidement - soit un thème vaste de façon totalement
synthétique et en survol, (têtes de chapitres) - soit un thème
extrêmement circonscrit dans le cadre d’un plan ou de plusieurs plans
croisés (schéma, diagramme, tableau à double entrée). Peut-on parler d’
« interactivité » ?
Cette méthode pourrait ne pas préjuger de l’objet et ne traiter que de
la manière de présenter une pensée (en l’occurrence la mienne, sans que
cela ne lui soit réservé), mais je pense qu’elle pose en substance la
nécessité et la vertu d’un échange possible dans le débat ouvert à tous,
qui s’appelle celui de la démocratie. On voit bien que le thème inhérent
à la méthode sera inéluctablement (mais peut-être pas exclusivement) la
discussion des conditions, des réalités et des possibilités de la «
démocratie » comme concept et comme objet.
Donc moins de cinq minutes, règle d’or.
Chaque argument pourra alors être étayée ou complétée de remarque
subsidiaire optionnelle et facultative, dépassant alors le temps imparti
et l’auditeur pressé ou simplement rigoureux pourra s’abstenir de le
suivre pour aller à l’argument suivant.
***
Remarque subsidiaire et facultative/
Cette formule kantienne (concept et objet) sera souvent employée
car elle est au principe de l’argument de Kant sur l’amphibologie de
toute réflexion possible telle que pouvait à son sens la commettre
Leibniz avec ses indiscernables, et elle est aussi au principe de l’idée
d’euphémisation employée par Bourdieu pour désigner la procédure
générale de « colinéarisation » (Lordon) ou d’une façon générale
d’injonction-instillation de désir affilié, par tous les acteurs qui
veulent sciemment ou inconsciemment, s’approprier le pouvoir de définir
les conditions collectives du désir ou les conditions du désir
collectif.
Disons au passage que ce type de chiasme
à la Marx ne sera pas évité par principe par mes soins même si je sais
qu’il peut être mal jugé avec une arrière-pensée de jeu gratuit et
facile portant sur les formules, la facilité n’étant pas une raison
d’exclure une argument s’il est probant.
Chapitre III : Répondre.
La responsabilité des personnes ne fait que reprendre l’image en miroir
de la responsabilité des institutions qui s’est passablement gâtée
depuis la constituante, pour ce qui concerne la République française.
Répondre en parole à une tribune ou depuis l’espace dit « public » à une
parole, voilà ce qui est apparu avec les « révolutions » comme
possibilité nouvelle ou résurgence depuis le monde « agoraïque » (pour
reprendre un néologisme de Philippe Mengue) de la Grèce antique, ou
depuis le « parlementarisme » romain, si tant est qu’on puisse parler de
« parlementarisme » dans les lieux où toute parole peut mettre en danger
de mort réelle et non uniquement institutionnelle son auteur.
Toute position de « réponse » comporte une sorte de positivité logique
primordiale qu’on a stigmatisé de ce beau terme psycho-politique de «
responsabilité », mais au fond elle est tout aussi porteuse d’une
négativité fondamentale, répondre c’est toujours nier quelque chose, qui
fait la richesse de la position dite depuis Kant « critique », et c’est
cette indécidabilité qui fait toute la difficulté d’appliquer le carré
logique d’Aristote à la « décision des concepts » en matières politique
et psychologique.
L’idéal de la position de responsabilité étant bien-sûr la «
responsabilité critique » (on sait tout ce que Kant a élaboré sur la
question de la « responsabilité »). On voit bien d’ailleurs que le «
calage » de l’interprétation du terme sur l’une des deux positions ne
peut donner lieu qu’à la pratique d’un « totalitarisme » logique,
c’est-à-dire d’un « totalitarisme » tout court.
La magnanimité et la modernité de la République démocratique « moderne
», par opposition du moins à celles de l’antiquité, c’est de remplacer
la menace de mort réelle des régimes totalitaires par la menace de mort
institutionnelle dont on voit tout le spectre s’exercer sans concession
autour de la machine électorale. A ce sujet, on pourrait imaginer que la
Cité Athénienne démocratique aurait probablement été totalitaire en tant
que République.
C’est donc en tout cas autour d’une question de pure logique
aristotélicienne que se joue le caractère totalitaire ou non des régimes
politiques.
Chapitre IV : Contre Nietzsche.
Nietzche s’est prononcé en autres contre la démocratie : je peux bien
me prononcer contre Nietzche. Ca ne conclue rien.
Je suis pour l’annulation du nihilisme distingué des nietzschéens, pour
le refus du refus de la démocratie distingué des deleuziens, pour la
négation de la négation radicale des logiciens ringards de la tradition
aristotélicienne jusqu’à Kant et même Lachelier, pour le renoncement
positif au positivisme d’Auguste Comte.
Je suis pour une logique intuitionniste, pour une politique de la
subjectivité, pour une démocratie non représentative. On est donc loin
de Nietzsche. Même s’il faut en passer par des étapes sur la
constitution desquelles il a pu laisser sa trace (je pense à
l’importance de Nietzche pour Guattari par exemple et pour les
postmodernes en général).
On ne peut pas demander à un quelconque surhomme de régler une question
de collectivité politique planétaire, quand on voit ce qu’ont réalisé
tous les surhommes de l’histoire, y compris Nietzsche lui-même, qui a
seulement oublié de critiquer les conditions de possibilité de sa propre
appartenance à cette catégorie sociale des dieux vivant sur terre.
Sa position par rapport à la religion a pu certes aider des légions de
petits soixante-huitards à se constituer un narcissisme digne de ce nom,
mais elle ne permet aucune réflexion du concept politique de démocratie
et du concept de démocratie politique, malgré toute l’érudition de ce
dernier sur la question grecque (non pas économique, mais politique … je
plaisante!).
Je postule même que l’élitisme enthousiaste pour la mort du dieu peuple
a fait avec Nietzche des ravages dans les têtes adolescentes de 68 qui
gouvernent aujourd’hui encore la France bourgeoise et l’Europe cossue,
dont les «travailleurs-travailleuses» ont eu tout à pâtir au vingtième
siècle et n’en ont d’ailleurs pas encore fini.
S’il reste que le «style conceptuel» de Nietzsche présente un intérêt
esthétique dans toute considération même intempestive de l’histoire de
la subjectivité, je ne vois pas comment on peut articuler ces beaux et
riches concepts dans le sens d’une critique de l’économie du sens, du
travail, et de la valeur.
La totale ambiguïté du système de pensée Nietzschéen réside dans l’usage
massif et épicritique du terme de démocratie: il méprise toute
entreprise de gouvernement démocratique sans réfléchir un seul instant
le problème de la représentation. On voit qu’il n’a pas connu la télé.
Mais il n’était pas besoin de télé même à son époque, pour comprendre le
jeu pervers de la représentation dans les institutions de pouvoir dont
il a tout de même pleinement bénéficié. La fonction et l’autorité du
pouvoir nominaliste de tout usage de la langue aurait du alerter
l’esprit romantique du penseur des cimes dont avait accouché le vaste
territoire des monarchies germaniques. Rien n’en fut: toute démocratie
était par essence méprisable comme sa plèbe. Il fallait à toute force se
méfier des idéaux et des sirènes de cette idéologie dangereuse du siècle
en cours. Il fallait en toute société se garantir du recours à
l’esthétique et à la grandeur des traditions et des récits monarchiques,
du culte des héros, de l’idéologie nobiliaire.
Chapitre V : Subversion de la subversion.
Je suis pour la subversion de la subversion. Au nom de la démocratie.
C’est du moins le chemin qui permet qu’une démocratie ait un nom.
Je ne suis pas pour la subversion. Je me méfie trop des subverti
récupérateurs: toute subversion non subvertie en tant que subversion est
immédiatement récupérée par les instances de domination qui sont par
essence attachée à la méthode de "récupération" : on l'a vu avec les
post soixante-huitard bien-pensants et gouvernants : ils sont encore là
!
Je ne suis pas pour la réaction, qu’elle soit de racine noble ou
bourgeoise. Il y a même une réaction ouvrière, ni pire ni meilleure que
ces dernières.
Je suis pour la subversion de la subversion : Je suis comme Dali : J’ai
horreur de la simplicité. La simplicité logique du système républicain
de la pensée positive est tout simplement fausse !!!
Subversion du sujet disait Lacan ! Moyen en quoi il n’a pas subverti les
groupes et les chapelles qui se sont autorisés de lui. Il les a
seulement laissé se subvertir tous seuls. Ca a d’ailleurs bien marché.
Mais seulement pour le premier degré de la subversion : celui du théâtre
des sentiments , de la société du spectacle, de la télé et des
médio-média.(attention à la référence au théâtre : pb des « théâtreux »)
Je ne suis pas pour l’affirmation des dogmatiques.
Je ne suis pas pour la négation des opposants inconditionnels parvenus
et adaptés.
Je suis pour la négation de la négation, cette formule logique qui
trouble tout l’occident positif de sa problématique dialectique
intraitable, mais qui laisse survivre l’humanité des options faibles,
des non choix, des sentiments moraux.
Chapitre VI : Logique intuitionnelle : Double négation problématique.
EN ATTENTE Voir: Une
réflexion sur la double négation" dans la partie "logique
subjective" de mon site:
http://melchisedek.free.fr/encoreuneffort/ .
Travaux Pratiques au sujet de Jean Rodriguez : 9 VIDEOS
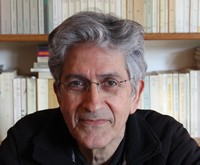 Jean Rodriguez |
Face à la violence au travail, que peuvent faire les médecins ? |  Jacques Roux |
|
| Pétition pour soutien au Dr Rodriguez | |||
| Signez la pétition | |||
| La violence
subie au travail génère-t-elle des maladies comme les autres? Depuis la médiatisation du suicide de nombreux salariés de France-Télécom Orange, ayant débouché en 2012 sur une mise en examen de l'entreprise et de ses anciens dirigeants pour harcèlement moral, les Risques Psycho-Sociaux ont enfin été reconnus comme un enjeu de santé publique. A la demande d'employeurs, le Conseil de l'Ordre multiplie depuis peu les poursuites disciplinaires à l'encontre de praticiens spécialistes des risques psycho-sociaux, médecins du travail et psychiatres (ici le Dr Rodriguez) pour avoir certifiés le lien de causalité entre condition de travail et troubles psychiques. Pourquoi un tel acharnement alors qu'en d'autres situations (cas de viols ou d'internement illégal) le Conseil de l'Ordre se montre bien moins virulent? A travers de courtes vidéos nous allons tenter d'expliquer tous les points qui peuvent être difficiles à comprendre pour un public non averti. |
|||
| VIDEO N°1 | N°1 – Qui sommes nous ? Un psychiatre d'exercice public : le Dr RODRIGUEZ Jean, psychiatre poursuivi par le Conseil de l'Ordre des médecins. Un psychiatre d'exercice privé : le Dr ROUX Jacques psychiatre poursuivi par ses questionnements sur cette poursuite. |
N°2 - Introduction: Situe l'ensemble de ces vidéos dans le cadre de la pathologie psychique au travail. |
VIDEO N°2 |
| VIDEO N°3 | N°3 – Travail: Spécificité de la souffrance au travail. Pourquoi le travail déclenche-t-il une telle crispation des institutions ? N'y aurait-il pas là une finalité politique? |
N°4 – Certifier une pathologie ou un
symptôme: Le Conseil de l'Ordre n'admet en tant que certificat que celui d'un symptôme alors que les médecins ne s'intéressent qu'à la pathologie |
VIDEO N°4 |
| VIDEO N°5 | N°5 – Saisine par l'employeur du
Conseil de l'Ordre: Le Conseil de l'Ordre ne peut agir que sur plainte, habituellement d'une victime d'un acte médical, mais ici, paradoxalement, du responsable de la pathologie. |
N°6 – Les 3 obstacles: On peut constater trois obstacles à la reconnaissance des pathologies du travail (AT ou MP): Conseil de l'Ordre. Caisses de Sécurité Sociale. Tribunaux de Sécurité sociale. |
VIDEO N°6 |
| VIDEO N°7 | N°7 – Le secret médical au service
de qui ? Employeur ou Patient ? Double lien sur les médecins entre obligation de signalement et devoir de réserve. |
N°8 – Les groupes de parole
thérapeutiques sont-ils permis en matière de souffrance au travail
? Nous verrons que non. |
VIDEO N°8 |
| VIDEO N°9 | N°9 - Cotisations: Comment dégraisser pour pas cher par la méthode du harcèlement? |
||
Pour toutes ces raisons, nous considérons
que les attaques contre les médecins par les employeurs et le Conseil de
l'Ordre mettent à mal notre propre base démocratique.
C'est pourquoi nous vous appelons à signer la pétition de soutien au Dr
RODRIGUEZ:
| Nos
sites et contacts: |
|
| Jean Rodriguez jrodrig@free.fr Sites: http://csdr84.net/ http://csdr84bis.free.fr Pétition: http://csdr84.net/?page_id=30 |
Jacques Roux jacqroux432@gmail.com Sites: http://melchisedek.free.fr/amphibologie/ http://melchisedek.free.fr/encoreuneffort/ Et celui-ci: http://negamphibologie.free.fr |
Hommages:
Première éloge: en hommage à l’action démocratique d’Etienne Chouard.
La finalité de tout ce propos est de défendre une opinion actuellement
non organisée en parti ou en secte, mais probablement aussi, peu
compatible avec de telles expressions. Cette opinion et simple et
complexe:
Simple pour les esprits critiques et informés.
Complexe pour ceux qui tiennent à leurs ports d’attaches intellectuels
organisés en associations, en groupes de pression, ou en entreprises
d’influences, car elle leur commande une mise en suspend de tous les a
priori de leurs organisations, qui sont toujours ceux de la
«représentation».
Etienne Chouard est vilipendé de toute part : il se bat en réseau avec
quelques-uns (nombreux sur le net mais absents de toute diffusion
médiatique), sans «militer» en aucun «parti», mais résolument pour une
mise en sourdine de toute procédure politique de représentation, et pour
le développement (ou plutôt le «re-développement») de toutes les
pratiques démocratiques de tirage au sort, de participation, de
discussion constitutionnelle vraiment
collective, de séparation réelle
des pouvoirs, de la limitation des mandats et de leurs cumuls.
L’ensemble de ma présentation ne vise en dernière analyse ici qu’à
persuader l’auditeur de la vertu de ce projet, ou de ces projets, ainsi
que de leur caractère de nécessité vitale pour l’avenir des démocraties,
notamment pour les plus abouties et les plus pléthoriques d’entre elles,
de cette orientation rarissime dans le champ de l’opinion à l’heure
actuelle, mais qui n’en constitue pas moins le seul espoir de salut pour
la vie des esprits, et peut-être pour la vie des corps, dans les
décennies à venir, en Europe, comme partout ailleurs dans le monde.
Deuxième éloge en hommage à l’action républicaine belge de Laurent Louis:
Il y a des êtres doués de puissance. Ils diffusent leur puissance
seulement si on les écoute.
C’est en général ceux que très peu de gens écoutent. Mon discours est
donc peut-être élitiste. Mais le sien ne l'est assurément pas!
Il y a sans doute une part de masochisme dans cette puissance. C'est
possible. Y en avait-il chez le Christ?
Je pense que le parlementaire constitue à l’arrivée ce qu’il y a de plus
nuisible dans la République, même s’il s’avère nécessaire en son départ.
Laurent Louis est très jeune à l’heure où je parle, mais il a su se
forger une position de parole impressionnante.
L’ensemble de son propos politique est en adéquation parfaite avec les
idéaux politiques que je tâche ici laborieusement d’argumenter.
Je pense bien sûr en particulier à sa vision démocratique de la
nécessité de re constitutionnaliser nos républiques sur la base du
principe démocratique du tirage au sort entre autres propositions. Avoir
soumis ce projet au parlement belge fut un geste d’une esthétique
immense. Le dégout ressenti par ses pairs constitue de même le signe de
cette puissance.
Voir conformément à ma règle des cinq minutes un clip résumant mon
propos et au fond ici, tout mon ouvrage, ce qui est pour le moins
économique.
https://www.youtube.com/watch?v=VQfqdpP03Nc
Troisième éloge en hommage aux autres à Frédéric Lordon, François Asselineau, André Belon, Pierre Carles, Franck Lepage ...:
Le népotisme est un signe de dégénérescence de la république. F. Asselineau.
Idéalistes laïcards conspirationnistes communautaristes sympathiques dans des styles très différents mais sur des rayons d'influence toujours très limités (par définition!), ces différents auteurs que je ne fais que citer offrent chacun dans leur genre le mérite de posséder un style, une honnêteté, un sincérité, une qualité intellectuelle, une connaissance objective de l'histoire (si cette expression a un sens), de la société, de l'économie, de la politique, un bon sens, etc, qui me semble aller bien au-delà de tous les pragmatistes conformistes consensualistes professionnels qui font la substance des grands média.
Une remarque sur André Bellon et son "assocation pour
une constituante":
Une association est un groupe de pression.
Une constituante ne peut pas être la résultante d’un groupe de pression
mais seulement celle d’une révolution, … ou d’un réseau serpigineux
viral ni gentil ni méchant mais métastatique dans son fonctionnement. La
révolution ne fait pas pression, elle retourne.
On appelle ça « changer d’avis » !
Une association (ou une assemblée) ne peut avoir de fonction
constituante qu’à l’issue d’un remaniement révolutionnaire, ou d’un
retournement. Ce n’est pas l’assemblée qui fait le mouvement. C’est le
mouvement qui fait l’assemblée.
La révolution n’est pas une « pression » : elle est une
réaction à une « répression ». Double négation encore une
fois.
Il est donc difficile de penser « l’association pour une
constituante », mais il est peut-être plus envisageable de
promouvoir la constitution d’une association : que se passe-t-il
après ? Eh bien c’est comme toujours : copains, vernissages,
soirées, réunion, petits gâteaux.
Conclusions
Conclusion théorique:
VIDEO: 
Que penser?
Cette structure du schématisme de l’entendement occidental du XXème
siècle européen nous amène certainement beaucoup plus que de la pensée
pragmatique anglo-saxonne telle que je l’ai argumentée, à penser malgré
son polymorphisme et son élasticité, les conditions d’un « idéal
politique ». L’expression a elle-même signé son arrêt de mort.
En effet
- on ne voit pas l’intérêt objectif pour le plus grand nombre (et pour
moi aussi) d’un retour nietzschéen aux idéaux aristocratiques et donc
monarchiques dans l’esprit des grandes familles de l’Europe centrale ou
méditerrannéenne,
- on ne voit pas l’intérêt social du maintien des structures
intermédiaires installant à ce jour aux commandes de l’occident toute la
mauvaise foi des oligarchies bourgeoises,
- on ne voit pas l’intérêt pour la civilisation des différents régimes
dégénérés que constituent les totalitarismes, les tyrannies, les
despotismes et même l’anarchie qui porte en germe les mêmes outrances et
la même violence, quoiqu’il en soit du côté «sympathique» des
anarchistes français ou russes au XIXème siècle.
- il ne reste donc raisonnablement à espérer que le régime démocratique
«typique» qui n’a bien-sûr strictement rien à voir avec ce que Fukuyama,
dans la ligne des distingués sociaux-démocrates radicaux de gauche et de
droite qui sévissent sur le débat intellectuel confisqué par les
institutions des républiques «modernes», appelle « démocraties libérales
».
Il ne reste depuis le début comme possibilité respirable, que la
démocratie NON REPRESENTATIVE, qu’on appelle aussi «directe» ou
«participative».
Beaucoup pour s’en défendre disent que c’est une gageure, qu’elle
n’existe pas, qu’elle est impossible, etc., tout ce que l’on dit d’une
situation qu’on ne veut pas voir advenir.
Elle n’existe certes pas dans la «réalité actuelle», mais ses conditions
de possibilité sont devenue d’une telle simplicité, d’une telle
évidence, qu’elle en est rendue «impensable» même pour la plupart des
plus fins analystes.
Le fait est que ce qui l’ «empêche», c’est le non désir du plus grand
nombre, ou même le désir de ce nombre qu’elle ne vienne pas. Ce qui
l’empêche, c’est un refoulement collectif, figé, institutionnalisé, une
tache aveugle au centre de la rétine occidentale : on pourrait dire la
peur de la liberté. « Liberté ne laisse pas la peur m’empêcher de te
suivre ».
Alors que penser de la nécessité d’une démocratie refusée par l’immense
majorité des acteurs : que c’est une utopie ?
C’est une utopie dans les conditions politiques internationales où nous
nous trouvons. Mais cela ne veut pas dire qu’elle soit impossible comme
réalité, qu’elle ne fonctionne pas comme machine théorique et
imaginaire, que ce ne soit pas un objet réel à cultiver et à défendre.
Ce n’est certes pas l’intérêt immédiat de qui que ce soit d’en défendre
le sens dans le capitalisme de la représentation, et donc pas le mien
nous plus. « Mes amis ne sont pas de ce monde ».
Il n’en reste pas moins que la défense des autres régimes se met
toujours au service des intérêts immédiats de leurs détenteurs et de
leurs soutiens : classe dominante libérale-syndicale adaptée de gauche,
élite intellectuelle nietzschéenne traditionnaliste et légitimiste de
droite (chasse, pêche, viol, tradition), bourgeoisie humaniste et
humanitaire écologique bohème de l’extrême centre, on peut fabriquer à
l’envie des milliers de concepts pour désigner les groupes sociaux qui
pensent à l’unisson de l’univers, leurs intérêts de groupes sociaux
pertinents et influents.
Comment Fukuyama argumente-t-il sa méfiance relative à l’endroit des
idéaux démocratiques « égalitaires » : il les oppose à ceux de la «
liberté » : l’idéal d’ « égalité » serait la ruine de toute liberté
possible : on voit bien qu’il s’agit toujours ici de la fameuse liberté
d’entreprendre, liberté de circulation des biens et des marchandises,
qui oublie totalement la liberté de parole, ou qui la fantasme au
prorata de la liberté d’édition et de production de papier par et pour
les lobbies journalistiques. Jamais l’idéal démocratique n’a exigé
d’égalité de conditions devant la culture ni devant la nature. La
démocratie comme principe exige le gouvernement du plus grand nombre par
des échantillons tirés au sort et donc « statistiquement »
représentatifs de l’opinion. Je pèse ici chacun de mes mots. Cette façon
de désigner l’autorité par l’usage de la « probabilité » n’exige aucun «
lissage » des pratiques et des existences. Chacun peut conserver ses
spécificités, son « identité », qu’il s’agit au contraire de protéger.
Chacun peut développer au prorata de ses « compétences » et de ses «
désirs » des domaines de prédilection, des goûts, des savoirs. Mais la
gestion du projet collectif et des investissements collectifs et
renvoyée à des structures politiques qui doivent intégrer une
représentation « pondérée » des classes et des groupes de pression. La
compétence des acteurs ne se met pas au service systématique des
organisateurs de la société du spectacle, pas plus que des scholarques
de la sélection du mérite bourgeois.
Conclusion laconique et arbitraire, certes, mais provisoire, et ayant
pour prétention de promouvoir le débat, sinon de « l’élever ». Il
faudrait d’abord qu’il y en ait un.
Conclusion pratique:
VIDEO: 
Que faire?
Dans quels buts tous ces développements et cette expression (plus ou
moins inadaptée) ?
Dans le but de faire la promotion des « mesures » nécessaire à une «
démocratie » digne de ce nom (attention : voir le problème nominaliste
posé par ce terme) à partir des conditions pratiques où on fonctionne
dans des pays lotis tels que les nôtres :
Je propose donc et par force presque seul, ce qui n’en est pas moins un
« programme politique » improvisé mais ayant à être soumis quoiqu'il en
soit àla sanction d'institutions "démocratiques" "vraies" :
- La contention et le corsetage maximum du pouvoir exécutif et de toute
velléité de présidence dès l’obtention des conditions d’une « paix
sociale ». (Ce qui ne réalise en aucun cas l’idéal anarchiste des
gauchistes déçus: je distingue radicalement la démocratie de l'anarchie,
ce qui n'est pas clair du côté des anarchistes!)
- La séparation réelle des pouvoirs et pas seulement sur le papier.
- La « représentation » toujours limitée, surveillée et sanctionnée à la
moindre dérive.
- Le renoncement actif et commenté à toute élection de représentant, au
bénéfice des référenda, du tirages au sort des parlementaires et des
magistrats, de votations sur des grands choix collectifs, de
consultations du suffrage universel direct sur des questions directement
politiques en dehors de toute délégation. (Voir à ce sujet toutes les
idées pétillantes d’Etienne Chouard sur le Net)... Il convient
bien entendu de rester électeur dans le titre et dans le principe quoi
qu’il arrive.
- Le renoncement définitif à l’idéologie de la « formation » nécessaire
à l’exercice de ces « charges ».
- L’indemnisation très modérée de ces temps de responsabilité pour les
seuls acteurs désireux de les remplir dans ces conditions
d’indemnisation modeste, ces «charges» étant en elles même pour le moins
suffisamment « gratifiantes » et honorifiques.
- Le principe du débat « démocratique et direct» (c’est un concept),
inscrit dans la constitution, avec la primauté des décisions issues de
ces débats sur les décisions de tout acteur isolé.
- La limitation draconienne des mandats de toutes sortes et surtout
bien-sûr de leur cumul!.
- La suppression de toute juridiction nationale ou internationale
encourageant le système et la pratique du crédit à intérêt. (Ce qui est
devenu, il faut le dire, un pléonasme).
- La suppression générale des systèmes de subventions de la part des
collectivités auprès des groupements associatifs, qui met la
représentation au service de la représentation.
- La suppression radicale plus que tendancielle de l’incarcération et de
la réclusion comme système de sanction et d’éradication à remplacer par
des procédures technologique et biomédicales de surveillance et de
limitation biologiques (qui ne sont ni plus fasciste, ni plus nazies, ni
plus totalitaires, que l’incarcération, mais moins coûteuses, et tout
aussi dissuasives).
- L’abrogation immédiate en France des lois Gayssot et Fabius.
- La prise en compte constitutionnelle du caractère profondément
lésionnel pour la République démocratique des modèles de législation
révolutionnaires du type de la loi Le Chapelier-décret d'Allarde, et
plus récemment "concurrence libre et non faussée", mais aussi de tout
interdit stigmatisant les «coalitions» potentielles : car dans la
démocratie, la coalition, c’est la démocratie.
- La suppression tendancielle de toute structure et de tout
système social entretenant le « travail » comme principe, mais en
maintenant jusqu'au bout le droit du travail protecteur du travailleur
et non du travail, et donc la suppression définitive du travail en tant
que tel, c’est-à-dire en tant que concept, ce qui n'empêche pas
l'action, la production, l'invention, l'expression de nouvelle formes de
vie sociale.
- Le maintien de la propriété privée des moyens de production et la
suppression de la propriété privée des moyens de destruction.
- La restauration pour l'état de son autonomie monnétaire et la
possibilité pour lui de battre monnaie comme l'explique très bien
Chouard.
- Le maintien de la propriété privée de l’habitation et du "lopin de
terre" et la suppression tendancielle de la grande propriété foncière.
(« La terre est à tous »).
- Le maintien et la défiscalisation de la propriété privée des moyens
d’existence de la personne, et l'augmentation des droits de mutation et
d'héritage.
- Une attitude collective tendantielle de désindustrialisation pour la
production des moyens de destruction dans une finalité de "dissuasion de
la dissuasion", et une industrialisation uniquement collective et au
service du seul idéal démocratique (et non républicain!) de la
production industrielle des moyen de production.
Conclusion logique: VIDEO: 
Que dire?
En réalité cette question bien que très authentique se décline en une
fausse question et une vraie question : ce n’est pas tant « que dire ?
», que « où dire » ce qu’on ne sait comment exprimer ?
On sait très bien que l’on ne sait que dire, mais on sait aussi qu’on ne
peut expérimenter nulle part, qui que l’on soit (même professeurs au
Collège de France), ce que l’on pourrait dire, si « dire » était permis
dans la République des lumières. Nous n’en sommes pas là ! Quoiqu’en ait
dit Wittgenstein, car ce qu’on ne peut pas taire, il faut le dire.
Donc ce n’est pas tant « que dire ? », que « où trouver les espaces
propices », réellement propices (et là l’exigence a du sens car partout
l’optimisme béat des bobos ne cesse de mimer et de promouvoir le mythe
de la liberté d’expression), propices à une expression commune,
dialectique, critique, partagée, mais « vraiment », pas comme à la télé,
pas comme à l’Assemblée Nationale, pas comme au conseil municipal, pas
comme au ministère de la culture.
Donc la question « que dire ?» constitue pour moi véritablement celle du
débat démocratique : Où donc se peut-il débattre de la réalité
politique? Nulle part à l’évidence dans l’état actuel des choses ou dans
les choses actuelles de l’Etat.
N’est-ce pas précisément l’effet conjoint des pathologie de la
République et de la Démocratie qui a pour effet de rendre impossible
toute échange d’opinions réelles non "drivé" par les professionnels
médiatiques du débat, les « animateurs », les institutions de
représentation du sentiment républicain, les oligarques de la démocratie
représentative, en un mot les « officiels » ?
Que dire dans un tel contexte, sinon, se taire, s’extraire en force du
jeu forcé de la « participation » convenue, préparée, mise en scène,
préenregistrée, préméditée, décidée en conseil d’administration, ou
plutôt dans son arrière cuisine ?
Que dire quand on ne peut rien dire ? Voilà sans doute la meilleure
façon de poser le problème!
Le « cause toujours » de la galéjade ou le « tout est permis, rien n’est
possible » de Clouscard nous en donnent une bonne lecture.
Donc il apparait comme une évidence qu’il faut dire qu’il n’y a pas (ou
peut-être pas encore ? – on voudrait y croire) de lieu pour dire ce
qu’on ne sait pas encore qu’on va la dire (je laisse ici le divan du
psychanalyste raffiné pour une autre thématique). Devenir de la parole,
de l’être pensant, devenir parlant de l’être que Lacan a su approcher de
si près, moyen en quoi il n’y en avait pas d’autre que parlant, devenir
deleuzien, animal, femme, enfant. Le devenir de la parole n’est pas le
devenir convenu du deviner des jeux télévisés.
Nous vivons dans la République des savants qui savent ce qu’ils disent.
Les savants gouvernent. Pas les autres.
Et si les savants se trompaient ! Ceux de la science humaine sont là
pour ça !! Mais ils prétendent toujours peu ou prou à la dureté de leur
science, et donc de leur personne.
Alors que dire depuis les espaces de la vie ordinaire, les espaces du
commun pour ne pas dire du vulgaire. Que dire depuis l’espace de
l’électeur, celui à qui s’adresse la représentation. La représentation
commerciale, universitaire et scolaire, politique, médiatique.
Que dire sinon dire qu’on ne peut rien dire ?
CONCLUSION DES
CONCLUSIONS: VIDEO:  Que voter?
Que voter?
C'est bien-sûr mon prochain l'aura compris le but ultime de mon propos, de rappeler que l'élection des représentants est quoiqu'il en advienne, toujours nocive pour les nations déjà émancipées des différentes férules, que peuvent être l'exploitation coloniale, le sous-développement économique. Elle est nocive pour la liberté des acteurs, pour l'avenir des enfants, pour l'émancipation future des pays ci-dessus désignés.
Je préconise donc de ne pas voter, aussi longtemps que les votes blans ne seront pas comptabilisés. De voter blanc quoiqu'il en soit s'il s'agit d'abandonner son libre arbitre à quelque représentant que ce soit, mais en précisant par écrit sur le bulletin, au risque de l'annuler s'il ne permet pas de la préciser, que ce vote s'exprime en opposition à toute poursuite d'interrogation de l'électeur aliéné par la voie et par la voix du pseudo-choix d'un représentant qui ne peut être consciemment ou inconsciemment qu'un imposteur au sens topographique et topologique du terme.
Il peut paraître insultant à qui a encore tout fraichement voté pour tel choix ou contre tel choix, d'entendre ce jugement assez péremptoire de ma part: Je m'empresse de dire que rien dans cette opinion n'est péremptoire depuis mon point de vue et que mon intention n'est d'insulter ni de n'humilier personne. Mais comment dès lors défendre l'opinion qui d'une considération longuement repensée du fait politique (et psychologique) m'est laborieusement apparue comme une évidence en opposition avec tous les "bon sens" de l'héritage scolaire dont chacun de nous dans la République est bénéficiaire et victime.
Epilogue
Logique de la vie.
La question de la logique pourrait être uniquement celle de l’autorité.
On peut s’intéresser à la logique en pensant que cette discipline doit
faire autorité au bout du compte, ou fait autorité depuis l’origine des
temps. Mais est-il logique qu’il y ait une origine des temps ?
On peut aussi s’intéresser à la logique en pensant que cette discipline
ne parvient jamais à faire autorité au bout du compte. Mais où est le
bout d’un compte ?
Pour autant, les problèmes de la logique, les questions qu’elle a
toujours posé, les paradoxes qu’elle soulève, les incomplétudes qu’elle
révèlent dans l’être même de la pensée, peuvent non pas prouver, mais «
« faire sentir logiquement » la façon dont le manque de cohérence, de
totalité, de complétude, de l’être pensant, expriment sa vie, la « vie
de l’esprit », concept hégélien donc dialectique, comme l'est la vraie
logique, c'est-à-dire la logique intuitionnelle.
La vie n’est pas logique. Ce que la vie de l’être implique dans son
propre langage n’est jamais logique. L’être humain « tombe dans le monde
», incomplet, ou « castré » au sens de la psychanalyse. La logique lui
sert de pansement, de compensation, de consolation. La logique vise
toujours le pathologique.
Les questions logiques les plus rigoureuses s’effritent toujours si on
les prolonge par une métaphysique des objets ou une métapsychologie du
vitalisme subjectif.
La logique est la façon dont la vie de l’esprit interroge en permanence
la négation. Instinct de vie-instinct de mort. Freud a voulu se
débarrasser de la logique grâce à son concept d’inconscient moyen en
quoi il a promu une nouvelle machinerie d’interrogation logique qu’on
n’est pas à la veille d’achever, comme Kant croyait pouvoir tabler sur
une logique achevée.
La vie n’est pas logique mais la vie de l’esprit ne peut se passer de
l’exercice d’une logique de la vie. C’est-à-dire d’une pratique
dialectique permanente de sa propre négation.
Nul mieux que Michel Henri n’a exprimé et expliqué ces paradoxes vivant
de l’esprit.
La vie n’est pas logique mais il n’est pas logique que la vie ne soit
pas logique. Toute la difficulté en repose sur le statu de la double
négation (voir mon article correspondant prélevé sur mon site de 2002.)
Où placer le débat impossible ? (« Absence du débat non parlementaire »)
C’est une double négation : nous sommes donc en plein dans la
subjectivité.
Et il se trouve que le débat non parlementaire, qu’il ait lieu en haut
ou en bas de l’échelle sociale, constitue la condition pour qu’une
constitution soit appliquée. C’est-à-dire que le débat non parlementaire
conditionne la République.
Le débat non parlementaire est le débat dans les conditions de la praxis
sociale, tout comme le débat parlementaire est le débat en dehors des
conditions de toute « praxis ».
Mais le débat non parlementaire est interdit par des lois latérales de
la République (Le Chapelier, d'Allard, Gueyssot, …). Les lois contre ce
que Montesquieu appelait les "corps intermédiaires", mais aussi les lois
dites maintenant "mémorielles": on ne doit pas dire de l'histoire sans
l'imprimatur républicaine.
Il n’y a donc par définition aucun lieu pour le débat non parlementaire.
Et il n’a de fait quasiment jamais lieu dans les espaces de la
République, même s’il est mimé en permanence pour les besoins de la
publicité Républicaine. Les média ont un rôle majeur à cet endroit: leur
rôle est de faire penser que le débat est possible partout, et de le
confisquer partout au service de la République. Les choses ont un peu
bougé depuis l’apparition du net. L’école assume les mêmes fonctions à
l’égard des enfants et des sans primo-emploi. Le net permet par principe
la diffusion et la confrontation d’un certain nombre d’opinions sans
recourir à l’estampille scolaire ou médiatique républicaine.
Le débat sur le net est un débat en écriture et par mise en ligne de
clips, échanges vidéos, informations personnelles d’acteurs autonomes,
objections et réponses aux objections, selon la méthode scolastique.
Ces débats sont perçus comme dangereux et menaçant par l’institution et
toute la frange des acteurs qui s’identifient à quelque chose de
l’institution. Il est probablement impossible de ne pas s’identifier à
quelque chose de l’institution. Certains le font moins. Ou du moins ils
font en sorte que ça ne retentisse pas sur leur capacité à accepter et à
intégrer le débat non parlementaire. Le goût du débat et celui de la
démocratie sont confondus. Par contre on peut être républicain sans être
démocrate. Les anglo-saxons nous l’ont bien fait comprendre.
Double négation : c’est donc bien la subjectivité qui est ici en scène
(je rappelle que pour moi la subjectivité commence avec l’application
intuitionniste de la double négation). La solution se trouve dans la
triple négation : c’est par le refus de l’absence de débat non
parlementaire que les acteurs peuvent manifester leur idéal
démocratique.
Empêchement du débat. Inhibition de cet empêchement. L’inhibition d’un
empêchement est-elle un acte ? c'est une trnasgression. On peut parler
ici en termes de neurobiologie : il peut y avoir inhibition de la
recapture du débat par les institutions issues de la République. Mais
est-ce que cela induit forcement une plus-value de démocratie, ou au
contraire est-ce que cela limite encore davantage les conditions de la
possibilité du débat non parlementaire ? Je laisse laquestion ouverte.